
Les Rues d’Aix
ou recherches historiques sur l’ancienne capitale de Provence
par Roux-Alpheran en 2 tomes 1848 et 1851
>>> Retour Accueil du Blog <<<
LE COURS
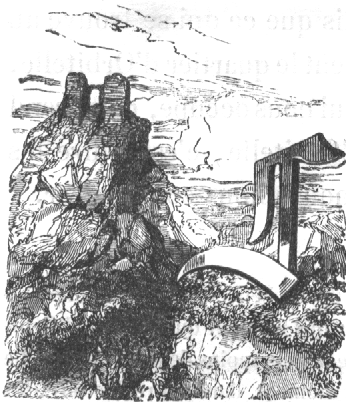 ORS de l’agrandissement dont nous parlons, la lice extérieure de la ville et le fossé 1 occupaient l’emplacement actuel du Cours et se terminaient à la ligne méridionale de celui-ci, où l’on traça d’abord une première rue qui devait porter le nom de rue de l’Archevêché. Mais sur les réclamations d’une foule d’habitants et malgré de vives oppositions, le parlement ordonna, par deux arrêts, l’un du 1er décembre 1649, l’autre du 26 mai 1651, qu’au lieu et place où existaient auparavant le rempart, le fossé et les anciennes lices intérieure et extérieure, il serait fait un Cours à carrosses, et par un autre arrêt du 28 juin 1658, il fut dit que ce Cours demeurerait pour servir au public, sans pouvoir jamais être changé de destination pour quelque cause que ce fût.
ORS de l’agrandissement dont nous parlons, la lice extérieure de la ville et le fossé 1 occupaient l’emplacement actuel du Cours et se terminaient à la ligne méridionale de celui-ci, où l’on traça d’abord une première rue qui devait porter le nom de rue de l’Archevêché. Mais sur les réclamations d’une foule d’habitants et malgré de vives oppositions, le parlement ordonna, par deux arrêts, l’un du 1er décembre 1649, l’autre du 26 mai 1651, qu’au lieu et place où existaient auparavant le rempart, le fossé et les anciennes lices intérieure et extérieure, il serait fait un Cours à carrosses, et par un autre arrêt du 28 juin 1658, il fut dit que ce Cours demeurerait pour servir au public, sans pouvoir jamais être changé de destination pour quelque cause que ce fût.
Il en coûta environ cent mille francs, soit pour achat de terrains, soit pour les plantations, et cette somme fut payée tant par les acquéreurs des places où devaient être bâties les nouvelles maisons, que par les propriétaires des anciennes habitations qui se trouvaient situées sur le Cours par suite de la démolition du rempart. La ville elle-même fut condamnée à payer aux entrepreneurs un cinquième de la dépense, mais ceux-ci abonnèrent avec elle, en 1660, moyennant une somme de quinze mille livres.
Dès cette époque le Cours devint le rendez-vous habituel et la promenade journalière des habitants d’Aix. Les familles nobles et les parlementaires, dont un grand nombre avait des équipages, s’y montraient dans leurs carrosses (pour parler le langage du temps), et, il faut le dire, lorsque quelques-uns de leurs membres y paraissaient à pied, ils avaient grand soin de ne point se mêler avec la bourgeoisie, encore moins avec les gens de palais et les marchands. Le croira-t-on ! On en était venu au point, nous l’avons entendu dire, que telle ou telle allée appartenait exclusivement à telle ou telle classe, et malheur à celui d’une classe inférieure qui s’y serait présenté. Des rixes déplorables, que nous ne rappellerons pas, avaient même eu lieu à cette occasion.

Entrée du Cours.
Des lignes de démarcation étaient, pour ainsi dire, tracées, et la révolution ne les a point fait disparaître entièrement. D’un côté, la légèreté des jeunes gens, la grave et froide politesse des personnes d’un âge mûr ; de l’autre, la fière opposition de plusieurs, l’humble soumission de quelques autres, la morgue de tous, principalement celle des femmes, offraient des tableaux piquants aux yeux de l’observateur.
Les bourgeois eux-mêmes savaient se tenir à l’écart des marchands, quoique ceux-ci fussent bien souvent plus riches qu’eux. Mais les uns vivaient de leur modique revenu et faisaient gloire de leur oisiveté depuis plusieurs générations, ce qu’ils appelaient vivre noblement ; la plupart avaient même des liaisons de parenté avec certaines familles nobles, d’où était venu ce dicton: » Petite noblesse et bonne bourgeoisie se tiennent par la main » ; tandis que les autres, maniant l’aune du matin au soir, paraissaient se rapprocher des arts mécaniques, et parvenaient cependant à la fortune par un commerce lent et assuré, pénible mais lucratif.
Ceux des avocats qui tenaient le premier rang au barreau, se mêlaient peu avec ceux de leurs confrères qui avaient moins de talents, et lorsqu’ils étaient parvenus à l’assessorat, les portes des maisons nobles leur étaient ouvertes, ce qui n’était pas pour les avocats peu causés, non plus que pour les procureurs et les notaires qui semblaient former une classe à part.
Mais les artisans n’auraient osé se montrer sur le Cours que le soir ou à la nuit close, les jours de fête ou de grande réunion, d’où venait que la plupart allaient se régaler à la bastide comme pour se dédommager de cette exclusion. L’un d’eux ayant ouvert une boutique sur le Cours, en 1748, la rumeur produite dans les classes supérieures par un pareil scandale, fut telle que le conseil de ville délibéra, le 9 avril de ladite année, que des cafés seuls pourraient y être établis et nulle autre boutique d’artisan.
Les grandes promenades du Cours offraient, par cela même, un spectacle imposant dont ne pourront jamais se faire une idée ceux qui ne l’ont pas vu. Ces habits galonnés d’or ou d’argent, ces broderies de toutes les couleurs, ces petits manteaux, ces grandes perruques, ces cheveux poudrés et pendants sur les habits noirs, ces tricornes emplumés, ces décorations étalées sur tant de poitrines, ces épées qui battaient sur les mollets, les pierreries dont les dames des hautes classes étaient couvertes, leurs riches étoffes, leurs superbes dentelles, leurs immenses paniers, leurs coiffures si élevées et enrichies de plumes et de diamants, les carrosses dorés circulant lentement au pas des chevaux dans la grande allée, les livrées des domestiques; tout cela est si différent de ce que nous voyons aujourd’hui, que nos tableaux ne peuvent paraître que chargés, quoique assurément ils soient encore bien faibles auprès de la vérité. Tel a été cependant l’état du Cours pendant près de cent cinquante ans.
On y aborde par quatorze rues ou places la plupart très spacieuses, en sorte qu’il pourrait, dans un cas urgent, être évacué en quelques minutes, quoiqu’on pût, rigoureusement parlant, sa superficie étant d’environ dix-huit mille mètres carrés, y réunir la totalité de la population de la ville, des faubourgs et du territoire.
Il est planté de quatre rangs d’ormes, entremêlés de quelques platanes, depuis qu’on l’a replanté dans l’hiver de 1830 à 1831. Dans les intervalles des arbres sont des bancs de pierre, et trois fontaines y versent leurs eaux jour et nuit, ce qui n’empêche pas, il faut l’avouer, qu’il n’y règne en été une poussière affreuse insupportable, depuis qu’on a converti la principale allée en grande route et qu’on y a ouvert une entrée de la ville en exhaussant la Rotonde au niveau du Cours.
Il y a cent ans que Lefranc de Pompignan a dit, en parlant de cette belle promenade, dans son Voyage de Languedoc et de Provence, que bien des gens peu instruits confondent avec celui de Chapelle et Bachaumont :
Quelques arbres inégaux,
Force bancs, quatre fontaines
Décorent ce long enclos,
Où gens qui ne sont point sots,
De nouvelles incertaines
Vont amuser leur repos.
Lors du voyage de Pompignan, il y avait en effet quatre fontaines dans la grande allée du Cours, en comptant celle dite des Chevaux-Marins, la plus belle et la plus abondante de toutes qui était placée en face de l’Hôtel des Princes, et qui fut supprimée vers 1780, lorsqu’on fit près de là une nouvelle entrée de la ville à laquelle on adapta une grille de fer qu’on a enlevée en 1843.
Des trois fontaines qui restent actuellement, l’une, celle du milieu, est alimentée par la source d’eau thermale qui vient du quartier des Bagniers ; et celle qui est placée vers la tête du Cours est surmontée de la statue du roi René, exécutée par un très habile statuaire, M. David, d’Angers, qui, nous le disons avec grand regret, a bien mieux fait pour sa ville natale que pour la nôtre.2 Ici, on trouve peu de ressemblance avec la figure du bon roi dont il existe cependant en Provence et surtout à Aix, tant de portraits authentiques qu’il était si facile de copier. Les artistes conviennent au surplus que c’est là le seul défaut à reprocher à cette statue ; mais la ressemblance ne doit-elle pas être le premier et le principal mérite d’un pareil ouvrage ?
Le bon président de Saint-Vincens dit très plaisamment lorsqu’il eut connaissance du dessin de ce monument que la mort ne lui permit pas de voir exécuter : » Ce pauvre roi René a toujours eu du malheur : après avoir fait de l’eau claire pendant toute sa vie, le voilà condamné à en faire encore après sa mort. » Il n’approuvait pas en effet que l’image vénérée de ce prince fût placée sur une fontaine. Que n’eût-il pas dit s’il eût pu prévoir que l’académie des inscriptions et belles-lettres de la capitale, ce corps ordinairement si savant, supprimerait le titre de comte de Provence dans l’inscription qui devait être placée sur le piédestal de la statue ! » Hélas ! disait aussi le général Pascalis à l’occasion de cette suppression, c’était le seul titre qui restait à ce bon roi René, et l’en voilà dépouillé par une académie. »
L’inauguration de ce monument eut lieu le 19 mai 1823, au milieu d’un immense concours des habitants d’Aix et des pays voisins, tous faisant retentir l’air de leurs cris d’allégresse et d’enthousiasme en présence de S. A. R. MADAME, duchesse d’Angoulême, la princesse de son siècle qui, par ses vertus et ses malheurs, mérite le plus le respect et les hommages du monde entier. Ce fait si honorable pour la ville d’Aix (ne fût-il que purement historique) fut consigné en peu de mois sur le socle de la statue. La postérité croira-t-elle que l’esprit de parti l’en a fait retirer, espérant sans doute l’effacer de notre souvenir !
Nous ajouterons une observation : le Cours fournit une foule de preuves du peu de fond qu’il y a à faire, en général, sur la véracité des livres, quelque luxe qu’on puisse remarquer dans leur impression, leurs illustrations, leur reliure, etc. La plupart des géographes et des voyageurs veulent qu’on le nomme l’Orbitelle ; or, ce nom ne lui a jamais été donné, et l’on a vu plus haut à qui il appartient. Il est dit dans les Soirées Provençales, 3 que » l’Orbitelle est une promenade de prés de cent cinquante toises de long sur quinze au moins de large…., d’où la vue se perd dans la campagne du côté du midi, et se termine au nord par une très belle façade d’église. » Millin, dans son Voyage dans les départements du Midi de la France, 4 répète ou copie pour mieux dire ce conte de l’Orbitelle, des cent cinquante toises de long sur quinze de large, de la vue de la campagne du côté du midi, et s’il nous fait grâce de la superbe façade d’église, il remarque en compensation que le Cours » est planté de quatre rangées d’anciens et beaux tilleuls. »
Or, la vérité est que notre Cours est dirigé du levant au couchant, et nullement du nord au midi ; c’est du côté du couchant seulement qu’on découvre la campagne et il n’y a jamais eu sur cette promenade ni façade d’église ni un seul tilleul. C’étaient des ormes que Millin avait pris pour des tilleuls, et Bérenger avait cru voir une église dans l’hôtel du Poët. Enfin, la longueur du Cours est de deux cent vingt toises (environ quatre cent quarante mètres) au lieu de cent cinquante ; et sa largeur de vingt à vingt-une toises (environ quarante-deux mètres) au lieu de quinze. Après cela fiez-vous aux voyageurs et aux beaux livres.
Peu de villes offrent à leur entrée un aspect aussi imposant que celle d’Aix, lorsqu’on arrive par cette grande place que nous nommons la Rotonde, où se croisent les routes royales de Paris de Marseille, d’Italie et de la Haute-Provence. Une vaste et belle promenade se présente au centre de la ville et semble la partager en deux portions bordées, à droite et à gauche, par de magnifiques maisons dont un grand nombre portaient le nom d’hôtels avant la révolution. Ce sont les souvenirs que rappellent ces édifices et les familles qui les habitaient à cette époque où les familles qui les avaient précédées, qui vont faire le sujet de ce que nous allons dire sur le Cours, jadis si renommé, de cette ville.
La première maison à gauche en entrant et qui sépare la lice intérieure de la rue du Trésor, est une fort belle hôtellerie dite l’hôtel des Princes, la plus fréquentée d’Aix depuis 1785 ou 1786, époque de sa construction. L’entrée du Cours, nous l’avons déjà dit, n’était pas là quelques années auparavant. On y arrivait du dehors par la porte des Augustins et la rue du Trésor ; aussi l’hôtel des Princes n’était-il alors qu’une maison particulière habitée, en dernier lieu, par le sculpteur Jean-Pancrace Chastel. C’est là que cet habile artiste a mis au jour sa gracieuse vierge de la paroisse Sainte-Magdelaine, sa belle fontaine de la Place des Prêcheurs, son fronton des greniers d’abondance, et tant d’autres chefs-d’œuvre dus à son admirable ciseau. 5
L’hôtel des Princes ayant été construit sur l’emplacement de cette maison, a vu loger dans son sein la plupart des hauts personnages qui, depuis lors, ont passé à Aix. Mais avant de parler de quelques-uns d’entre eux, nous rappellerons un événement déplorable arrivé dans cet hôtel pendant la nuit du 28 février au 1er mars 1787. Un jeune homme de vingt-huit ans, beau, riche, aimable, nouvellement marié dans une des plus nobles familles de la cour, appartenant lui-même à l’une des plus anciennes et des plus illustres maisons de Provence connue depuis le XIe siècle, Charles-François de Simiane, marquis de Miremont, mestre de camp en second du régiment de Limousin, lieutenant de roi de la province de Saintonge, gentilhomme d’honneur de MONSIEUR, comte de Provence, frère de Louis XVI (depuis Louis XVIII), etc., y finit ses jours misérablement. Le mystère de sa mort ne fut jamais bien éclairci : les uns dirent qu’il avait mis lui-même volontairement fin à son existence ; d’autres, qu’il avait été tué en duel pendant la nuit, à quelques pas de là, au milieu de la Rotonde et que son corps avait été reporté secrètement dans son lit où il fut trouvé le lendemain. Ce qu’il y a de plus certain, c’est qu’il avait passé la soirée du dernier jour de février au spectacle et que rien n’avait pu faire soupçonner chez lui soit l’attente d’un duel, soit un sombre désespoir. Par sa mort, l’illustre maison de Simiane, qui avait produit jusqu’à douze branches différentes, toutes riches puissantes et distinguées depuis sept siècles, soit par leurs alliances, soit par leurs hauts emplois dans l’église, dans les armées et dans la robe, ne subsista plus qu’en la personne d’un enfant de six ans, notre compatriote et le cousin du défunt, dernier rejeton des marquis de Simiane-lez-Aix, lequel étant mort en 1795, fut le terme de cette noble et antique maison. 6
Les premiers voyageurs de distinction dont nous avons à parler, sont les ambassadeurs indiens que le nabab de Maïssour, Tipoo-Saëb, envoya au roi Louis XVI en 1788, et qui, étant débarqués à Toulon le 9 juin, arrivèrent à Aix le 25 du même mois, à six heures du soir. Quoique la ville fut alors sous le coup des funestes édits du mois de mai précédent, qui avaient ordonné la suspension momentanée des cours souveraines, elle était encore néanmoins dans tout l’éclat de son ancienne splendeur. Ces brillants équipages, ces carrosses dorés, ces magnifiques parures dont nous avons parlé existaient encore et offrirent aux ambassadeurs un spectacle nouveau pour eux. Le comte de Caraman, commandant en chef en Provence, leur fit rendre tous les honneurs militaires et fut à leur rencontre jusqu’au bout des allées qui séparent les deux rotondes, précédé de ses gardes et accompagné d’une foule d’officiers généraux et de grands seigneurs qui se trouvaient à Aix. Les deux régiments de Lyonnais et de Vexin, drapeaux au vent et sous les ordres du marquis de Miran, commandant des troupes en Provence, étaient rangés en haie depuis la première rotonde jusqu’à l’hôtel des Princes où devaient loger les ambassadeurs. Ceux-ci avaient mis pied à terre à l’arrivée de M. de Caraman qui, leur ayant présenté le marquis de Saint-Tropez, brigadier des armées du roi , le chef de l’ambassade, Mahomet Durvesh-Kan, beau-frère de Tipoo-Saëb, serra tendrement dans ses bras le frère du vainqueur de l’inde, de l’illustre bailli de Suffren. Arrivés à l’hôtel, M. de La Tour, premier président et intendant de Provence, se présenta à eux ainsi que MM. les consuls et ils furent harangués par M. Pascalis, assesseur, après quoi on leur offrit le présent accoutumé de la ville consistant en vingt-quatre boîtes de confitures, vingt-quatre paquets de bougies et vingt-quatre bouteilles d’eau de fleurs d’orangers qu’ils acceptèrent gracieusement. M. le commandant leur fit aussi porter des rafraîchissements et ils permirent à chacun de les voir souper. Enfin, les plus belles dames de la ville leur ayant été présentées, la soirée fut extrêmement brillante.7
Un personnage bien autrement important que les envoyés de Tipoo-Saëb, logeait habituellement à l’hôtel des Princes 8 lorsqu’il passait à Aix, et voulut y descendre encore à son retour d’Egypte. On comprend que nous voulons parler du plus grand capitaine des temps modernes, de Napoléon Bonaparte qu’attendaient de si glorieuses destinées et des revers non moins éclatants. Débarqué à Saint-Raphaël dans le Golfe et à un mille de Fréjus, le 9 octobre 1799 (17 vendémiaire an VIII), avec les généraux Berthier, Lannes, Marmont et autres, il se mit en route le soir même pour Paris, sans observer aucune quarantaine, et arriva à Aix le lendemain jeudi, 10 octobre, vers cinq heures du soir. La municipalité, prévenue de son arrivée par un courrier, alla au-devant de lui au cours Sainte-Anne, hors la porte Saint-Jean, et la ville fut spontanément illuminée en signe de réjouissance, tant étaient grands la haine et le mépris qu’inspirait le gouvernement du Directoire et les espérances que fit naître ce retour imprévu. Nous nous souvenons d’avoir vu ce jeune conquérant dans le salon du premier étage de l’hôtel des Princes où nous pénétrâmes avec madame la marquise de Gueidan, sœur du général du Muy, et notre respectable mère qui avait, comme cette dame, à demander des nouvelles d’un frère chéri que l’armée française avait trouvé, à Malte l’année précédente et qui avait suivi les Français en Egypte avec une quarantaine de chevaliers de Saint-Jean. 9 Le général Berthier nous répondit affectueusement au nom de son chef qui écrivait en ce moment, et nous donna les meilleures nouvelles des personnes qui nous étaient chères. On nous a assuré qu’après notre sortie de l’hôtel, une femme très connue pendant la révolution par l’excès de son républicanisme, se présenta à Bonaparte comme députée des frères anti-politiques, 10 pour lui offrir de leur part une couronne civique et lui donner l’accolade fraternelle. Bonaparte la retint d’une main à une certaine distance avec dignité lorsqu’elle s’avança pour l’embrasser, et saisissant de l’autre main la couronne de laurier, il la remit à un jeune domestique en lui disant : – Descendez cela à la cuisine de la citoyenne Imbert – (l’aubergiste de l’hôtel). Il y passa la nuit et une partie du jour suivant.
A midi, il se mit à table avec une vingtaine de personnes dont plusieurs étaient arrivées de Marseille de grand matin, et après avoir mangé très sobrement, avant même le milieu du repas, il demanda du café, des chevaux de poste et monta en voiture. On sait qu’il arriva à Paris le 16 octobre, et que le samedi 9 novembre suivant, il renversa le Directoire exécutif et s’empara du gouvernement. C’est ce qu’on appelle la journée du dix-huit brumaire.
Encore quelques mots sur l’hôtel des Princes. Le pape Pie VII y coucha dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 août 1809, lorsqu’après l’avoir conduit prisonnier, de ville en ville, depuis Rome jusqu’à Grenoble, on le fit rétrograder de cette dernière ville à Savone. Nous copierons le texte même du rapport que M. de Saint-Vincens, alors maire d’Aix, adressa à M. le préfet du département à Marseille (le comte Thibaudeau), aussitôt après le départ de l’auguste prisonnier, 11
Aix, le 5 août 1809.
MONSIEUR LE PRÉFET,
Je m’empresse de vous faire savoir l’arrivée du Pape à Aix, hier soir à neuf heures, et son départ pour Nice, aujourd’hui à huit heures du matin. Hier le bruit courait ici que le Pape était à Avignon ; 12 peu de gens le croyaient. A neuf heures, je fus prévenu par l’aubergiste de l’hôtel des Princes, que S. S. venait d’arriver. J’y allai tout de suite et je demandai à parler à l’officier chargé de la conduite du Pape. C’est un colonel de gendarmerie nommé Boisard, le même qui avait accompagné S. S. à Paris lors du sacre de l’empereur. Il me montra ses ordres qui obligent les autorités civiles et militaires de lui obéir. Je vis le Pape peu après. Après m’être fait instruire du cérémonial, je fis une génuflexion et je lui baisai la main. il me parla de Rome, du cardinal Borgia, du prélat Casali et du père Pouillard, mes amis. Après un quart d’heure d’audience, je rentrai dans la chambre du colonel. Il fait l’éloge du caractère du Pape et de sa bonne humeur. Il est toujours disposé à aller, à s arrêter, à manger comme on veut. 13 Il a passé quatre à
cinq jours à Grenoble, pendant lesquels sont arrivés des ordres pour arrêter le cardinal Gabrielli, 14 ministre du Pape et qui le suivait. On accuse ce cardinal d’être l’auteur des troubles d’Espagne et des préventions du Pape contre la France. Il a été conduit dans une citadelle. Le Pape a à sa suite le prélat Doria, deux autres prêtres, un médecin, un chirurgien et quelques valets. Sa suite occupe deux carrosses. Dans celui du Pape est monseigneur Doria et quelquefois le colonel. Celui-ci assura n’avoir d’ordre que pour Nice. Il y en trouvera de nouveaux s’il faut aller plus loin. Hier soir, il ne vit que moi et M. Boutard, lieutenant de la gendarmerie. Ce matin plusieurs dames et quelques hommes ont assisté à sa messe. 15
D’autres l’ont vu après la messe. Quelques prêtres ont été admis ; il ne leur a dit que ces mots-ci : » Je vous permets de bénir des médailles, des chapelets et de leur appliquer des indulgences. » Avant de partir, il s’est montré au balcon de l’auberge ; il a donné sa bénédiction au peuple assemblé au Cours en assez grand nombre. Il voyage vêtu d’une soutane blanche, d’un rochet, d’un camail rouge et d’une étole. Il a une calotte blanche et des souliers d’étoffe rouge sur lesquels est brodée une croix.
J’ai l’honneur d’être, etc.
» FAURIS SAINT-VINCENS. »
Tel est ce rapport officiel et cependant très véridique, sauF une erreur de nom échappée on ne sait comment à l’écrivain.
Le même pape Pie VII, après avoir été détenu plusieurs années à Savone, fut transféré à Fontainebleau où sa captivité fut encore plus rigoureuse. Enfin, l’empereur lui rendit la liberté, il repassa une seconde fois à Aix, le lundi 7 février 1814, se rendant à Rome ; mais il n’entra pas dans la ville. Dès le matin, des courriers annoncèrent son arrivée, et les habitants d’Aix, auxquels ce retour du souverain pontife dans ses Etats présageait de grands et prochains événements, se précipitèrent en masse à sa rencontre. Il arriva vers une heure au haut de la montée d’Avignon, près des plâtrières et traversa la foule pendant une demi-lieue c’est-à-dire jusqu’au pont des Trois-Sautets, donnant sa bénédiction de tous les côtés. Les vivats, les cris de joie, ne cessèrent de l’accompagner et son passage à Aix fut, cette fois, un véritable triomphe. Il changea de chevaux sous le rempart d’Orbitelle et un grand nombre de fidèles l’accompagnèrent jusqu’à Tourves où il fut coucher, notamment M. l’abbé de Mazenod, supérieur-fondateur des missionnaires de Provence, aujourd’hui évêque de Marseille.
On n’avait vu aucun Pape à Aix depuis le passage de Grégoire XI, lorsqu’il partit d’Avignon, en 1376, pour aller rétablir à Rome le siége pontifical. Suivant l’auteur d’une relation manuscrite de son voyage, ce Pape arriva à Aix le 17 septembre et y séjourna deux jours. Tous les ordres de la ville allèrent à sa rencontre, le clergé ayant à sa tête son vénérable archevêque Gérard de Posilhac. Les rues par où passa le Saint-Père furent tapissées avec des tentures de soie et il fut loger au palais. 16
La reine d’Espagne Marie-Christine a aussi couché à l’hôtel des Princes. Déjà elle s’y était arrêtée pendant quelques heures le 23 octobre 1840, venant de Port-Vendres où elle avait débarqué après avoir été expulsée d’Espagne par le général Espartero, et allant à Marseille ; et une seconde fois, le 14 novembre, se rendant de Marseille à Paris. Elle arriva le soir à Aix une troisième fois, le mercredi 16 décembre de la même année, allant à Nice, et après avoir passé la nuit à l’hôtel des Princes, elle fut à pied, le lendemain, jeudi, à neuf heures du matin, entendre la messe dans l’église paroissiale de Saint-Jérôme, dite du Saint-Esprit, où l’eau bénite lui fut offerte par le curé et où elle trouva un fauteuil et un prie-dieu en velours cramoisi préparés pour elle. Une neige abondante étant survenue pendant la messe, elle retourna à pied à l’hôtel sous le bras d’un chambellan porteur d’un parapluie et » ne reçut presque de la foule, dit le Mémorial d’Aix du 20 décembre, aucun signe de déférence et de respect, en échange des saluts et des sourires gracieux qu’elle distribuait à chaque pas. » Triste et inévitable résultat des révolutions qui dégradent la majesté souveraine aux yeux des peuples et qu’ont éprouvé, à chaque fois qu’ils ont passé à Aix depuis 1850, bien d’autres princes que nous ne nommerons pas, ne voulant parler ici que des têtes couronnées.
Le malheureux don Carlos, second fils du roi d’Espagne Charles IV, que le roi Ferdinand VII, son frère, époux de Marie-Christine, avait privé de la couronne par son dernier testament, étant allé faire valoir ses prétentions les armes à la main et ayant été trahi par Maroto, s’était réfugié en France où il avait trouvé la captivité à Bourges au lieu de l’hospitalité qu’il attendait. Ayant abdiqué ses droits en faveur du prince des Asturies, son fils, il avait enfin obtenu sa liberté et était venu prendre les eaux de Gréoux pendant l’été de 1845. Cet infortuné monarque, qu’une bonne partie de l’Espagne reconnaissait pour roi, sous le nom de Charles V, arriva à Aix le lundi 8 septembre, avec la reine sa seconde épouse, connue auparavant comme princesse de Beira. Leurs Majestés descendirent à l’hôtel des Princes et allèrent entendre la messe, le lendemain, dans l’église paroissiale du Saint-Esprit, après quoi elles reçurent quelques visites des personnes sensibles à leur infortune et à leurs qualités personnelles. Vers le milieu du jour, elles partirent pour Marseille d’où elles passèrent bientôt après en Italie.
Le 14 mai de cette année 1847, la reine Marie-Christine, dont nous venons de parler, a repassé de nouveau à Aix, allant de Paris à Naples, et est encore descendue à l’hôtel des Princes où elle a couché une nuit, étant repartie le lendemain après avoir entendu la messe dans la nouvelle église des Capucins, située hors la ville, à l’extrémité du Cours de la Trinité. On a prétendu, mais peut-être à tort, qu’à ce passage elle a été huée et sifflée. Ce qui est plus certain, c’est qu’à son retour de Naples, traversant la ville d’Aix, dans la nuit du 8 au 9 juin suivant, au lieu de descendre à l’hôtel des Princes, elle s’est arrêtée dans la rue et à l’hôtel d’Italie, où elle a pris son repas incognito, après quoi elle a continué sa route pour Paris. Ce sont de ces bruits que l’histoire doit enregistrer pour l’instruction de qui de droit et surtout pour celle de la postérité.
L’île suivante, située entre la rue du Trésor et celle de la Masse, nous arrêtera peu de temps. Elle était uniquement occupée, au moment de la révolution, quant à sa façade tournant sur le Cours, par le couvent des religieux Augustins, converti depuis lors en plusieurs maisons particulières, admirablement situées pour leur destination actuelle. Auberges, cafés, restaurants, bureaux de diligences, on n’y voit que cela aujourd’hui, et leur proximité de la principale entrée de la ville augmente l’agrément et la valeur de ces maisons.
Sur le point opposé, là où commence l’île comprise entre les rues de la Masse et de Nazareth, est un magnifique hôtel bâti, vers le milieu du XVIIe siècle, par Léon de Valbelle, baron de Meyrargues, conseiller au parlement. Ce fut sans doute à cette époque la maison d’habitation la plus vaste et la plus somptueuse qu’il y eût à Aix, à part toutefois le palais des cours souveraines et l’archevêché. La distribution des appartements, leur belle dimension attestent encore aujourd’hui la fortune de leur fondateur et le noble goût du siècle de Louis XIV. Il n’existe plus néanmoins qu’une partie de l’hôtel primitif, car en 1695, il en fut démembré une portion par Cosme-Maximilien de Valbelle-Meyrargues, dit le marquis de Rians, petit-fils de Léon, en faveur de Marguerite de Maurel du Chaffaud, veuve de Jacques d’Arbaud, seigneur de Jouques et de Gardanne. En la même année 1695, le marquis de Rians vendit le reste de son hôtel à Simon de Raousset, seigneur de Limans, depuis marquis de Seillon, conseiller au parlement, dont les descendants, alliés aux nobles maisons de Vintimille et d’Agoult, ont possédé cet hôtel jusqu’à leur extinction sous la restauration. Le dernier d’entre eux l’avait laissé à leur proche parent le marquis de Cabre, mort en 1843, et M. Blachet, notaire, le possède actuellement.
André-Elzéar d’Arbaud, seigneur de Jouques et de Gardanne, successivement conseiller et président au parlement, ayant acquis, au commencement du XVIIIe siècle, une partie de l’hôtel du premier président de Seguiran, seigneur de Bouc, réunit à cette partie la portion de celui de Valbelle que Marguerite de Maurel, sa mère, avait achetée, et fit bâtir le bel hôtel d’Arbaud que ses descendants occupent encore et qui est sans contredit l’un des plus beaux du Cours. S’il entrait dans notre plan de publier des généalogies, nous dirions que la maison d’Arbaud prouve sa descendance depuis un Barthélemy d’Arbaud, chancelier du roi Robert, comte de Provence, au commencement du XIVe siècle. Mais tel n’est pas notre but. C’est pourquoi nous nous bornerons à mentionner ici quelques personnages qui ont plus particulièrement illustré notre ville, outre douze ou quinze savants magistrats aux cours souveraines de Provence et tout autant de militaires distingués dans les armées de terre et de mer. Ceux dont nous voulons parler plus spécialement ont vécu de nos jours, tels que le comte d’Arbaud-Jouques (Bache-Elzéar-Alexandre), né en 1720, gouverneur de la Guadeloupe en 1775, lieutenant-général des armées navales en 1782, et cordon rouge ou commandeur de l’ordre de Saint-Louis en 1785. Emprisonné à Aix comme suspect, au mois de septembre 1793, il mourut le 26 novembre suivant, trente jours avant son neveu, André-Elzéar d’Arbaud, deuxième du nom, seigneur de Jouques et marquis de Mison, ancien président au parlement, qui périt sur l’échafaud révolutionnaire de Lyon, victime de son dévoûment à l’ancienne monarchie. – Bache-Augustin-Philippe comte d’Arbaud-Jouques, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Charles X, maréchal de camp, commandeur de l’ordre de Saint-Louis et grand’croix de celui de Saint-Ferdinand d’Espagne, né en 1770, mort en 1831. Melchior-André-Elzéar comte d’Arbaud-Mison, maréchal de camp, commandeur de l’ordre de la Légion-d’Honneur et de ceux de Charles III et de Saint-Ferdinand d’Espagne, né en 1772, mort en 1834. Il n’est aucun de nos compatriotes qui n’ait connu et regretté vivement ces deux frères si distingués par leur bravoure dont ils donnèrent tant de preuves dans les armées françaises, sous l’empire et sous la restauration, et si aimés dans Aix à cause de leur popularité. – Enfin, M. Joseph-Charles-André d’Arbaud, leur frère aîné, marquis de Mison et baron de Jouques, actuellement vivant, né en 1769, et qui, après avoir été successivement préfet des Hautes-Pyrénées, de la Charente-Inférieure, du Gard et de la Côte-d’Or, l’était des Bouches-du-Rhône avec le titre de conseiller d’Etat, lors des événements de 1830, époque à laquelle il ne balança pas à se retirer des affaires publiques, pour rentrer dans le commerce des muses au sein d’une douce philosophie. 17
Son hôtel dont nous parlons fut honoré, au mois de mai 1812, de la présence du roi d’Espagne Charles IV, de la reine sa femme, de la reine d’Etrurie, leur fille, et du jeune roi d’Etrurie, fils de cette dernière, lorsqu’après environ trois ans et demi de séjour à Marseille, ces princes infortunés quittèrent cette dernière ville pour aller fixer leur résidence à Rome. Cette cour arriva à Aix le 25 mai, y séjourna le lendemain mardi et continua sa route le jour suivant, reconnaissante de la noble hospitalité qu’elle avait reçue dans l’hôtel d’Arbaud, dont le propriétaire agit, à son ordinaire, en cette occasion, avec tout le dévoûment d’un gentilhomme français envers des descendants de Louis XIV. Le prince de la paix (Manuel Godoï) les accompagnait encore comme lors de leur premier séjour à Aix en 1808, ainsi que nous le dirons plus bas, et occupait seul le rez-de-chaussée de l’hôtel, tandis que ses souverains étaient logés au premier étage, où le roi Charles IV vit avec plaisir quelques belles peintures de Rembrandt, de Téniers et d’autres grands maîtres, qui le décorent. Dans le même hôtel d’Arbaud a encore passé trois fois, pendant quelques heures, S. A. M. Mgr le duc d’Angoulême, fils du roi Charles X, et le dernier des enfants de France qui ait porté le titre de Dauphin. Ce prince allant en toute hâte à Marseille et à Toulon, à la première nouvelle du retour de Napoléon de l’île d’Elbe, ne fit que traverser à cheval le Cours d’Aix, les rues du Pont-Moreau, des Gantiers et de la Miséricorde, le jeudi 16 mars 1815, pour céder aux vœux de la population avide de voir le neveu de Louis XVIII. Mais le surlendemain, il s’arrêta pendant une heure à l’hôtel d’Arbaud, où la cour royale et les autres autorités allèrent lui renouveler l’hommage des sentiments de fidélité et de soumission qu’elles avaient voués, un an auparavant, aux petits-fils de saint Louis et d’Henri IV.
Le siècle des Cent-Jours s’étant écoulé, Mgr le duc d’Angoulême reparut encore deux fois à Aix, c’est-à-dire le jeudi 26 octobre de la même année 1815 et le jeudi suivant 2 novembre. Ces deux fois, il séjourna de nouveau pendant quelques heures à l’hôtel d’Arbaud, où il accepta un splendide repas, et les autorités, la cour royale à leur tête, furent encore admises devant le prince qui ne put douter à leur empressement de la sincérité de leurs protestations d’amour et de dévoûment. Consolant démenti donné aux bruyantes et injustes clameurs d’une foule immense qu’elles eurent à traverser et qui avait sans doute bien mal interprété les manifestations véritablement toutes contraires des mêmes magistrats pendant les Cent-Jours.
L’hôtel de Castillon qui suit immédiatement l’hôtel d’Arbaud, appartenait, lors de la construction du Cours, à la famille de Gaye, éteinte peu après cette époque. Antoine de Séguiran, seigneur de Bouc, le quatrième premier président de son nom en la cour des comptes, aides et finances de Provence, le posséda ensuite, et après lui il fut acquis par la famille Laugier de Beaurecueil, sauf une partie réunie alors à l’hôtel d’Arbaud, comme nous l’avons dit. Les Beaurecueil le firent rebâtir tel que nous le voyons et le vendirent ensuite aux Truphême. C’est de ceux-ci que l’acquit, en 1779, le célèbre procureur-général au parlement, Jean François-André Leblanc de Castillon, dont les descendants le possèdent encore. Né à Aix, le 9 mars 1719, M. de Castillon fut reçu avocat-général en 1741, à l’âge de 22 ans, et ne tarda pas à se rendre digne de succéder un jour à l’illustre Monclar. C’est ce qui arriva en 1775, lors du rétablissement du parlement pendant l’exil duquel était mort M. de Monclar. Voici ce que dit de M. de Castillon le président Dupaty, dans une lettre écrite à sa femme en 1785, et imprimée à la suite de ses Lettres sur l’Italie.
» Je te dois compte, ma chère amie, de la ville d’Aix, c’est-à-dire de M. de Castillon qui fait seul, en ce moment, l’ornement et le mérite de cette capitale de la Provence.
C’est peut-être le seul homme que je n’aie pas trouvé inférieur à sa réputation, je crois même qu’il la passe. Il est du petit nombre des magistrats qui ont imité le flambeau de l’esprit philosophique dans l’étude, les travaux et l’application des lois. Il joint à une érudition immense un grand choix d’érudition, et, ce qui est incompatible ou du moins plus rare, l’art d’apprécier ce qu’elle vaut et de n’en jamais abuser. Il réunit l’expérience de cinquante ans de travaux, de vertus et de malheurs ; enfin il orne son mérite par un extérieur simple, noble, doux, affable, qui, loin de repousser les malheureux, les appelle, loin de les effrayer, les rassure, loin de les alarmer, les console, et il le voile par sa modestie. Il est, dans sa place de procureur-général, un mélange incroyable d’activité et de modération, de zèle et de mesure. J’ai encore admiré, à son âge et surtout dans sa place, un attachement constant aux vrais principes de la magistrature. Les bienfaits et les grâces de la Cour n’ont pas fait disparaître le peuple à ses yeux : il le voit toujours, il le voit partout, il le voit jusque dans le roi. Ce respectable magistrat est à Aix, comme un père au milieu de ses enfants : point de faste, point de luxe ; il ne marche jamais qu’accompagné de ses vertus ; j’ai été témoin de la joie, de la vénération et du véritable respect que sa présence inspire. Il juge ou concilie à lui seul plus de différends que tout le parlement réuni. Je conserverai toute ma vie, au fond du cœur, et son image et ses bontés. »
Quel éloge sortant de la plume de Dupaty !
Les luttes nombreuses que le procureur-général de Castillon eut à soutenir pour le maintien des maximes de l’église gallicane, élevèrent sa célébrité au plus haut point et lui firent sans doute quelques adversaires ; mais appelé deux fois à l’assemblée des notables, en 1787 et 1788, il s’y montra contraire à la convocation des Etats-généraux qu’il jugeait dangereux dans les circonstances où se trouvait la monarchie, comme devant donner trop d’impulsion aux idées nouvelles. L’expérience a montré s’il se trompait.
Emprisonné sous le règne de la terreur, ses jours furent néanmoins respectés, et il se retira à Brignolles où il mourut le 26 février 1800. Une notice biographique sur ce grand magistrat, où se trouve la nomenclature de ses oeuvres imprimées, a paru en 1829, à Paris, in-4°, 18 et son portrait peint par Duplessis, peintre du roi, a été gravé, en 1790, par notre compatriote Beisson. 19
Faute de documents précis, nous n’entrerons pas dans autant de détails à l’égard de la jolie maison de M. le chevalier Hancy, non plus que de l’hôtel d’Estienne-d’Orves, dont le rez-de-chaussée est occupé, depuis quelques années, par le cercle Constitutionnel. Nous ne saurions dire à quelle époque remonte leur construction dans leur état actuel. Nous savons seulement qu’en 1650, l’une appartenait a une famille de Pontevès qui était fort ancienne dans Aix, où elle avait exercé, pendant plusieurs générations, un office de procureur au parlement, et dont les armes offraient quelques différences avec celles de l’illustre maison du même nom. Le dernier mâle de cette famille qui nous est connu, ayant pris une grande part dans la sédition du jour de Saint-Valentin (14 février 1659), 20 contre le premier président d’Oppède, fut condamné à mort par coutumace, par arrêt du parlement du 27 mars suivant et ne reparut plus dans Aix. Nous savons encore qu’à la même époque l’hôtel d’Estienne était la propriété des Margalet, conseillers en la cour des comptes, et que la petite ruelle ou impasse qui sépare cet hôtel de la maison Hancy, conduisait alors à une autre maison que les mêmes Margalet possédaient à la rue Courteissade et qu’avait longtemps habitée le poète Malherbe, qui s’y était marié en 1581. 21 Nous savons enfin (et c’est là tout depuis 1650 jusqu’à la révolution), qu’à cette dernière époque la maison Hancy appartenait aux Michaëlis, seigneurs du Seuil, et l’hôtel d’Estienne aux Maurellet, seigneurs de Cabriès et marquis de la Roquette. C’est là que reposait mollement dans les bras du sommeil, le dernier marquis de la Roquette, lorsqu’il en fut arraché violemment, au mois de décembre 1790, pour être conduit dans les prisons et de là à la mort, ainsi que nous le dirons plus bas.
Cet hôtel, transformé en hôtellerie peu après cette horrible catastrophe, fut choisi, en 1808, pour servir de logement au roi d’Espagne Charles IV et sa famille, dont nous avons déjà parlé. Ce prince arriva à Aix, le mardi 4 octobre, entre cinq et six heures du soir, avec la reine sa femme, l’infant don Francisque son fils, le prince de la Paix et les enfants de celui-ci. Ils arrivaient de Fontainebleau où ils avaient fixé leur résidence depuis leur sortie d’Espagne et leur enlèvement de Bayonne, au mois de mai précédent, et venaient chercher dans le midi de la France un climat plus favorable à leur santé. Leur entrée dans Aix fut silencieuse et sombre. Quelques curieux seulement se trouvèrent sur le Cours et nous nous souvenons d’avoir vu couler des larmes d’attendrissement lorsque défilèrent ces antiques carrosses aux armes de la maison de Bourbon, dont quelques-uns dataient peut-être du temps de Philippe V et avaient servi à voiturer en Espagne, au commencement du XVIIIe siècle, le glorieux petit-fils de Louis XIV.
La suite de Charles IV était nombreuse, étant composée d’environ deux cent cinquante personnes et deux cents chevaux. On se flatta pendant quelques jours à Aix que cette cour se fixerait dans cette ville où elle eût sans doute bien de l’argent et procuré beaucoup de travail aux ouvriers. Tout semblait l’annoncer, et l’hôtel d’Albertas ayant été offert si le roi eût voulu le louer pour un an, le prince de la Paix avait répondu devant M. de Saint-Vincens, alors maire : Pourquoi ne le prendrions-nous pas pour un an, s’il nous convient ? Le principal chambellan du roi désirait unir une île entière de maisons sur le Cours, mais plusieurs propriétaires se refusèrent à céder les leurs, si bien que peu de jours après, les tapissiers furent envoyés à Marseille pour chercher à leurs Majestés un logement plus convenable. » Vous croyez que c’est le roi qui se déplaît à Aix, nous dit M. de Saint-Vincens ? Détrompez-vous ; ce sont ses alentours qui le font agir, ses alentours qui espèrent trouver plus d’amusements à Marseille qu’ici. Car nous étions bien sincèrement désolé de ne pouvoir retenir à Aix ce que nous regardions comme une providence pour cette ville, et nous pouvons nous flatter d’avoir fait alors tous les efforts qui dépendaient de nous pour amener ce résultat, 22 en conduisant sans relâche, pendant plusieurs jours, les chambellans et les tapissiers visiter les hôtels d’Albertas et d’Eguilles, de Forbin et de Saint-Marc, d’Arbaud-Jouques et de Castillon, de la Tour-d’Aigues, de Valbelle, de Moissac, etc. Rien ne put leur convenir : ce qui agréait à l’un déplaisait à l’autre, et M. le baron d’Anthoine, maire de Marseille, ayant offert sa belle maison de campagne de Saint-Joseph, en attendant qu’un logement fut approprié dans l’enceinte de la ville, Leurs Majestés se décidèrent, le 12 octobre, non sans quelques hésitations, à se rendre à Marseille, en partirent en effet le samedi 15 du même mois, n’ayant vu absolument que le maire, M. de Saint-Vincens, pendant leur court séjour à Aix. Ces détails que nous abrégeons, sont consignés dans les rapports de cet excellent maire au préfet du département, le comte Thibaudeau. 23 Si Charles IV et sa cour ne s’arrêtèrent pas dans notre ville, la faute en fut surtout au peu de temps qu’on eut pour assigner au roi, à son arrivée, un logement autre qu’une auberge ; car si ce prince eût été reçu plus convenablement en descendant de voiture, il est probable qu’il se fût fixé à Aix, nonobstant les intrigues contraires. Dans l’affreuse position où il se trouvait, quelle habitation en France pouvait le dédommager de celle de l’Escurial et de la perte de la couronne d’Espagne et des Indes ? Tout au monde ne lui était-il pas égal, indifférent, après les infâmes manœuvres dont il était la victime ?
Il faut ajouter au surplus que ce qui nous paraissait alors un immense avantage pour la ville, eût peut-être tourné à mal lorsque le gouvernement impérial cessa de fournir au malheureux monarque les subsides auxquels il s’était obligé ; ce que ne prévoyait que trop M. de Saint-Vincens qui nous le disait à l’oreille pour calmer notre désolation : » Et ne voyez-vous pas, c’étaient ses propres expressions, que si on ne le paye plus, il ruinera tous nos marchands et tous nos ouvriers, et qu’en attendant il nous avalera tous. » La vérité est aussi qu’il redoutait au dernier point la surveillance qu’il eut fallu exercer sur des princes dont il déplorait au fond du cœur la haute infortune. 24
Au coin opposé, après avoir dépassé la rue de Nazareth, se présente la maison que les Garidel possèdent depuis 1670. 25 A cette époque se trouvait, à côté de leur maison, un jeu de paume très fréquenté dans ce temps-la, appartenant à un nommé Pierre Lormier, et cet établissement occupait alors, avec la maison d’un bourgeois nommé Paul, les maisons qui sont comprises actuellement entre la maison Garidel et l’ancien hôtel de Nibles ou de Vitrolles. C’est dans la seconde de ces maisons, réunie depuis peu d’années à la suivante par un aubergiste, M. Coste, que naquit, le 22 mai 1700, Michel-François d’André-Bardon, peintre d’histoire membre de plusieurs académies, fondateur et directeur perpétuel de celle de peinture de Marseille, mort à Paris le 13 avril 1783, étant directeur et l’un des membres les plus distingués de l’académie royale de peinture et de sculpture.
D’André-Bardon était non seulement peintre, mais encore poète et musicien. Ses ouvrages imprimés, tels qu’un Traité de Peinture suivi d’un essai sur la sculpture (Paris, 1765, 2 vol. in-12) ; une Histoire universelle traitée relativement aux arts de peindre et de sculpter (Paris, 1769, 3 vol. in-12) ; un travail sur le costume des anciens peuples, en 6 vol. in-4°, enrichi du 365 planches dessinées de sa main ; les vies de Jean-Baptiste et de Charles Vanloo, etc., lui firent le plus grand honneur. Le catalogue de ses tableaux, dont plusieurs existent encore à Aix, se trouve à la suite de son Eloge historique, par son élève d’Ageville (Marseille, 1783, in-12), et le Dictionnaire des hommes illustres de Provence, par Achard, comme la Biographie Universelle de Michaud, parlent trop au long de cet illustre compatriote pour que nous nous étendions davantage sur ce qui le regarde.
L’hôtel de Nibles, dont la façade est très remarquable par son architecture, appartenait, en 1650, aux Guidi, famille parlementaire ; 26 mais ce n’était encore qu’un jardin dépendant de leur maison située dans la rue Papassaudi. L’hôtel moderne ne parait vas avoir plus d’un siècle d’existence, mais nous ne saurions préciser l’époque de sa construction, faute d’avoir vu les titres. Paul-Augustin d’Arnaud, seigneur de Nibles et baron de Vitrolles, troisième conseiller au parlement, de père en fils, le possédait au moment de la révolution, et a été le père de M. le baron de Vitrolles (Eugène-François-Auguste d’Arnaud), ministre d’Etat sous la restauration, lors de laquelle il a rempli un rôle des plus honorables. Ceci nous donne lieu de remarquer combien il faut se défier de ces mémoires apocryphes dont les auteurs, ne pouvant connaître tout ce qui concerne les personnages au nom desquels ils feignent d’écrire, commettent involontairement des anachronismes qui les trahissent. Dans ceux attribués à une femme de qualité sur Louis XVIII, sa cour et son règne, 27 on fait dire à ce prince que M. le baron de Vitrolles est le petit-fils du médecin Ailhaud, inventeur de la fameuse poudre purgative qui porte son nom, 28 lequel prenait aussi le titre de baron de Vitrolles, à cause d’une autre terre noble de Provence qu’il avait acquise et qui est située aux environs d’Apt et de Pertuis, tandis que la terre de Vitrolles, appartenant à la famille d’Arnaud, se trouve près de Sisteron, dans la Haute-Provence. C’est ainsi qu’il y a une troisième terre de Vitrolles aux environs d’Aix et non loin de Martigues, laquelle appartenait au marquis de Marignane. Mais les faiseurs de mémoires prétendus historiques sont-ils tenus de savoir pareilles choses ? Non sans doute. L’essentiel pour eux est d’assaisonner leurs oeuvres d’anecdotes piquantes et de les vendre au public en lui donnant du vrai ou du faux ; peu leur importe.
Après l’hôtel de Nibles, appartenant aujourd’hui à M. Mittre, confiseur, est une maison bâtie, lors de la construction du Cours, par Paul de Meyronnet, alors greffier des États de Provence et dont les descendants, divisés en deux branches, ont fourni plusieurs grands magistrats au parlement et à la cour des comptes, connus, les uns, sous le titre de marquis de Châteauneuf, les autres, sous celui de barons de Saint-Marc. Les maisons qui suivent jusqu’à la rue de la Miséricorde, ont été bâties, depuis la révolution, sur le sol qu’occupaient auparavant le couvent, le jardin et l’église des dames de la Miséricorde, fondées en 1658, comme nous l’avons dit ailleurs ; 29 c’est pourquoi nous n’y reviendrons pas. Toutes ces maisons, à partir de la rue de Nazareth, l’ancien hôtel de Nibles lui-même, sont actuellement livrées à l’industrie, du moins quant à leurs rez-de-chaussée, et n’offrent plus qu’auberges, cafés, débits de tabac, bureaux de diligences publiques, etc. Il en est de même des deux rues suivantes de cette ligne du Cours dont nous allons parler.
La première maison de l’île suivante est une de celles qui avaient été bâties au commencement du XVIIe siècle, lors de l’ouverture de la rue de la Miséricorde à l’extrémité de laquelle elle avait son entrée, et elle avait alors un jardin dont l’emplacement est aujourd’hui occupé par la seconde maison. L’une et l’autre appartenaient, à cette époque, à Barthélemy Puech, conseiller au siége, dont le fils puîné, Louis-Scipion Puech, se distingua par son talent pour la poésie. Il excellait surtout dans la composition des noëls provençaux dont le plus connu est celui qui commence par ces vers :
Naoutres sian tres booumians
Qué dounan la boueno fortuno, etc.
On dit qu’il l’avait imité du célèbre poète espagnol Lopez de Vega, et que cette imitation lui avait attiré des désagréments auprès du cardinal Grimaldi, archevêque d’Aix, qui, ayant examiné la pièce, rejeta les accusations intentées contre son auteur. 30
Le jardin de la maison Puech touchait, lors de la construction du Cours, celle d’un avocat nommé Geoffroy, actuellement occupée, depuis soixante ou quatre-vingts ans par le café Casati, après laquelle venait celle de Laurent Chantre, habile et riche teinturier, comme l’étaient ses pères, et dont la postérité a subsisté jusqu’à nos jours. Nous avons connu, dans notre enfance, trois frères, ses arrière-petits-fils, morts dans un âge avancé sans avoir été mariés ; l’un, trésorier-général de France ; l’autre, juge-garde de la monnaie ; et le troisième, chevalier de Saint-Louis, ancien garde-du-corps de Louis XV, qui se plaisait tant à nous raconter, au moins deux ou trois fois par semaine, les prodiges de valeur que la maison du roi, dont il faisait partie, avait faits à la mémorable bataille de Fontenoi. Mais ils n’habitaient plus leur maison paternelle qui avait été vendue, vers 1730, à Antoine de Laugier, chevalier de l’ordre de Saint-Michel et subdélégué-général de l’intendance de Provence, dont la fille unique épousa, en 1743, Charles-Alexandre de Mazenod, président à la cour des comptes, père et aïeul des deux évêques de Marseille de ce nom, 31 nés l’un et l’autre dans la maison dont nous parlons, que M. Roman de Tributiis, notre parent et ami, possède actuellement.
Un Antoine Gros, dont la sœur avait épousé Laurent Chantre, est le plus ancien propriétaire qui nous soit connu de la belle et vaste maison qui suit et qui fait le coin dans la rue des Grands-Carmes. C’était alors une hôtellerie à l’enseigne du Cheval-Blanc, dont on donna depuis le nom à la rue qui, de l’autre côté du Cours, est alignée à celle des Grands-Carmes. Cette hôtellerie fut acquise, vers 1660, par François de Gantès, seigneur de Valbonnette, l’un des plus célèbres procureurs-généraux qu’ait eu le parlement d’Aix, et sur lequel nous avons une excellente notice, par M. Mouan, avocat, sous-bibliothécaire de la ville. 32 La famille de Gantès qui, depuis plus d’un siècle, a cessé d’avoir sa résidence à Aix, y avait produit plusieurs personnages de mérite dont on peut lire les éloges dans le Dictionnaire des hommes illustres de Provence, par Achard, auquel nous renvoyons nos lecteurs. 33 C’est elle qui avait fait rebâtir la maison dont nous parlons, telle qu’elle est aujourd’hui, et que Louis-Henri de Gantés, petit-fils de François, vendit, en 1716, à Marc-Antoine d’Albert Duchaine, marquis de Fos-Amphoux. Nous avons parlé autre part 34 de ce brave marin, qui revendit cette maison en 1742, neuf ans avant sa mort, à M. Jaubert, marchand, et celui-ci à M. Guion en 1750. C’est du fils de ce dernier que M. Guérin, propriétaire actuel, l’a acquise en 1823.
Cette maison est célèbre dans Aix par le déplorable événement du dimanche 12 décembre 1790, qui fut suivi de l’épouvantable tragédie dont le souvenir nous glace encore de terreur. Depuis longues années, un cercle d’hommes, appelé communément le Cercle de Guion, du nom du propriétaire de la maison, en occupait le rez-de-chaussée. Les sociétaires se composaient de nobles, de bons bourgeois et de la plupart des officiers de la garnison ; c’est dire assez que leurs opinions politiques sympathisaient peu avec celles émises depuis 1789. Dans le café Casati dont nous avons parlé un peu plus haut, se réunissaient ceux des artisans que les nouvelles réformes froissaient dans leurs sentiments et qu’elles privaient de travail. Ces deux réunions avaient conçu le projet d’en former une autre où tous leurs membres seraient admis indistinctement, sous le nom d’Amis de la Religion et du Roi ; d’autres disent sous le titre des Amis de l’Ordre et de la Paix. La société patriotique des Amis de la Constitution, qui s’était établie, en 1789, dans l’ancienne chapelle des Messieurs, dépendante du collége Bourbon, au quartier de Saint-Louis, vit des adversaires et même des ennemis dans les membres de la réunion projetée, et résolut de s’y opposer. Elle était généralement composée de jeunes avocats, de marchands, de riches artisans, etc., ce qu’on appelait avant la révolution le tiers-état.
Dans l’après-midi du dimanche 12 décembre, cette société des Amis de la Constitution envoya des députés au club dit des Anti-Politiques, c’est-à-dire des Amis du vrai, pour lui demander affiliation. Ce club avait été fondé depuis peu dans l’ancienne église des Bernardines, au quartier de Villeverte, par le fameux abbé Rive, bibliothécaire de la province, ennemi déclaré des anciens administrateurs, notamment de M. l’archevêque Boisgelin et de M. Pascalis, 35 duquel il demandait hautement la tête dans des pamphlets dont il inondait le public. Les Anti-Politiques appartenant presque tous à la classe des cultivateurs, flattés de cette demande en affiliation, suivirent en masse les députés quand ceux-ci retournèrent auprès de leurs commettants, et l’affiliation fut jurée d’un commun accord entre les membres des deux sociétés avec des acclamations et des transports de joie inimaginables. Les Amis de la Constitution délibérèrent à leur tour de reconduire en masse les Anti-Politiques chez eux et dans ces trois promenades, les uns et les autres suivirent la grande allée du Cours aux cris de Ça-ira ! Vive la nation ! A bas les aristocrates ! La dernière se composait de plus de sept ou huit cents personnes. On prétend que lors du passage des premiers députés, un coup de sifflet s’était fait entendre, parti du café Casati, ce qui avait paru une injure dirigée contre ces députés. On prétend aussi que lorsque défilèrent sur le Cours les deux sociétés réunies, vers cinq heures et demie du soir, plusieurs membres du cercle de Guion étaient accourus sur la porte extérieure et dans le vestibule de ce cercle et avaient même hué et proféré des injures grossières contre les deux clubs qui passaient.
Des coups de feu furent tirés aussitôt de part et d’autre, qui blessèrent plusieurs personnes et bientôt le désordre fut à son comble sur le Cours. Les officiers du régiment de Lyonnais qui se trouvaient en ce moment dans le cercle de Guion, en sortirent l’épée à la main pour se réfugier au corps-de-garde établi sur la place des Carmélites et de là aux casernes. Les autres membres du même cercle s’évadèrent par la petite porte ouverte sur la rue des Grands-Carmes, et plusieurs coururent de très grands dangers jusqu’à leur arrivée chez eux. La municipalité, accourue sur les lieux, ne put appaiser momentanément le désordre qu’en faisant murer sur-le-champ les fenêtres du cercle qui avaient été mises en pièces à coups de pierres ; mais l’effervescence populaire se renouvela pendant la nuit. Des ordres furent donnés au régiment de Lyonnais de quitter la ville incontinent et de se diriger en partie sur Lambesc, en partie sur Roquevaire. On craignait que sa présence à Aix ne servît qu’a augmenter la fermentation, peut-être même à amener la guerre civile. Cependant les soldats avaient refusé de prendre parti pour leurs officiers et en amenèrent même, quelques jours après, sept liés et garrotés dans les prisons d’Aix. Ceux-ci étaient accusés d’avoir voulu fondre à main armée sur les habitants et n’en avoir été empêchés que par la résistance énergique d’un sous-lieutenant, M. François Ferriol, mort à Aix en 1813, étant général de brigade en retraite, à l’âge de soixante-quatorze ans.
Des ordres furent encore donnés pour faire venir à Aix au plus tôt quelques cents hommes du régiment suisse d’Ernest, alors en garnison à Marseille, ainsi qu’un détachement de la garde nationale de la même ville. Ces gardes nationaux, auxquels s’étaient joints une foule de malfaiteurs, la plupart Grecs, Génois, Piémontais, etc., dont Marseille abonde, étant arrivés, la première opération des agitateurs fut, dès le plus grand matin du lundi 13 décembre, d’aller se saisir de la personne de M. Pascalis établi depuis plusieurs mois dans la maison de campagne de son ami M. Mignard, située à une lieue de la ville en-dessus du vallon des Pinchinats. On regardait M. Pascalis comme le chef des contre-révolutionnaires, depuis le fameux discours d’adieu qu’il avait prononcés à la tête de plusieurs de ses collègues, à la dernière séance de la chambre des vacations du parlement, au mois de septembre précédent. On l’accusait aussi d’être en correspondance avec les princes frères de Louis XVI, alors émigrés ; de vouloir faire prendre la cocarde blanche dans Aix et dans le reste de la Provence, etc. On aurai dû se souvenir bien plutôt de son Mémoire sur la contribution des trois ordres aux charges publiques, publié en 1787, et qui avait si puissamment contribué à amener cette égalité réclamée par le tiers-état. Averti maintes fois des dangers qu’il courait, principalement par suite des pamphlets de l’abbé Rive, il avait eu le véritable tort de les mépriser et il se repentit trop tard de son aveugle imprudence. Conduit comme prisonnier devant la municipalité, celle-ci crut que ses jours seraient plus en sûreté en le faisant traduire aux prisons alors situées dans l’enceinte des casernes, hors la porte Saint-Jean, et dont elles occupaient une partie. Ce fut un premier supplice pour ce malheureux qui, dans ce trajet, fut accompagné constamment par les cris de çà-ira ! à la lanterne !
Plusieurs personnes furent également recherchées comme complices de M. Pascalis, notamment M. Dubreuil, ancien assesseur, qu’on accusait avoir dit que le sang coulerait dans les rues si on attentait à la vie du premier ; MM. Darbaud et Armand anciens procureurs ; les présidents de Mazenod et d’Albert. Langlèz, père et fils, menuisiers ; Coppet, gantier; Mignard, beau-père de M. d’André, député d’Aix à l’assemblée nationale, et autres. Mais la plupart eurent le bonheur de s’échapper et ceux qui furent arrêtés recouvrèrent leur liberté ainsi que les sept officiers de Lyonnais, lorsque les esprits furent plus calmes. Ce fut dans cette matinée toutefois que l’infortuné marquis de la Roquette, 36 dont nous avons parlé plus haut, fut enlevé de son lit où il reposait paisiblement, et conduit dans les prisons d’où il ne devait sortir que pour aller à la mort. Quel était son crime ? Son cocher avait eu l’affreux malheur, quelques années auparavant, d’écraser un entant sous les roues de sa voiture, et le maître paya de sa vie cette fatale imprudence dont il avait néanmoins dédommagé de son mieux les parents de la victime.
Le reste de la journée ne fut pas moins orageux. A la requête de l’accusateur public, le nouveau tribunal de district qui remplaçait les anciens tribunaux, commença l’instruction d’une procédure sur les évènements arrivés la veille au cercle de Guion, et une quinzaine de témoins ayant été entendus, M. de Guiramand, 37 vieillard de soixante-dix-sept ans, ancien officier d’infanterie et chevalier de Saint-Louis, fut décrété de prise de corps, ainsi que divers officiers du régiment de Lyonnais, prévenus : l’un, d’avoir le premier fait feu sur les membres des deux cercles constitutionnels qui venaient de s’affilier entre eux, lorsque ceux-ci avaient repassé sur le Cours ; les autres, d’avoir également fait feu sur les mêmes personnes, de leur avoir donné des coups d’épée ; enfin, d’avoir voulu entraîner leurs camarades et leurs soldats à venir venger sur les habitants la querelle des habitués du cercle de Guion. Cette procédure fut continuée les jours suivants, et plus de deux cent cinquante témoins furent entendus, toujours sur les évènements du 12 décembre, et jamais sur ceux du surlendemain mardi. Elle fut imprimée dans le temps, 38 et les exemplaires en sont encore assez répandus dans Aix, pour que chacun puisse se convaincre qu’elle n’eut réellement d’autre but que celui d’incriminer les trois victimes dont nous allons parler, les officiers de Lyonnais qui fréquentaient le cercle de Guion, et généralement tous les membres de ce parti, alors désignés sous les noms d’aristocrates et de contre-révolutionnaire, comme ils l’ont été depuis sous celui de royalistes.
Vers le milieu de cette journée de lundi, les Anti-Politiques, toujours mûs par l’abbé Rive, leur président, délibérèrent de faire accélérer pour le lendemain le jugement de M. Pascalis, afin que leurs frères, les Marseillais, pussent emporter chez eux la nouvelle de la fin de cette affaire. Ce sont les propres termes de cette délibération, telle qu’elle fut portée à la société des Amis de la constitution où déjà des Marseillais avaient demandé avec instance que M. Pascalis fût pendu. Le procès-verbal de la séance de cette société constate que des députés ayant été envoyés par elle aux trois corps administratifs, 39 pour les remercier de leur infatigable activité tendante à assurer la tranquillité publique, l’un d’eux répondit que lorsque la patrie est en danger, on peut et on doit outre-passer la loi, ci qu’on lui obéit même en la transgressant. Ces paroles imprudentes, mais proférées sans doute dans de bonnes intentions, puisqu’il s’agissait du maintien de la tranquillité publique, ne portèrent-elles pas leur fruit le lendemain, dans un sens bien opposé, comme on va le voir ?
En effet, le lendemain mardi, 14 décembre, jour à jamais néfaste dans les annales d’Aix, dès huit heures du matin, les méchants s’attroupent en grand nombre sur le Cours et l’on y résout la mort de M. Pascalis. Dès le lundi soir (il faut s’en souvenir) avait paru cet atroce pamphlet de l’abbé Rive, dont nous avons parlé plus haut, 40 intitulé Lettre des vénérables frères Anti-Politiques, etc., à M. Martin, fils d’André, etc.41
On se porte donc, en compagnie des Marseillais, aux casernes où étaient alors situées les prisons, et l’on demande à cris redoublés que la victime soit livrée au peuple. Le détachement d’Ernest, arrivé la veille, ne reçoit aucun ordre de la part des autorités et lorsque, après l’événement, il voulut se plaindre de ce défaut d’ordre pour se justifier de son inaction, les autorités lui répondirent, pour se disculper elles-mêmes, que cet ordre était implicitement renfermé dans celui qui lui avait été donné à son arrivée de veiller au maintien du repos public. Etrange reproche dans la bouche de ceux qui, dans l’instant même, décernaient des couronnes civiques au sous-lieutenant Ferriol et aux soldats de Lyonnais, pour avoir refusé d’obéir à leurs officiers sans une réquisition expresse de la municipalité ! La garde nationale, composée de plus de trois mille hommes, ne reçut d’ailleurs elle-même aucun ordre, et l’on ne peut que déplorer une telle apathie en présence des dangers que courait M. Pascalis.
La municipalité envoie cependant trois de ses membres aux casernes ; mais sur leur route, on leur dit que les prisons ont été violées et que M. Pascalis a été décapité. Ils arrivent néanmoins à leur destination et ils apprennent qu’il n’en est encore rien. Le peuple les entoure et les menace pour qu’ils donnent l’ordre au geôlier de livrer les prisonniers. Ils résistent, et l’on se porte aussitôt dans les habitations voisines des casernes pour chercher des échelles à l’effet d’escalader le mur d’enceinte de la cour des prisons, auquel on tente même de faire une brèche en faisant approcher le canon. Enfin on s’empare des officiers municipaux et l’on prend la main tremblante de l’un deux qu’on force ainsi à tracer sur un carré de papier l’ordre fatal d’ouvrir les prisons.
MM. Pascalis et de la Roquette en sont aussitôt enlevés et traînés sur le Cours où devait se consommer le sacrifice. D’affreux cris de mort les avaient accompagnés depuis leur sortie des prisons, et arrivés sur le Cours, M. Pascalis est pendu le premier au reverbère placé dans la grande allée, devant la maison qu’il habitait (celle de M. de Saint-Julien , un peu au-dessous de la Fontaine-Chaude), après quoi, M. de la Roquette est pendu au réverbère qui se trouvait en face de son hôtel que nous avons indiqué précédemment. Ces malheureux demandent avant de mourir qu’on leur amène des confesseurs, mais leurs assassins leur répondent que c’est-là une vieille coutume abolie par la révolution.
Ceux des officiers municipaux qui étaient demeurés à l’Hôtel-de-Ville, apprenant que les prisons ont été forcées, se mettent en marche pour voler au secours des prisonniers menacés. Mais quand ils arrivent sur le Cours, tout était fini. Espérant cependant que les victimes pouvaient respirer encore, ils veulent faire détacher les cordes : » Oui, s’ écrie un jeune homme ; faites-les descendre, pour que nous portions les têtes à Marseille. » Saisis d’épouvante, les officiers municipaux se retirent, convaincus que leur présence est inutile, et n’ayant plus qu’à gémir sur ces atrocités. Il était alors dix heures du matin.
Quelques heures après, se passe une nouvelle scène d’horreur. On venait d’apprendre que le chevalier de Guiramand, décrété de prise de corps, ainsi qu’on l’a vu, avait été arrêté dans le territoire de Meyreuil, au château de Valbriant, où il s’était retiré après l’évènement du cercle de Guion. Sa mort était résolue. Les méchants se portent en foule à sa rencontre sur le cours Sainte-Anne ; on l’enlève sans peine des mains des dix ou douze paysans de Meyreuil qui l’amenaient dans les prisons, et il est conduit sur le Cours où il subit le même sort que MM. Pascalis et de la Roquette ; en un mot, il est pendu vers le bas du Cours, à un arbre de la grande allée en face de la maison d’Esparron, aujourd’hui de Sinéty.42 Cependant, averties par l’exemple des premières victimes, les autorités auraient dû prendre des mesures pour prévenir ce nouvel assassinat. Mais comme tous les honnêtes gens, les administrateurs eux-mêmes étaient sans doute dans la consternation et l’effroi ;43 car il serait injuste de les soupçonner de connivence avec les meurtriers. Les Marseillais se retirent enfin, emportant avec eux la tête du pendu Pascalis, comme l’appela depuis l’abbé Rive dans de nouveaux pamphlets ; ils enterrèrent néanmoins cette tête, à mi-chemin, dans un champ auprès du relais du Pin, honteux apparemment de rentrer dans Marseille avec un pareil trophée.
Beaucoup de familles avaient déjà quitté la ville à l’époque de ces évènements ; un bien plus grand nombre encore en sortirent aussitôt après et c’est de là, à proprement parler, que date l’émigration qui a si fort accéléré la décadence de la ville d’Aix.
Nous avons dit plus haut que la procédure instruite par le tribunal de district, fut absolument dirigée contre les habitués du cercle de Guion comme étant les premiers auteurs du désordre du 12 décembre, et conséquemment de tous les malheurs qui s’ensuivirent. Mais à qui persuadera-t-on jamais que trente ou quarante personnes réunies en ce moment-là dans ce cercle, aient eu la folle témérité d’en provoquer sept ou huit cents ; et n’est-il pas plus rationnel de croire que parmi celles-ci se trouvaient les chefs des agitateurs qui avaient reçu le mot d’ordre pour fondre sur leurs ennemis, les aristocrates ? Dès lors, les agresseurs furent ceux-là mêmes qui se plaignirent d’avoir été attaqués et qui s’en vengèrent si cruellement. Les officiers de Lyonnais, emprisonnés les jours suivants, demandèrent à fournir la preuve qu’ils n’avaient mis l’épée à la main que pour sauver leur vie menacée, et puisque celle justification leur fut refusée, 44 n’en résulte-t-il pas évidemment qu’on savait bien qu’ils n’étaient véritablement pas les agresseurs ? Toute autre réflexion serait superflue et nous avons hâte d’en finir avec ces horreurs pour continuer notre description historique du Cours.
Sur le coin opposé à ce malheureux cercle de Guion, à l’ouverture de la rue des Grands-Carmes, se trouvait, du temps de l’hôtellerie du Cheval-Blanc, une autre auberge à l’enseigne de la Croix-d’Or que les PP. Grands-Carmes réunirent depuis à leur couvent pour y faire l’entrée de leur cloître, telle qu’elle existait au moment de la révolution. Ces religieux, fondés en 1257 dans l’ancienne ville des Tours, n ‘étaient établis dans le voisinage du palais des comtes de Provence que depuis 1359. 45 Leur couvent s’étendait, quant à sa façade sur le Cours, jusqu’à ces deux petites maisons bâties en pierres de taille de bas en haut et d’une parfaite symétrie qui touchent celle appartenant aujourd’hui à M. Bérage. Ces deux maisons n’en formèrent d’abord qu’une seule qui était la propriété des Séguiran seigneurs d’Auribeau, éteints depuis au-delà d’un siècle, et nous ignorons l’époque où elle a été divisée en deux. La maison Bérage qui suit, appartenait, lors de la construction du Cours, à la famille de Montauron, d’où elle a passé successivement aux Isoard de Chenerilles, aux Le Blanc l’Uveaune, et en 1762 aux propriétaires actuels. Toutes ces maisons dont nous venons de parler, depuis le coin de la rue des Grands-Carmes et l’ancien couvent de ces religieux lui-même, ont été converties, depuis la révolution, en magasins, cafés, bureaux de tabac, etc., et si nous rétrogradons jusqu’à l’hôtel des Princes, par lequel nous avons commencé la description de cette ligne du Cours, nous ne trouvons actuellement que l’hôtel d’Arbaud-Jouques dont le rez-de-chaussée ne soit pas occupé par des industriels de toute nature.
A l’occasion des Le Blanc l’Uveaune dont nous venons de parler, nous devons noter que Jean-Baptiste-Benoît Le Blanc, plus connu sous le nom de Servane qui était celui d’une autre de ses terres, né en 1739 dans la maison en question, et conseiller au parlement, comme l’avaient été son père et son aïeul, fut nommé, en 1792, suppléant à la convention nationale. Mais il n’y fut appelé que deux ans plus tard en remplacement de l’une des victimes de la tyrannie de Robespierre, c’est-à-dire bien après le procès de l’infortuné Louis XVI, en sorte qu’il n’eut aucun vote à exprimer dans cet exécrable procès. C’est ce que nous sommes bien aise de constater pour l’honneur de notre patrie qui, ayant fourni depuis 1789 aux diverses assemblées nationales (à l’exception de la convention) et aux chambres législatives, tant d’hommes de mérite et de talent tels que les Mirabeau, les Bouche, les d’André, les Portalis, les Siméon, les Eméric-David, les Fauris Saint-Vincens, les Thiers, etc., peut se glorifier de n’avoir produit. aucun régicide. Cette remarque n’a encore été faite nulle part et il nous tardait d’avoir l’occasion de la signaler à nos compatriotes.
Les maisons qui suivent, appartenant à la rue Tournefort, nous passerons à l’hôtel du Poët, situé entre cette rue et la place des Carmélites, et dont la principale façade vise sur le Cours. C’était anciennement un moulin à eau construit en dehors des murs de la ville, à la droite en sortant par la porte Saint-Jean, où l’on venait moudre journellement les blés employés par les boulangers, et qui fut acquis, en 1573, par Claude Margalet, célèbre jurisconsulte.46 L’écluse de ce moulin, située à peu de distance
et au midi de la porte de la ville, se prolongeait sous les maisons qui forment actuellement le pâté adossé à l’hôtel du Poët, du côté du levant et même sous les maisons de l’île suivante, visant, d’une part, sur le Pont-Moreau, et de l’autre, sur la rue de La Cépède. Pour franchir cette écluse qui coupait le chemin conduisant à Saint-Maximin et à Toulon, il y avait là un pont en pierres qu’on a appelé depuis lors le Pont-Moreau et dont nous nous occuperons ci-après. Les Margalet possédaient encore ce moulin lorsqu’il fut enclos dans la ville en 1646, mais nous ignorons si c’est d’eux qu’Henri Gautier l’acheta vers 1730.
Henri Gautier, né à Aix en 1676, était, dit-on, premier clerc de Jean-Claude Guyon, notaire de la province, lorsqu’à la fin de l’année 1717, la trésorerie générale des Etats de Provence étant venue à vaquer, il ne se présenta aucun concurrent pour l’obtenir. Dans une assemblée des consuls et assesseur d’Aix, en leur qualité de procureurs-nés du pays, il fut résolu de nommer provisoirement un caissier, et M. Guyon proposa son premier clerc dont il connaissait l’intelligence et la probité. Celui-ci fut donc établi caissier et, quelques mois après, des bailleurs de fonds ayant pris de la confiance en lui, le bail de la trésorerie fut passé à l’un d’eux conjointement avec Henri Gautier qui en fut, en réalité, le gérant. Ce bail fut renouvelé depuis, d’abord sur les mêmes deux têtes, puis sur la sienne seulement, et il exerça ces fonctions jusqu’à la fin de l’année 1750.

Vue du Cours.
(Partie supérieure.)
Ce fut pendant ce long espace de temps qu’il fit une fortune considérable ; qu’il reçut du roi LOUIS XV des lettres d’annoblissement en 1724 ; qu’il acquit successivement les terres nobles du Poët, du Vernègues, de Valavoive, etc., et qu’il fit bâtir la belle maison dont nous parlons. A l’exemple de tous ceux qui l’ont citée dans leurs ouvrages sur Aix, nous lui donnerons le nom d’hôtel, quoiqu’il n’ait ni cour, ni jardin. Son propriétaire acquit enfin une charge de conseiller au parlement pour son fils, maria ses quatre filles dans des familles nobles et mourut en 1757, comblé d années, de biens et de vertus, car il fut toujours aussi probe qu’heureux dans ses entreprises.
Un seul de ses petits-fils se maria, et cette grande fortune a péri avec eux pendant la révolution. L’un d’eux, officier de cavalerie, connu sous le nom du chevalier du Vernègues, 47 a joué un rôle pendant l’émigration, comme agent secret du roi Louis XVIII auprès de diverses cours étrangères. Il avait même épousé une princesse russe parente du Czar, et il est mort sans enfants, à Florence en 1831. Sa correspondance avec son souverain est très curieuse pour l’histoire du temps et nous pensons qu’elle devrait être imprimée.
Nous dirons autre part 48 que du balcon de l’hôtel du Poët, S. A. R. Monsieur, comte de Provence (depuis Louis XVIII) avait vu les jeux de la Fête-Dieu dont on lui donna la représentation en 1777. Nous ajouterons que S. A. R. le comte d’Artois, son auguste frère (depuis Charles X), y fit défiler de même le Guet, dans la nuit du 29 au 30 septembre 1814. 49 Qui ne se rappelle avec la plus vive émotion le joyeux et franc enthousiasme qui animait alors tous les cœurs !.. .. La pharmacie de M. Icard, propriétaire actuel de cet hôtel, le cabinet de lecture, la librairie et la typographie de M. Aubin, où s’impriment les Rues d’Aix, occupent aujourd’hui cette belle habitation. On y jouit d’une vue délicieuse, étant placée à la tête du Cours, en face de deux des allées de cette magnifique promenade.
Passons maintenant à la ligne méridionale 50 bâtie, avons-nous dit, sur la lisière du sol des anciens prés et jardins de l’archevêque et où devait être construite une rue qu’on eût appelée la rue de l’Archevêché. Cette ligne fait suite à l’ancien couvent des Carmélites et aux jolies maisons bâties par ces religieuses sur la place qui porte leur nom, après lesquelles M. le président Bret en a fait construire, il y a peu d’années, une autre fort belle occupée actuellement par un vaste café très fréquenté. C’est la première maison de cette île qui vise sur le Cours où elle se lie a la maison de la famille Bret, à qui appartient aussi l’immense jardin des Carmélites, situé au midi de ces divers bâtiments. C’est le long de ce jardin que passait, avant 1646, le petit chemin qui, au sortir de la ville par la porte Saint-Jean, contournait le moulin de Margalet et se dirigeait vers les Boucheries et Saint- Lazare où il se jetait dans le chemin de Marseille partant de la porte des Augustins. 51
Les deux maisons suivantes avant d’arriver à la rue du Cheval-Blanc ou de la Monnaie, sont les premières qui furent bâties de ce côté du Cours, de 1646 à 1650, par deux riches marchands, Louis Perrin et Prosper Gassendi, qui, en se retirant du commerce, voulurent jouir de l’aisance qu’une honnête industrie leur avait procurée. L’un et l’autre acquirent ensuite des offices de secrétaire du roi et donnèrent ainsi la noblesse à leur postérité ; mais ces deux familles sont éteintes. C’est dans la première de ces maisons qu’était né, le 8 octobre 1681, le chevalier Denis-Marius de Perrin, capitaine au régiment de Péquigny, mort en 1754, décoré de la croix de Saint-Louis.52 On doit à cet aimable littérateur la publication des immortelles lettres de madame de Sévigné à madame de Grignan sa fille, dont il donna quatre volumes en 1734, et deux autres volumes en 1737. Ayant découvert de nouvelles lettres chez madame de Simiane, fille et petite-fille de ces dames, il forma du tout une nouvelle édition qu’il publia en 1754. On regrettera toujours que lorsque les quatre premiers tomes parurent, les lettres de madame de Grignan a sa mère, aient été détruites, sacrifiées, dit-on, à un scrupule de dévotion. Les Meyronnet, marquis de Châteauneuf, conseillers au parlement de père en fils pendant plusieurs générations, acquirent la belle maison des Perrin en 17.. et l’ont possédée jusque dans les premières années de ce siècle, époque à laquelle le fils du dernier d’entre eux, notre ami, a quitté la ville pour s’établir en Champagne, où il s’était marié.
La maison suivante qui fait le coin, bâtie par Prosper Gassendi, appartenait, avant la révolution, à la famille d’Adaoust, tombée depuis en quenouille dans la famille de Saboulin. C’est dans cette maison qu’ont fait leur demeure les trois derniers lieutenants de roi en Provence, où ils commandaient en chef en absence des gouverneurs dont aucun n’est venu dans le pays depuis la mort du duc de Villars arrivée en 1770. Nous nous souvenons d’y avoir vu, dans notre enfance, ces trois derniers lieutenants de roi, M. le marquis de Vogué, chevalier des ordres, etc., M. le comte de Thiard et M. le comte de Caraman. Chacun d’eux y tenait un grand état de maison ; les fêtes s’y succédaient et dans certaines occasions, ce n’était pas la noblesse seule qui y était admise. La bourgeoisie y était reçue dans les bals et les divertissements publics, donnés à raison d’événements heureux arrivés à la France ou au roi et à la famille royale, tels que le gain d’une bataille, une paix, la naissance d’un prince, etc. Des cafés et des magasins ont encore succédé à ces grandeurs passées.
Pierre Manuel, seigneur de Pontevès et de Volone, auditeur à la cour des comptes, acquit, en 1647, cette partie des anciens prés de l’archevêché sur laquelle est bâtie l’île entière du Cours comprise entre les rues du Cheval-Blanc ou de la Monnaie, et celle de Saint-Sauveur ou des Quatre-Dauphins. C’est lui qui fit construire, au coin de la première de ces rues, la maison que possède aujourd’hui M. Giraud-Ginézy, confiseur, et qu’un des fils cadets de Pierre Maurel avait vendue, en 1707, à Joseph Lyon de Saint-Ferréol, fils d’un secrétaire du roi, originaire de Manosque et descendant d’un capitaine Melchior Lyon qui s’était fait remarquer, sous Henri III et Henri IV, par son zèle inconsidéré pour les intérêts de la Ligue. Un autre Joseph Lyon de Saint-Ferréol, petit-fils du précédent, fit reconstruire la maison dont nous parlons telle que nous la voyons et la revendit en 1769, à Jean-Baptiste Reinaud de Fonvert, des héritiers duquel M. Giraud-Ginézy l’a acquise en 1818.
C’est dans cette maison que furent tenues, au mois de février 1789, la plupart des assemblées particulières des députés du tiers-état aux Etats-généraux de Provence alors assemblés à Aix, et dans lesquelles ces députés du tiers-état protestèrent si énergiquement devant M. Silvy, notaire contre la formation de ces Etats-généraux. Le fougueux Mirabeau faisait alors de son côté de semblables protestations contre l’ordre de la noblesse dont il était membre et qui l’avait exclu de son sein, et c’est véritablement de cette époque mémorable que date la révolution qui devait bouleverser le monde entier et amener en particulier la ruine de la ville d’Aix…
Sur la façade méridionale de la même maison, c’est-à-dire du côté du jardin, est un cadran solaire gravé sur une plaque d’ardoise avec cette devise en lettres d’or, qui nous parait intriguer singulièrement les passants qui l’aperçoivent de la rue voisine :
DOMI HORA LEONIS STELLA CORDIS.
Il est évident, ce nous semble, que l’auteur de cette devise a voulu faire un jeu de mots sur le nom du propriétaire de la maison ( Lyon ) et sur l’étoile dite le Cœur du Lion, l’une des plus considérables du firmament. Nous laisserons toutefois à de plus habiles que nous le soin d’en donner une explication satisfaisante d’après les circonstances que nous leur indiquons.
Pierre Maurel vendit à Esprit d’Arnaud, conseiller à la cour des comptes, la partie de son terrain qui sépare la maison dont nous venons de parler de celle qui suivra, et cet Esprit d’Arnaud fit construire le bel hôtel qui passa depuis aux Suffren, marquis de Saint-Tropez, et que possède actuellement M. le marquis de Forbin-d’Oppède. Nous ne saurions dire précisément en quelle année l’acquirent les Suffren, mais il est certain que c’est à eux qu’est due sa reconstruction moderne et qu’ils en étaient déjà propriétaires en 1729, époque de la naissance de l’illustre bailli de Suffren qui y serait né, si sa mère n’eût habité la campagne à cette époque. 53 Mais, comme nous l’avons déjà dit, sa famille étant établie dans Aix depuis le milieu du XVIe siècle et ayant continué d’y faire sa demeure jusqu’à la révolution, on ne saurait nous contester le droit de le compter au nombre de nos plus célèbres compatriotes.
C’est enfin le même Pierre Maurel, sieur de Pontevès et de Volone, qui fit bâtir ce magnifique hôtel, dont la façade est d’une si belle architecture, et qui est situé entre celui de M. d’Oppède et la rue des Quatre-Dauphins. Pierre Maurel était devenu, en 1653, trésorier-général des Etats de Provence, dont il continua les fonctions jusqu’à sa mort, arrivée vingt ans plus tard, et dans cet intervalle il eut l’honneur de recevoir chez lui mademoiselle de Montpensier 54, cousine germaine de Louis XIV, lorsque ce monarque vint en Provence avec toute sa cour, en 1660.
On peut lire dans les mémoires de cette princesse, quelles étaient ses occupations pendant le séjour de deux mois qu’elle fit à Aix où elle reçut la nouvelle de la mort de son père, Gaston-Jean-Baptiste de France, duc d’Orléans, frère de Louis XIII. Si cette partie des mémoires de Mademoiselle était moins longue, nous la rapporterions ici bien volontiers ; mais nous sommes forcés de renvoyer nos lecteurs à l’ouvrage même.
D’autre grands personnages ont été logés dans cet hôtel lors de leur passage à Aix, notamment don Philippe, infant d’Espagne, fils de Philippe V, depuis duc de Parme, de Plaisance et de Guastalla, qui y fut reçu, le 31 mars 1742, avec toute la magnificence imaginable. M. de La Tour, père, alors intendant, premier président du parlement et commandant en Provence, en absence du lieutenant de roi ; le marquis de Pontevès-Buoux et ses collègues, en qualité de consuls et assesseur d’Aix, et comme tels procureurs du pays, étaient allés l’attendre à Tarascon à son entrée en Provence, comme ils furent l’accompagner à Antibes à sa sortie et lui firent les honneurs de la province tant qu’il y séjourna. L’assesseur d’Aix, Le Blanc de Castillon, dont le fils fut depuis procureur-général, le harangua à Tarascon, à Aix et à Antibes. Le parlement et la cour des comptes vinrent le complimenter aussi à l’hôtel de Maurel le lendemain de son arrivée, par l’organe de leurs premiers présidents, MM. de La Tour et d’Albertas, et le même jour il dîna à l’Intendance où était réunie la meilleure société de la ville et des environs. Le 2 avril, un concert lui fut donné dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville, et le prince ne put se lasser de remarquer l’éclat dont brillait alors la capitale de la Provence. Il en partit le lendemain, 3 avril, pour se rendre à Marseille et à Toulon où des fêtes non moins somptueuses lui furent données. 55 On parlait encore à Aix, cinquante ans après, du passage de don Philippe, qui avait répandu tant d’argent dans le pays et qui y avait donné naissance à plusieurs fortunes considérables faites dans les fournitures de vivres et de fourrages dans les transports militaires, etc. La belle tenue de la cavalerie espagnole y était encore un sujet d’admiration et l’on citait cette naïveté d’un bon bourgeois qui, se trouvant sur le Cours dans un groupe de curieux occupés à voir défiler les troupes du prince, s’était écrié :
Que parlez-vous messieurs, d’escadrons ? dites plutôt que ce sont de véritables escadres. 56
Les descendants de Pierre Maurel furent successivement conseillers au parlement pendant plusieurs générations, et le dernier d’entre eux étant mort en 1770, laissa sa grande fortune et l’hôtel dont nous parlons à sa fille unique, mariée depuis 1748 à son cousin de Maurel-Villeneuve de Mons, qui occupait encore cet hôtel avec sa famille à l’époque de la révolution. Mais ayant émigré, la grande partie de ses biens personnels et des biens de sa femme furent vendus, et l’hôtel fut occupé, pendant la révolution, par le tribunal criminel des Bouches-du-Rhône, puis désigné, en 1803, par un arrêté du premier consul Bonaparte, pour le logement de la sénatorerie d’Aix. Restitué plus tard à la famille, comme bien non vendu, il appartient aujourd’hui à madame d’Espagnet, fille de l’avocat-général au parlement, Maurel de Calissanne, frère de feu Mgr l’archevêque d’Avignon, l’un et l’autre derniers mâles de cette puissante maison. Le rez-de-chaussée en est occupé par le cercle de Sextius, qui est, à proprement parler, la suite ou la continuation de l’ancien cercle de Guion.
L’île qui suit et qui sépare la rue Saint-Sauveur ou des Quatre-Dauphins de la rue Saint-Jacques, nous rappelle des souvenirs non moins intéressants que les précédentes. La première maison qui se présente, bâtie vers 1650, par Joseph Courtès, avocat, ayant passé successivement aux familles Moulin et Eyssautier, fut acquise, en 1736, par Antoine de Laugier, seigneur de Saint-André, dont les descendants par femmes la possèdent encore ; car nous avons vu s’éteindre en mâles, de nos jours, trois familles qui l’ont habitée : les Laugier Saint-André , les Bonaud, seigneurs de la Galinière, conseillers à la cour des comptes pendant quatre générations et les Nicolaï, venus d’Arles, fils et petit-fils d’un membre très savant de l’académie des inscriptions et belles-lettres où il fut admis en 1736, étant à peine âgé de vingt ans. Guillaume de Nicolaï, né à Arles, le 16 février 1716, avait formé une bibliothèque riche surtout en manuscrits précieux pour l’histoire du pays, et a laissé, comme monument de son amour pour la patrie, une foule de mémoires imprimés ou inédits concernant la propriété du Rhône que les Etats de Languedoc disputaient à ceux de Provence.
La seconde maison fut bâtie vers la même époque que la précédente, par Maurice et Antoine Traversery, père et fils, qui la vendirent, en 1636, à Noël Gailhard, avocat très distingué, dont nous dirons quelques mots. Né à Aix, le jour de Noël, 25 décembre 1613, il ne tarda pas à se signaler au barreau et il fut deux fois assesseur d’Aix, procureur du pays de Provence, l’une, en 1652-55, l’autre, en 1667-68. La noblesse possédant-fîefs l’ayant choisi pour syndic de robe, il publia, en celte qualité, en 1669, ces fameuses Remontrances au roi pour la révocation des arrêts de son conseil portant réunion à son domaine des terres aliénées et inféodées par les comtes de Provence, 57 et il y joignit en forme de preuves une grande quantité de chartes et de titres en vertu desquels les détenteurs de ces domaines furent maintenus dans leurs possessions. Au nombre de ces pièces, se trouvent notamment le partage de la Provence, fait en 1125, entre les comtes de Toulouse et de Barcelonne ; les testaments des comtes de Provence Raymond-Bérenger IV, Robert, René et Charles III ; divers actes de la reine Jeanne ; l’édit de Charles VIII, du mois d’octobre 1486, portant réunion de la Provence à la couronne de France, etc., etc., ce qui rend encore aujourd’hui ce livre très curieux.
Noël Gailhard, mort dans la maison dont nous parlons, le 23 décembre 1695, lorsqu’il terminait sa quatre-vingt-deuxième année, fut père de Reinaud, seigneur de Chaudon, poète français assez médiocre, né en 1639, mort en 1704 ; et d’Honoré, célèbre prédicateur, né à Aix le 6 novembre 1641, mort à Paris le 11 juin 1727. Il était entré chez les Jésuites à Avignon au mois de novembre 1656 et fit ses quatre vœux à Paris en 1675. Il eut l’honneur de prêcher quatorze carêmes devant le roi Louis-le-Grand, et un autre devant Louis XV. Madame de Sévigné parle de lui plusieurs fois avec éloge et ne craint pas de le comparer à Bourdaloue. Voici une anecdote qu’elle raconte et qui prouve la présence d’esprit de notre compatriote 58 : » Il prêchait le jour de la Toussaint. M. de Louvois vint apprendre que Philisbourg était pris. Le père Gaillard 59 se tut, et après avoir dit tout haut la nouvelle, le roi se jeta à genoux pour remercier Dieu ; et puis le prédicateur reprit sont discours avec tant de prospérité, que mêlant sur la fin, Philisbourg, Monseigneur, 60 le bonheur du roi et les grâces de Dieu sur sa personne et sur tous ses desseins, il fit de tout cela une si bonne sauce que tout le monde pleurait. Le roi et la cour l’ont loué et admiré. Il a reçu mille compliments ; enfin l’humilité d’un jésuite a dû être pleinement contente. »
Cette famille de Gailhard qui avait acquis la seigneurie de Chaudon, est éteinte depuis longtemps et la maison fut vendue, en 1715, à Bernardin Barlatier, depuis seigneur de Saint-Julien, dont l’arrière petite-fille la possède actuellement. Si des liens de parenté et d’amitié n’avaient uni réciproquement nos ascendants maternels, nous parlerions de son frère Théobald de Saint-Julien, dernier mâle de sa famille, enlevé à la fleur de l’âge en 1837, jeune homme de la plus haute espérance, éminemment distingué par ses qualités personnelles, qui fût arrivé à la chambre inamovible quelques années avant sa mort, s’il l’eût voulu, et que les regrets universels ont accompagné dans la tombe. Mais nos éloges pourraient paraître suspects et nous nous tairons…61 Avant de quitter cette maison, nous rappellerons que l’avocat Pascalis en habitait le premier étage depuis plusieurs années, lors de la fameuse catastrophe que nous avons racontée plus haut avec détail.
Nous parlerons moins longuement des maisons suivantes
de la même île, bâties de 1650 à 1660, par Joseph Garnier, procureur au parlement ; Antoine Lambert, bourgeois ; François Lambert, avocat ; Jean André, notaire et greffier de l’archevêché et Honoré Eyguesier, greffier de la sénéchaussée ; sur quoi nous remarquerons que ces maisons ne figurent qu’au nombre de sept ( en y comprenant les deux dont nous venons de parler, de Joseph Courtès et des Traversery ), soit dans les actes de cette époque, soit dans le plan d’Aix, gravé par Louis Cundier, pour être placé en tête de l’histoire de cette ville, publiée par Pitton, en 1666, in-fol. ; tandis qu’aujourd’hui elles se trouvent au nombre de huit, sans que nous puissions indiquer laquelle a été divisée en deux, ni à quelle époque.
Faute d’en avoir vu les titres, du moins de la plupart, nous nous bornerons à dire qu’en 1789, au moment de la révolution, ces maisons appartenaient à madame la marquise de Tulles de Villefranche, née de Ricard de Bregançon, dame de Bedouin, dont le fils a été pair de France sous la restauration ; à M. de Gautier, seigneur d’Artigues et de la Molle, dont les aïeux avaient fourni sept ou huit magistrats, de père en fils, au parlement ou à la cour des comptes, et en qui a fini cette famille ; à M. Jean-Joseph Julien, duquel nous allons faire mention plus bas ; à madame la marquise de Roux de Gaubert fille et petite-fille de deux magistrats du parlement d’Aix, dont ils furent tirés pour être faits premiers présidents de celui de Pau, alors veuve de Nicolas-Henri de Roux de Gaubert, son cousin germain paternel ; à madame de Saurin de Murat, veuve du dernier mâle de cette famille si féconde en personnages d’un haut mérite, desquels nous avons parlé ailleurs ; 62 enfin, à M. le marquis de Gueidan. Cette dernière maison, après avoir appartenu aux conseillers du nom d’Arles ou d’Arlatan de Montaud, fut acquise, en 1681, par Pierre de Gueidan, depuis président à la cour des comptes, aides et finances. Gaspard de Gueidan, son fils, né en 1688, mort président au parlement en 1767, après avoir exercé pendant vingt-six ans les fonctions d’avocat-général en la même cour, se distingua par son savoir et son éloquence, et ce fut en récompense de ses services que Louis XV érigea, en 1752, la baronnie de Castelet en marquisat, sous le nom de Gueidan. Ses discours prononcés au parlement comme avocat-général, ont été recueillis en cinq volumes in-12 (Paris, 1739, 1741, 1745, etc.), et attestent encore les vastes et profondes connaissances de ce magistrat.
Jean-Joseph Julien, que nous venons de citer, était né à Aix, le 10 octobre 1704 et y mourut le 29 mars 1789. Dès son entrée au barreau il se plaça au premier rang et fut nommé par le roi, professeur de droit en l’université de cette ville, en 1732, à son insu et sur la demande de M. de Brancas, archevêque d’Aix et chancelier de cette université, que les facultés réunies remercièrent d’avoir provoqué un tel choix . Nommé assesseur d’Aix, procureur du pays de Provence en 1747 , il en remplit les fonctions pendant sept années consécutives, avec autant d’illustration et de talent que son grand oncle, Antoine Julien mort dans l’exercice de la même charge d’assesseur d’Aix, en 1679. Lors de l’assessorat de Jean-Joseph, la province était dans des circonstances difficiles. Les Autrichiens y avaient pénétré et le soin de l’approvisionnement de l’armée française laissé à l’administration locale, mit dans tout son jour le zèle infatigable et les ressources du génie de Julien. Le roi l’en récompensa par des lettres de noblesse qu’il n’avait point sollicitées, car lorsque le maréchal de Belle-Isle, passant à Aix, lui avait adressé ces honorables paroles : » Le roi sait ce que vous avez fait pour lui, pour son armée, et je suis chargé de vous demander ce qu’après de si utiles services, on pourrait faire pour vous. » – » Rien, monseigneur, avait répondu Julien : on ne mérite pas de récompense pour avoir fait son devoir. » – » Avec des hommes tels que vous, répliqua le maréchal, je comprends la seule distinction qui peut vous convenir. Le roi saura tout, et vous recevrez des preuves de son estime. » – » Ce que vous me dites, monseigneur, est déjà une récompense au-dessus et bien au-dessus des services que je puis avoir rendu » , dit Julien, et il se tût.
C’est ainsi qu’on parlait alors ; il n’en est plus de même aujourd’hui.
» Dans un cas pareil, a dit naguère un homme d’esprit, on demanderait de l’argent, et après avoir obtenu beaucoup d’argent, on demanderait…… encore de l’argent. »
Lors de la dissolution de l’ancienne magistrature en 1771 Julien fut appelé à remplir un office de conseiller dans le nouveau parlement. Mais il sut se tenir en dehors de tous les partis, et lorsque l’ancien parlement reprît ses fonctions en 1775, il continua les siennes dans la cour des comptes, jouissant de l’estime universelle, jusqu’en 1780 qu’il les résigna à son fils en qui sa postérité mâle s’est éteinte pendant la révolution. 63
Jusqu’à la promulgation du Code civil, la Provence a été régie par le droit romain et, dans bien des cas, elle l’était aussi par des statuts particuliers qui dérogeaient au droit commun et qui émanaient de nos anciens souverains, les comtes de Provence ou les rois de France leurs successeurs. Deux avocats provençaux, Louis Masse, du hameau de Chardavon, et Jacques Mourgues, du lieu de Calian, avaient publié, l’un, en 1557 ; l’autre, en 1642, pendant qu’il était assesseur d’Aix, des commentaires sur ces statuts. Mais ces ouvrages étaient loin de répondre à l’importance du sujet et l’on désirait depuis longtemps qu’il fût fait un nouveau commentaire. L’assemblée des communautés de Provence chargea l’ancien assesseur Julien de ce travail important, qui parut en 1778 aux frais de la province, et quelques années plus tard, l’auteur livra à l’impression un autre ouvrage non moins utile que le précédent et dont il existait déjà une infinité de copies manuscrites : nous voulons parler des Eléments de Jurisprudence, excellent, précis du droit romain appliqué à la coutume de Provence, qui fait encore autorité au palais pour toutes les questions de droit ancien ou de droit historique qui sont discutées ou décidées par Julien.
Ce célèbre jurisconsulte n’était pas né dans la maison où il est mort et qui est celle que M. de Laboulie, son petit-fils, occupe actuellement sur le Cours. Il l’avait acquise en 1742, et c’est tout ce que nous en savons, sinon qu’à cette époque elle touchait au levant, la maison appartenant déjà aux Gautier-la-Molle, maintenant à M. Mouranchon, cafetier. C’est dans celle-ci qu’était né, le 3 juin 1779, notre compatriote, le savant orientaliste feu M. le chevalier Jaubert, 64 pair de France, conseiller d’État et membre de l’institut.
Sur le coin de la rue Saint-Jacques qui sépare les hôtels de Gueidan et de Forbin, était placée une lanterne à laquelle fut pendu, le 27 août 1792, le malheureux abbé Vigne (Jean-Gabriel), ancien religieux minime, qui avait refusé de prêter le serment prescrit par la constitution civile du clergé. Une voiture l’attendait à la Rotonde pour aller à Marseille, d’où il avait l’intention de passer à l’étranger. Il traversait imprudemment le Cours pour sortir de la ville, lorsqu’il fut reconnu par quelques méchants qui fondirent sur lui et le pendirent aussitôt à cette lanterne aux cris de çà-ira ; après quoi on coupa la corde et la populace traîna son cadavre à demi-nu par toutes les rues de la ville en lui prodiguant les plus infâmes outrages. Ce digne prêtre avait du talent pour la poésie provençale et quelques Contes de sa composition ont été imprimés après sa mort. 65 Cinq jours auparavant (le 22 du même mois d’août), Félix Mongin, maréchal des logis de la gendarmerie, avait également été pendu à un reverbère par la populace, comme aristocrate, c’est-à-dire comme ennemi de la révolution. 66
Au coin opposé à l’hôtel de Gueidan, est situé l’hôtel de Forbin, le plus vaste sans contredit et l’un des plus beaux qui existent sur le Cours. Il fut entrepris en 1656 par César de Milan, seigneur de Cornillon et de Confoux, conseiller au parlement mais celui-ci était mort l’année suivante, Claude de Milan son fils, depuis président en la même cour, en continua la hausse et le mit en l’état où nous le voyons. Ce président de Cornillon ayant épousé, en 1672, Gabrielle de Forbin, fille unique et héritière de Melchior, marquis de la Roque, aussi président au parlement, joignit à son nom le nom de Forbin qu’ont porté après lui son fils et son petit-fils, successivement grands-sénéchaux de Provence. 67 Le dernier étant mort en 1775, ne laissant que des filles, l’aînée de celles-ci, mariée depuis dix ans auparavant à son parent le marquis de Forbin-la-Barben, recueillît cet hôtel que ses descendants du même nom possèdent encore. Cette dame recueillit également la terre de la Roque-d’Anthéron, voisine d’Aix, où elle donna le jour au dernier de ses fils, le chevalier depuis comte de Forbin, 68 dont les frères et sœurs sont nés à Aix dans l’hôtel dont nous parlons, ou dans celui que le marquis de Forbin, 69 leur père, possédait auparavant, situé dans la rue Mazarine. On sait que le comte de Forbin était écrivain et bon peintre, et qu’il a été pendant longues années directeur des musées royaux, et membre de l’académie des beaux-arts. Mais son plus beau titre de gloire est, à notre avis, d’avoir été l’ami plus encore que le protecteur de notre illustre Granet. 70
Au mois de mars 1701, lorsque les ducs de Bourgogne et de Berri, petits-fils de Louis XIV, passèrent à Aix, revenant d’accompagner le duc d’Anjou, leur frère, sur la frontière de ce beau royaume d’Espagne dont il allait occuper le trône, ces princes furent témoin d’un spectacle nouveau pour eux et lors duquel ils furent placés sur un grand balcon de cet hôtel, ainsi que le raconte un auteur de ce temps-là : 71 » …Ils se rendirent chez madame la marquise de la Roque, pour voir un combat d’oranges qu’on avait préparé pour les divertir. Ou avait orné le balcon de cette maison d’un dais de velours cramoisi, enrichi d’une crépine d’or ; et on l’avait fermé d’un treillis de fer d’archal, pour empêcher que quelque orange ne pût les blesser. Ce combat devait être fait au milieu du Cours, et au-dessous des fenêtres de cette maison entre les deux allées. L’on avait destiné pour cela trois cents combattants, cent cinquante de chaque côté, divisés en rouges et en bleus. Les rouges étaient commandés par M. le chevalier de Saint-Marc, et les bleus par M. de Saint-Louis Duranti. Ces deux chefs étaient distingués par la propreté de leurs habits et par les touffes de rubans qu’ils avaient à leurs chapeaux, et dès que nos princes furent arrivés et qu’ils eurent pris leurs places, le signal ayant été donné, les deux partis s’attaquèrent et se chargèrent si brusquement l’un et l’autre, que bien qu’on eût convenu de faire durer ce plaisir, la troupe que commandait le chevalier de Saint-Marc serra si fort l’autre, qu’après une vigoureuse résistance elle lui fit perdre le terrain et la chassa du Cours sans qu’elle pût se rallier pour y entrer. Nos princes furent si satisfaits de ce divertissement, qu’ils firent présent d’une épée d’or à chacun des commandants et qu’ils remirent deux cents louis d’or à M. le marquis de Regusse (alors assesseur d’Aix), qui les distribua aux rouges et aux bleus pour les consoler des bosses, des contusions et des meurtrissures qu’ils avaient eues en ce choc. »
La comtesse de Grignan, fille de l’illustre madame de Sévigné, était alors à Aix, et en faisait les honneurs avec son mari qui commandait en Provence en absence du gouverneur, le duc de Vendôme. Les dépenses qu’ils firent en cette occasion furent immenses, à en juger par la même relation de Gallaup-Chastueil, et ne contribuèrent pas peu vraisemblablement à la ruine de la maison de Grignan. Peu de personnes, même les plus dévouées, se ruineraient aujourd’hui dans de pareilles circonstances.
Au printemps de l’année 1807, la princesse Borghèse, Marie-Pauline Bonaparte, sœur de l’empereur, fit quelque séjour à Aix et fut logée à l’hôtel de Forbin. Partie de Paris le 9 mai, dans l’intention d’aller prendre les eaux de Gréoux, elle arriva dans cette ville le vendredi 22, avant-veille de la Trinité, dans une espèce de palanquin porté par des hommes, et c’est ainsi qu’elle se promena constamment pendant qu’elle demeura à Aix, allant visiter les lieux de plaisance et les jardins voisins de la ville, tels que le Tholonet, la Pioline, la Mignarde, le cours de la Trinité, etc.- Les hauts fonctionnaires publics de Marseille et de Toulon vinrent lui offrir leurs devoirs, mais comme elle voyageait incognito sous le nom de comtesse de Rossano, qui était celui d’une terre de son mari , elle ne reçut officiellement qu’eux et les chefs des autorités de la ville, c’est-à-dire l’archevêque, les présidents des tribunaux, le sous-préfet et le maire. On parla devant elle de la Fête-Dieu telle qu’on la célébrait à Aix anciennement et elle témoigna le désir de la voir.
Sur ce qu’on lui dit que l’empereur avait refusé d’en autoriser la dépense dans le budget communal : » Qu’à cela ne tienne, répondit-elle, je me charge de tout. » En effet, des préparatifs furent faits aussitôt et le jeudi suivant la mairie procéda avec la plus grande pompe, à la nomination d’un Abbé de la ville, d’un Roi de la basoche, d’un Lieutenant de Prince et de tout le cortège qui devait les accompagner à la procession. 72
Le samedi 30 mai, les jeux des Diables, des Rascassetos, des Apôtres, des Tirassouns, de la Reine de Saba, des Danseurs, des Chevaux-Frux et autres, se répandirent dans la ville, et, à six heures du soir, s’étant réunis sur le Cours, ils exécutèrent leurs jeux, simultanément, puis à tour de rôle, en présence de la princesse assise sur ce même balcon où cent sept ans auparavant se trouvaient les petits-fils de Louis XIV. A la nuit elle vit encore défiler sous son balcon les Bâtonniers ou la Passade de la Basoche, puis celle de l’Abbadie ; enfin, après dix heures, le Guet, composé des divinités du paganisme qui la divertirent non moins que les diables.
Le lendemain dimanche, jour de la célébration de la Fête-Dieu, les jeux recommencèrent, dès le matin, à parcourir la ville, et l’après-midi, l’Abbé, le Roi, le Lieutenant de Prince, leurs Bâtonniers, Guidons et Porte-Drapeaux, précédant la procession, défilèrent de nouveau devant le logement de la princesse, où ils se distinguèrent par leur adresse à manier le bâton, la pique et le drapeau. On intervertit à cet effet le tour ordinaire de la procession qui, arrivée au bas de la rue Beauvezet, passa dans celle de la Masse et le long d’une partie du Cours jusqu’an coin de la rue des Quatre-Dauphins, où elle reprit son tour accoutumé. Un reposoir avait été élevé dans la grande allée, devant l’hôtel de Forbin, et la princesse agenouillée sur son balcon, reçut la bénédiction du Saint-Sacrement que portait Mgr. l’archevêque Champion de Cicé.
Une foule immense d’étrangers accourus de toutes parts, obstruait le Cours et toutes les rues où passait la procession. On n’exagère en portant à plus de dix mille ceux que la ville de Marseille seule avait fournis. On se rappelle que faute de logements, une bonne partie avait passé la nuit en plein air ou sous les tentes construites à la hâte sur le Cours, à la Rotonde, au cours Sextius, sur les aires et les promenades publiques où dans les champs voisins. En un mot, la ville offrit à cette époque le spectacle vivant d’une très grande fête.
Un jeune étudiant en droit, appartenant à une honorable famille de Marseille, y remplit le rôle de Lieutenant de Prince et eut l’honneur d’offrir un bouquet de fleurs à la princesse. On assura dans le temps, qu’il avait dépensé plus de quatre mille francs en habillements, en repas, en cadeaux et tout le fruit qu’il en retira, fut d’être invité à dîner le lendemain, avec son guidon, chez S. A. I. et R. ; mais celle-ci se trouva indisposée et le Lieutenant de Prince et son Guidon ne mangèrent qu’avec les écuyers et les dames d’honneur, ce qui égaya tant soit peu le public à leurs dépens.
La princesse Pauline était malade, en effet, mais moins qu’on ne le craignait. Le mardi, 2 juin, elle alla coucher à la maison de campagne dite la Mignarde, à une petite lieue de la ville, au-dessus du vallon des Pinchinats, et le lendemain elle s’achemina vers Gréoux, avec toute sa maison, après avoir fait compter au trésorier principal une somme de trois mille francs en indemnité des frais qu’avait occasionné la sortie des Jeux, du Guet, de la Bazoche et de l’Abbadie.
Le prince Borghèse venant de combattre à Friedland, arriva à Aix dans la nuit du 10 au 11 juin, allant au-devant de sa femme qu’on savait devoir quitter Gréoux. Les époux se rencontrèrent vers Venelles et descendirent à la Mignarde. Le vendredi 17, ils y donnèrent une fête consistant en bal, concert et feu d’artifice, et qui se prolongea bien avant dans la nuit. Grand nombre de personnes de la ville y furent invitées, mais on remarqua que ce furent principalement d’anciens nobles, hommes et femmes. La bourgeoisie, la nouvelle magistrature, le barreau et le commerce, n’y furent point admis, ou du moins qu’en très petit nombre, non plus que les fonctionnaires publics ; car il n’y parut que M. d’Arbaud-Jouques, alors sous-préfet d’Aix, et M. de Fortis, maire de cette ville. C’est que l’empereur voulait rallier à lui la vieille aristocratie, et il paraît qu’il connaissait parfaitement sa bonne ville d’Aix où l’on aime peu le mélange, surtout parmi le beau sexe.
Le 25 juin, le prince et sa femme quittèrent la Mignarde et allèrent se fixer à Marseille où ils passèrent le mois de juillet. Le 8 août ils revinrent à Aix et repartirent incontinent l’un pour Paris, et la princesse pour la Mignarde où elle demeura encore quelques jours, après lesquels elle se rendit de nouveau aux eaux de Gréoux.
Nous avons dit qu’à Aix, elle chercha à s’entourer exclusivement des anciennes familles nobles. Il est juste de dire que celles-ci ne lui firent pas défaut et répondirent avec empressement à son appel. A l’exception d’un petit nombre, à la ville comme à la campagne, à l’hôtel de Forbin comme à la Mignarde, elles encombrèrent les antichambres, quand elles ne purent pénétrer dans les salons. C’était plaisir de voir telles et telles grandes dames se heurtant, se disputant le pas pour couvrir ou découvrir les épaules de la déesse, suivant que la température haussait ou baissait d’un quart de degré, ou relevant sa chevelure, quand le moindre zéphir l’agitait ; celle-ci fière de porter l’ombrelle pour que le soleil ne ternit pas un si joli teint ; celle-là, heureuse de renouer la ganse d’un soulier, et toutes accablant la belle Pauline de fades compliments sur ses grâces, son amabilité, et surtout sur le grand et invincible empereur.
Les hommes, oh ! les hommes, c’était bien mieux. On en vit, tête nue, haletants, couverts de poussière, inondés de sueur, courant à côté du palanquin dont les malins porteurs se plaisaient à accélérer la marche, et cherchant à se tenir le plus près possible de l’idole, lorsque celle-ci se promenait dans la campagne….
SON ALTESSE IMPÉRIALE ET ROYALE, comme on l’appelait malgré l’incognito, était capricieuse et volontaire. Ayant témoigné sa surprise de l’état de nudité dans lequel se trouvait la vaste cour de l’hôtel de Forbin, il fallut transformer, en quelques heures, cette cour en jardin, soit par l’apport d’une immense quantité de vases de fleurs, soit par la plantation subite d’arbustes et d’arbrisseaux qui flétrirent au bout de quelques jours. Mais, qu’importe, leur verdure dura autant que le séjour de son altesse. – A la Mignarde, le croira-t-on ? des gens à gage furent employés à battre avec des gaules l’eau des bassins et les feuillages des arbres, pour faire taire les grenouilles et les cigales qui pouvaient troubler un sommeil si précieux pour la France.
Ces attentions, ces prévenances, ou si l’on veut, ces flatteries, s’expliquent à l’égard d’une jeune et très jolie femme, sœur bien-aimée d’un souverain, 73 et quel souverain ! Mais comment qualifier celles dont fut l’objet, de la part des mêmes personnes, l’ex-conventionnel, le régicide Fouché devenu sénateur, ministre de la police générale, duc d’Otrante. Disgracié momentanément par l’empereur et relégué dans le chef-lieu de la sénatorerie, il arriva à Aix, le 4 septembre 1810, avec sa famille ; comme l’hôtel de Mons affecté ordinairement à sa résidence, avait été rendu depuis aux anciens propriétaires, ainsi que nous l’avons dit plus haut, il prit son logement à l’hôtel de Forbin. Pendant un an de séjour qu’il fit à Aix (car il ne rentra en grâce et ne repartit pour Paris que le 1er septembre 1811), sa société fut constamment celle dont s’était entourée la princesse Pauline. Les personnes les plus distinguées de la ville allaient journellement lui faire leur cour, et ses salons ne désemplissaient pas de toute la soirée. Que de courbettes ne s’y sont-elles pas faites jusqu’à terre ! Que d’adulations ne s’y sont-elles pas débitées !
Biens des gens prétendent se rappeler que le 1er janvier 1811, Fouché étant à recevoir les visites de félicitation à l’occasion du nouvel an, on se lamentait devant lui sur le froid excessif de la nuit précédente, qui faisait craindre une ruineuse mortalité d’oliviers, sur quoi, un courtisan plus aguerri que les autres, s’écria : » Eh ! que nous importent les oliviers, pourvu que M. le duc se porte bien ! » On comprend que nous ne garantissons pas cette anecdote, non plus que la suivante, qui n’est pas moins curieuse, si elle est véritable. Un autre courtisan du duc s’obstinait à vouloir conduire chez celui-ci un de ses amis qui s’était toujours refusé à aller encenser le régicide. » Je reviendra vous chercher à telle heure, et je vous présenterai, » lui dit-il. – » C’est impossible, répondit froidement l’incorrigible, 74 je suis invité ce soir chez le bourreau. »
Le 1er juillet 1811, deux mois avant son départ, le duc d’Otrante fut chargé d’installer solennellement, comme commissaire de l’empereur, la cour impériale d’Aix dans laquelle entrèrent la plupart des membres encore vivants de l’ancien parlement. Nous ajouterons que pendant son séjour en cette ville, il fit d’abondantes aumônes qui le firent regretter des pauvres. Quelques années plus tard, il devint notre quasi-compatriote, par son mariage avec une demoiselle d’Aix, belle, riche et aimable, appartenant à l’une des plus anciennes et des plus illustres familles de Provence.
D’autres manifestations d’amour de dévoûment absolu et d’inviolable fidélité, plus sincères il faut le croire, que celles dont nous venons de parler, eurent encore lieu dans l’hôtel de Forbin en 1816. Aussi furent-elles adressées à d’autres qu’à ceux que nous venons de nommer tout à l’heure.
Il y avait déjà deux ans que la France entière avait salué avec des transports d’allégresse, le retour si désiré de ses princes légitimes. Autant et peut-être plus qu’aucune autre, la population d’Aix avait mêlé ses acclamations à celles du peuple français. Il importe à l’honneur de notre ville de le rappeler et de le constater en caractères ineffaçables, actuellement qu’une grande partie de ceux qui l’ont vu et entendu existent encore et que les dénégations seraient impossibles. On se souviendra longtemps et les futurs historiens d’Aix rediront à jamais, qu’à la rentrée des Bourbons en France, en 1814, notre ville, comme toutes les villes et les campagnes, surtout en Provence, retentirent au loin des cris de joie que ce retour inespéré faisait naître. Ce ne furent partout, pendant plusieurs mois, qu’illuminations générales, drapeaux blancs aux fenêtres, arcs-de-triomphe, salles et guirlandes de verdure, danses, repas et chants joyeux. Ou se félicitait dans les rues comme dans les salons ; les personnes inconnues entre elles s’abordaient pour se tendre la main et s’embrasser ; les inimitiés avaient disparu ; tous les cœurs étaient ouverts à la joie ; les habitants ne formaient plus qu’une seule famille. Tous avaient éprouvé durement la tyrannie de Bonaparte, quelle que fût la gloire dont il avait su l’entourer, et tous espéraient le bonheur.
L’affreux orage des Cent-Jours vint assombrir l’horizon et interrompre les heureux jours dont nous commençions à jouir mais il fut bientôt dissipé, et la ville d’Aix n’eut à rougir d’aucun des excès qui malheureusement ensanglantèrent quelques villes du Midi, lors de la seconde restauration. Grâce au gouvernement paternel de Louis XVIII, ces nouveaux troubles s’appaisèrent insensiblement, et rien ne manquait plus à la félicité de la France qu’un mariage qui pût donner de nouveaux rejetons à la famille royale.
L’auguste princesse Caroline de Naples, destinée à devenir l’épouse du duc de Berri, débarqua sur la fin du mois de mai 1816, à Marseille, où les fêtes les plus splendides lui furent données, et le troisième jour de juin, vers les cinq heures du soir, elle fit son entrée solennelle à Aix, où elle fut reçue avec non moins d’enthousiasme que ne l’avait été en septembre 1814, Mgr. le comte d’Artois, son futur beau-père. La princesse descendit à l’hôtel de Forbin, traversant une foule immense ivre de joie et de bonheur, et après avoir reçu les félicitations de la cour royale et de tous les corps, elle se montra au peuple, sur le balcon de l’hôtel. Elle était entourée de la plus haute société de la ville, composée, en général, des mêmes personnes qui, neuf ans auparavant, avaient encensé la princesse Pauline. 75 Mais celte seconde fois, ces personnes étaient à leur place, ce dont nous pouvons affirmer avoir entendu faire la remarque par la foule bourgeoise et plébéienne qui remplissait le Cours. Les acclamations universelles, les cris unanimes de Vive le Roi ! Vive le duc de Berri ! Vive la princesse Caroline ! ne cessèrent pas un instant de se faire entendre, et se renouvelèrent dans la soirée, à la salle de spectacle où se rendit la future duchesse, pour satisfaire aux vœux du public. En un mot, les beaux jours de 1814 semblèrent renaître dans cette journée, et nul ne prévoyait qu’un voile funèbre ne tarderait pas à descendre sur la princesse.
L’hôtel de Forbin fut encore honoré, quatorze ans plus tard, de la présence d’un prince auguste, S. A. R. Mgr. le duc d’Angoulême, duquel nous avons parlé plusieurs fois et qu’on nommait M. le Dauphin, depuis que le roi Charles X avait succédé à Louis XVIII. Ce fut le 1er mai 1830, que M. le Dauphin, se rendant à Toulon pour inspecter la flotte que le roi envoyait à la conquête d’Alger, s’arrêta quelques heures à Aix chez le marquis de Forbin. Il y reçut la cour royale et les autres autorités admises à l’honneur de lui présenter leurs félicitations et leurs vœux pour le succès d’une expédition qui devait enrichir la France d’une superbe et fertile colonie.
Cinq jours après, le dimanche 6 mai, le prince revenant de Toulon, reparut à Aix où il devait inspecter la partie du corps d’armée destinée à cette expédition cantonnée soit dans notre ville même, soit dans les villages environnants. Cette revue eut lieu le même jour, dans la vaste plaine voisine du Grand-Pont, sur la route d’Aix à Avignon, entre les domaines du Seuil et de la Bargemone, vers les limites des territoires d’Aix et de Saint-Cannat. Plus de trente mille spectateurs accourus de toutes les contrées voisines, s’y trouvaient réunis à la majeure partie de la population de la ville. Tous saluaient avec enthousiasme, dans la personne du prince, cette dynastie si française, si pleine d’amour pour la France, que, moins de trois mois après, l’imprévoyance et l’impéritie d’une part,
l’ingratitude et la perfidie de l’autre, devaient renverser du trône et envoyer en exil. 76
Trois grandes et superbes maisons suivent l’hôtel de Forbin, et l’on ne saurait dire pourquoi elles ne portent pas comme lui le nom d’hôtel si ce n’est qu’avant la révolution leurs propriétaires n’avaient pas voulu apparemment le leur donner.
La première fut bâtie en 1657, par Esprit Le Blanc, depuis seigneur de Ventabren, dont les descendants ont fourni plusieurs conseillers au parlement. Le dernier d’entre eux, mort en 1777, est l’aïeul maternel de M. le chevalier Charles de Meyronnet Saint-Marc qui possède actuellement cette maison, et de M. Philippe de Meyronnet, baron de Saint-Marc, longtemps procureur-général à la cour royale de Besançon, sous la restauration, aujourd’hui conseiller à la cour de cassation.
C’est là que logeait, en 1830, M. le président de la Cheze-Murel, d’une ancienne et honorable famille du Quercy, magistrat intègre et éclairé, dont la restauration avait enrichi la cour royale d’Aix quelques années auparavant, et qui n’hésita pas à se retirer dans ses foyers lors de la révolution de juillet. La magistrature et les justiciables du ressort, à quelque opinion qu’ils appartiennent, ne cessent de le regretter depuis lors, et la haute société de cette ville, ne regrette pas moins madame son épouse, née de la Vergue de Juliac, tante de Mgr. Darcimoles, actuellement archevêque d’Aix.
La maison qui touche, celle des Le Blanc-Ventabren, fut bâtie au plus tard en 1658, par Melchior Grognard, trésorier-général de France, qui mourut en 1688 ; elle fut vendue, à cette époque, à Alexandre de Roux, seigneur de Gaubert, conseiller au parlement, depuis premier président de celui de Pau.
Antoine Constans, aussi trésorier-général de France, l’acquit alors et la revendit, en 1736, à Jean-Antoine de Riquetti, marquis de Mirabeau, comte de Beaumont, etc., qui mourut l’année suivante. Victor de Riquetti, son fils, marquis de Mirabeau, connu depuis sous le nom de l’Ami des Hommes, et plus encore pour avoir donné le jour au fameux comte de Mirabeau, la possédait lorsqu’il vint en Provence avec le poète Lefranc de Pompignan, auteur du Voyage de Languedoc et de Provence, dont nous avons parlé plus haut. Les voyageurs, venant de Mirabeau, arrivèrent à Aix le même jour que le cardinal d’Auvergne, qui revenait de Rome et du conclave où avait été élu le pape Benoît XIV, et tous, dit plaisamment Pompignan, firent leur entrée par ce Cours si renommé :
Que les balcons et les portiques
De vingt hôtels magnifiques
Ornent en divers endroits.
Ces lieux, dit-on, autrefois
Étaient vraiment spécifiques
Pour rendre plus prolifiques
Les moitiés de maints bourgeois.
Mais maintenant, moins gaulois
Ils savent mieux les rubriques
Et les maris pacifiques
Reçoivent l’ami courtois
Dans les foyers domestiques.
L’Ami des Hommes préférait le séjour de Paris à celui de la Provence, et vendit sa maison d’Aix, en 1745, à Louis de Bouchet, seigneur de Faucon, conseiller au parlement, lequel l’ayant habitée pendant vingt ans, la revendit, en 1765, à Joseph Lyon, seigneur de Saint-Ferréol et de Pontevès, 77 trésorier-général des Etats de Provence, qui la fit reconstruire en l’état où nous la voyons aujourd’hui.
M. de Saint-Ferréol ayant perdu ses deux fils et ses deux gendres dans les premières années de la révolution ; étant éloigné de ses deux filles, dont l’une était émigrée avec ses enfants, et l’autre vivait à vingt lieues d’Aix avec les jeunes orphelins que lui avait laissés son mari mis à mort à Lyon pour avoir porté les armes contre la république, lors du siège de cette ville ; M. de Saint-Ferréol, disons-nous, fut emprisonné comme suspect, sur la fin de l’année 1793, quoiqu’il fut alors âgé de quatre-vingts ans et qu’il eût donné, dans l’espérance de se sauver avec sa fortune, diverses preuves de civisme qui lui furent conseillées par la peur et à la sincérité desquelles personne ne crut. Mis en liberté, ainsi que les autres suspects, quelques mois après la mort de Robespierre, il rentra chez lui, seul, isolé, vieux et impotent. Nous étions à peu près le seul parent qu’il eût à Aix, comme étant petit-fils d’une de ses sœurs, ou du moins le seul auquel il eut quelque confiance, et pendant les trois dernières années de sa vie, nous lui timmes journellement compagnie, lui faisant la lecture, écrivant sa correspondance avec ses fermiers. Il nous faisait, en retour de nos petits services, le récit des temps passés, comme font ordinairement les vieillards, et il nous racontait des anecdotes auxquelles nous prenions grand plaisir. En voici deux des plus curieuses :
Lors du célèbre procès du P. Girard et de Catherine Cadière, tous les esprits étaient divisés d’opinions ; les familles même étaient désunies entre elles. Les uns intriguaient pour le jésuite, les autres en faveur de sa pénitente. L’arrêt du parlement du 10 octobre 1731, qui mit les deux accusés hors de cour, surprit également les deux partis et n’en satisfit aucun. Vingt-quatre juges avaient été d’avis de faire brûler le P. Girard, et vingt-quatre autres de condamner la Cadière ; mais celle-ci avait dans le public un plus grand nombre de partisans que n’en avait le jésuite, et le premier président Le Bret, protecteur déclaré du P. Girard, fut hué ainsi que les juges de son opinion, tandis que le président de Maliverny, chef du parti opposé, et tous les siens, furent accueillis par de nombreux applaudissements. Pour s’en venger, M. Le Bret sollicita et obtint du ministère des lettres de cachet , au moyen desquelles les principaux partisans de la Cadière furent exilés loin de la ville, ceux-ci dans tel lieu, ceux-là dans tel autre. Il en sollicita même secrètement une contre madame de Simiane, Pauline de Grignan, petite-fille de madame de Sévigné, qui faisait sa demeure à Aix, depuis la mort de son mari, gentilhomme du duc d’Orléans, et lieutenant de roi en Provence. Mais madame la duchesse de Modène, Charlotte-Aglaé d’Orléans, fille du régent, avait détourné le coup et s’était même emparée des lettres de M. Le Bret contre madame de Simiane.
Or, il arriva, nous disait M. de Saint-Ferréol, que la duchesse de Modène passant en Provence et retournant dans sa principauté, combla d’amitiés madame de Simiane qu’elle appelait sa chère maman. Le premier président s’étant trouvé un jour en tiers avec cette dame chez la princesse : » Que diriez-vous, monsieur, lui dit celle-ci, d’un homme qui, ayant sollicité les rigueurs de la cour contre une personne d’une opinion opposée à la sienne, accablerait néanmoins cette personne de prévenances et de marques d’attachement ? » – » Je dirais, » répondit M. Le Bret, que cet homme est un monstre. – » C’est vous qui l’avez dit, répliqua la princesse, et vous êtes ce monstre. Voilà les lettres que vous avez écrites contre ma » chère maman. » Atterré de ce coup inattendu et semblable à celui de la foudre, le premier président se retira et mourut peu d’heures après, à pareil jour qu’il avait signé, trois ans auparavant, l’arrêt du P. Girard et de la Cadière. 78
Lorsque le maréchal de Belle-Isle vint en Provence en 1747, pour s’opposer à l’irruption des Autrichiens, nous disait aussi M. de Saint-Ferréol, toute la noblesse du pays vint se ranger en foule autour de lui. Parmi ceux qui accoururent des premiers se trouvait M. de Roquesante (Michel-Jules de Raffelis, seigneur de Grambois), petit-fils de ce vertueux magistrat, qui s’était fort signalé en 1664, par sa noble et hardie opinion dans le procès du surintendant Fouquet. 79 Quelqu’un de la compagnie, voyant que le maréchal ne le connaissait pas, crut faire plaisir à celui-ci en lui nommant le petit-fils de celui à qui son aïeul avait dû la vie. Mais le maréchal, habile courtisan, feignit de n’avoir pas entendu et tourna la tête d’un autre côté, dans la crainte de se compromettre s’il disait un mot de bienveillance au descendant d’un homme que la cour avait proscrit quatre-vingts ans auparavant.
M. de Saint-Ferréol mourut au mois de février 1798, le dernier mâle de sa famille, aucun de ses deux fils n’ayant été marié, non plus que son frère puîné, François-Joseph Lyon de Saint-Ferréol, second consul d’Aix, procureur du pays en 1787 et 1788, qui avait fait partie de la seconde assemblée des notables du royaume, en qualité de député des États de Provence, pour l’ordre du tiers-état, et qui mourut à Saint-Tropez où il s’était retiré pendant la terreur.
Le baron de Fabry acquit la maison Saint-Ferréol en 1820,étant alors premier président de la cour royale d’Aix, et en jouit malheureusement peu de temps, étant mort quatre ans après, fort jeune et emportant les regrets universels. MM. ses fils la possèdent actuellement.
Celle qui est située au-dessous fut bâtie vers 1660, par Honoré de Rascas, seigneur du Canet, conseiller au parlement mort en 1668. Son neveu et héritier, nommé comme lui, Honoré de Rascas, seigneur du Canet, grand-sénéchal au siége de Draguignan vendit la maison dont nous parlons, en 1698, à Silvy de Raousset, comte de Boulbon, ancien premier consul d’Aix, procureur du pays, alors président au parlement. C’est du petit-fils de ce dernier que l’acquit, en 1759, Antoine de Fauris, seigneur de Saint-Vincens, conseiller à la cour des comptes, aides et finances, père et aïeul des deux présidents au parlement, Jules-François-Paul et Alexandre-Jules-Antoine de Fauris Saint-Vincens, desquels nous allons parler.
Jules-François-Paul, né le 21 juillet 1718, mort le 23 octobre 1798, fut d’abord conseiller au parlement, ensuite président à mortier en 1746, associé-correspondant de l’académie des inscriptions et belles-lettres, etc., etc. Magistrat intègre et éclairé, savant antiquaire et bon littérateur, il avait formé à Aix le plus beau cabinet qui y existât de son temps. C’est lui qui fit élever, en 1777, dans l’église des Dominicains, un monument sur la tombe du grand Peiresc, 80 dont cette église possède les restes mortels ; sur quoi l’abbé Barthélemy, son ami, lui écrivit : » Vous venez de payer la dette du siècle dernier. » Le président de Saint-Vincens le père, avait publié de son vivant un Mémoire sur les monnaies de Marseille, avec planches, et en avait composé un autre sur celles des comtes de Provence, qu’il remit au P. Papon, et que celui-ci a inséré dans son Histoire de Provence. Il était en correspondance avec un grand nombre de savants nationaux et étrangers, et il était justement considéré comme un digne successeur des Mazaugues et des Peiresc. 81 Il avait épousé Julie de Villeneuve-Vence, petite-fille de madame de Simiane (Pauline de Grignan, petite-fille elle-même de madame de Sévigné).
Son cabinet si curieux et si riche en antiquités, en médailles et autres raretés, passa, après sa mort, à son fils, Alexandre-Jules-Antoine de Fauris, né le 3 septembre 1750, mort le 15 novembre 1819, qu’on appela M. de Noyers tant que vécut son père, 82 et qui ne prit le nom de Saint-Vincens que quelques années plus tard. Il avait été d’abord conseiller à la sénéchaussée et fut reçu président à mortier survivancier, en 1782.
Digne héritier des vertus et des connaissances de son père, il a publié ou a laissé en manuscrits un grand nombre de mémoires sur le pays, dont on peut voir la liste dans les deux notices que nous citons ci-dessous, 83 et il a fait connaître au public de nombreuses et intéressantes lettres de Peiresc, à divers personnages de son temps. M. Millin étant venu visiter son cabinet en 1805, en a donné une description très étendue, dans laquelle entre naturellement l’éloge de M. de Saint-Vincens et de son père. 84
Moins grave et peut-être moins profond que lui, M. de Saint-Vincens le fils avait plus de liant dans le caractère et plus de vivacité dans l’esprit. Il plaisantait agréablement de tout et sur tout ; sur les choses comme sur les hommes, et quelques fois sur lui-même, lorsqu’il n’avait personne là qu’il jugeât digne de ses brocards. » Comment trouvez-vous mon air martial et mon épée ? » disait-il, lorsque l’empereur l’eut fait maire d’Aix en 1808 et 1809. M. Thibaudeau était alors préfet du département et fit un voyage à Paris. Un conseiller de préfecture le remplaça momentanément. C’était un vieux citoyen d’Aix qu’un procès pour cause d’impuissance, que lui avait fait sa jeune femme, avait singulièrement ridiculisé dans le public avant la révolution. Il signait donc la correspondance préfectorale, et chaque matin M. de Saint-Vincens nous disait : » Voyons, mon cher Roux, ce que m’écrit aujourd’hui le préfet postiche. » Parlant de MM. les adjoints qu’il consultait volontiers dans les principaux actes de son administration, mais qui arrivaient souvent plus tard que lui à la mairie, ce qui l’impatientait fort, il nous disait alors : » Bah ! je vois qu’ils ne servent qu’à allonger, comme à l’orgue de l’office ; passons-nous d’eux. »
Il entrait à l’Hôtel-de-Ville à dix heures précises et n’en sortait qu’a deux, ayant accueilli familièrement tous ceux qui s’étaient présentés à lui, à quelque condition qu’ils appartinssent. Aussi fut-il vivement regretté, surtout par le pauvre, lorsque l’empereur l’appela au corps législatif dans l’intention de lui procurer d’assez forts émoluments que son inépuisable charité et le dérangement de sa fortune, dans le service des hôpitaux, rendaient véritablement indispensables pour lui. Il entra, en 1811, en qualité de second président à la cour impériale, ayant refusé, plus anciennement, la première place, et mourut second président à la cour royale ne laissant point d’enfants. Après lui, le beau cabinet que son père avait passé sa vie à former et que lui-même avait augmenté, fut acheté par le département. Les livres furent envoyés à Arles ; les médailles à Marseille ; les antiquités et les manuscrits demeurèrent à Aix, où ils sont encore, les unes au Musée, les autres à la bibliothèque Méjanes.
Vingt-quatre ans après la mort de cet homme vertueux, l’académie d’Aix, dont il avait été l’un des membres fondateurs, vota l’érection d’un monument à sa mémoire, 85 et le conseil municipal ayant concédé un terrain à perpétuité dans le nouveau cimetière, au nom de la cité reconnaissante, la translation solennelle des restes de M. de Saint-Vincens eut lieu le 28 juin 1843.
La maison que son père et lui avaient occupée sur le Cours, fut vendue, en 1835, à M. Fabry, conseiller à la Cour royale.
Celle qui la suit et qui fait le coin dans la rue Saint-Lazare, fut bâtie, en 1660, pour servir de logement aux religieuses Bénédictines, que le cardinal Grimaldi, archevêque d’Aix avait transférées dans cette ville du monastère de la Celle, près de Brignolles, comme nous le dirons plus bas ; et lorsque ces religieuses eurent bâti, en 1681, le magnifique couvent qu’elles habitaient encore au moment de la révolution, cette maison fut vendue à M. Sauvaire, avocat. Elle passa depuis à M. de Malignon, ensuite aux d’Antoine-Venel qui, après avoir fourni cinq conseillers à la cour des comptes, de père en fils, étaient tombés en quenouille dans l’ancienne famille de l’Évêque, pareillement éteinte aujourd’hui.
La dernière île de maisons dont il nous reste à parler, est bâtie sur un vaste terrain que Louis de Vendôme, duc de Mercoeur et d’Étampes, puis duc de Vendôme, gouverneur de Provence et cardinal, avait acquis dans l’intention d’y faire construire un palais où il projetait de faire sa résidence. Mais sa mort, arrivée à Aix le 6 août 1669, 86 l’empêcha de réaliser ce dessein, qui ne fut pas suivi par Louis-Joseph, duc de Vendôme et de Penthièvre, son fils et son successeur au parlement de Provence. Celui-ci ne fit jamais que peu de séjour dans ce pays, où commanda en son absence, pendant longues années, François de Castellane-Adhémar de Monteil, comte de Grignan, époux de l’aimable fille de madame de Sévigné. Le comte de Grignan faisait sa demeure au palais de justice qu’avaient bâti et habité les anciens comtes de Provence, 87 et le terrain dont nous parlons fut inoccupé jusqu’en l’année 1693, époque à laquelle le duc de Vendôme le vendit à Pierre de Creissel , alors trésorier-général de France au bureau des finances d’Aix, 88 depuis trésorier-général des Etats de Provence, enfin conseiller au parlement, mort en 1702, à la fleur de l’âge. Pierre de Creissel l’avait déjà divisé en plusieurs parties sur le sol desquelles furent construits, peu d’années après, les quatre beaux hôtels dont nous allons parler.
Le premier, qui fait le coin de la rue Saint-Lazare, fut bâti, en 1710, par François de Boniface-Laidet, seigneur de Peynier et de Fombeton, conseiller au parlement, qui le vendit, en 1751, à l’avocat-général Gaspard de Gueidan, dont nous avons parlé naguère et onze ans plus tard celui-ci le revendit à Jean-Baptiste de Bruni, marquis d’Entrecasteaux, etc., président au parlement, père du célèbre contre-amiral, Joseph-Antoine de Bruni d’Entrecasteaux, né dans cette terre et non à Aix, vers 1739, et dont on peut lire l’éloge dans la Biographie universelle de Michaud. 89
Jean-Baptiste de Bruni et son fils aîné, qui lui avait succédé en 1756 dans la charge de président au parlement et qui périt, en 1794 , sur l’échafaud révolutionnaire d’Orange, 90 habitaient encore cet hôtel lorsqu’un crime inouï y fut commis, peu d’années avant la révolution. Nous n’en eussions peut-être rien dit, comme n’étant ni assez ancien ni assez nouveau, si un événement pareil et tout récent, arrivé à Paris dans l’hôtel du maréchal Sébastiani, 91 n’était venu réveiller des souvenirs mal éteints et affliger en même temps plusieurs famillesrecommandables. L’horrible assassinat de madame la duchesse de Choiseul-Praslin a rappelé celui de la présidente d’Entrecasteaux, et quelques journaux ont cru pouvoir, en parlant de l’un, parler également de l’autre. Mais des erreurs ayant été commises par ces journaux dans la relation de ce fait, le Mémorial d’Aix du 24 octobre 1847 les a rectifiées et a donné des détails curieux et peu connus, dans un article anonyme que nous allons reproduire.
» L’article qu’ont publié successivement depuis quelques jours le Journal des Villes et des Campagnes et le Censeur, journal de Lyon, sous le titre de : Madame d’Entrecasteaux et Madame de Praslin, est rempli d’inexactitudes qu’il importe aux journaux de la localité de signaler. Ce fut dans la nuit du 30 au 31 mai 1784, du dimanche au lundi de la Pentecôte, (et non en 1785), que madame la présidente d’Entrecasteaux (Angélique Pulchérie de Castellane-Saint-Juers) fut égorgée dans son lit, au premier étage de son hôtel, situé vers le bas du Cours à Aix. L’assassin lui coupa la gorge avec un rasoir qui fut retrouvé, non à cette époque et dans le fond d’un puits, comme le dit l’auteur de l’article en question, mais environ vingt-cinq ans plus tard, lorsque M. Meyffret, juge au tribunal d’appel d’Aix, occupant le rez-de-chaussée de l’hôtel d’Entrecasteaux et faisant replanter le jardin, les ouvriers rencontrèrent dans la terre l’instrument du crime.
L’assassin demeura inconnu pendant deux jours ; mais le lieutenant-criminel à la sénéchaussée d’Aix, M. Lange de Saint Suffren, n’avait pas tardé si longtemps à signaler le président d’Entrecasteaux lui-même comme étant le meurtrier de sa femme.
Celui-ci était un jeune homme de vingt-six ans, 92 qu’on a dit faussement être le frère du contre-amiral d’Entrecasteaux et qui était son neveu. Il avait une physionomie des plus heureuses, il était aimable et spirituel ; mais il nourrissait dans son cœur une passion criminelle pour une dame amie de la présidente et qu’il est inutile de nommer, puisqu’elle ne fut nullement impliquée dans la procédure qui s’instruisit bientôt après. L’article que nous relevons l’appelle la présidente de Cubre (pour dire de Cabre) ; mais c’est encore une erreur : madame de Cabre ne fut jamais pour rien dans cette horrible affaire.
Le lieutenant-criminel ayant communiqué ses soupçons à M. de Castillon, procureur-général au parlement, ce grand magistrat fit aussitôt évoquer l’affaire devant la cour, et ce fut dans les premiers moments de l’instruction qu’un parent de M. d’Entrecasteaux (et non M. de La Tour, premier président du parlement) dit au prévenu : Voilà une bourse pleine d’or, prenez-là et fuyez au plus tôt si vous êtes coupable. Si vous êtes innocent allez vous constituer prisonnier. » M. d’Entrecasteaux prit la bourse en pleurant et partit en poste pour Nice, échappant aux cavaliers que le parlement envoya sur-le-champ à sa poursuite.
De Nice, il passa à Gênes où il s’embarqua sur le vaisseau Ragusais la Parthénope, sous le nom du chevalier Jean-Baptiste de Barail, enseigne du régiment du roi, en France, âgé de vingt-six ans, natif de Metz, et fils de M. Jean-Paul de Barail. La Parthénope arriva à Lisbonne le 17 juillet 1784, après trente-deux jours de navigation, et le surlendemain 19, le chevalier de Barail fut arrêté par ordre de la reine de Portugal, à la demande de l’ambassadeur de France et traduit dans la prison dite de Limoéiro où depuis il fut constamment gardé à vue. On trouva sur lui une montre à la chaîne de laquelle pendait un cachet aux armes de la famille d’Entrecasteaux. Ces objets furent envoyés au greffe du parlement d’Aix et joints à la procédure.
» Le prétendu chevalier de Barail fut bientôt reconnu pour être le président d’Entrecasteaux d’après les signalements envoyés de France, et lui-même avoua qui il était aux personnes qui le visitèrent disant qu’il avait changé de nom pour n’être reconnu. – Onze mois plus tard, il fut atteint dune fièvre maligne dont il mourut dans la même prison de Limoéiro, le 6 juin 1785. L’abbé Grenier, chapelain de la nation française à Lisbonne, l’assista dans ses derniers moments. L’écuyer de S. M. très fidèle, Laurent-Anasthase-Michia Galvao, parent des d’Entrecasteaux voulut le faire inhumer dans le caveau de sa famille, dans l’église de Saint-Pierre-d’Alcantara et envoya à cet effet un carrosse de la maison royale pour transporter le corps ; mais cela n’eut pas lieu : un ordre de la cour étant arrivé portant que l’inhumation serait faite sans ostentation dans l’église de Saint-Martin, qui est la paroisse de la prison, où le défunt fut enseveli, le 17 juin, en habit de religieux de Saint-François.
Cependant le parlement d’Aix n’avait cessé de solliciter avec instance de son souverain une demande à la cour de Portugal en extradition du prisonnier que la procédure désignait comme coupable. Mais n’ayant pu l’obtenir, par arrêt rendu par contumace, les chambres assemblées, le 17 novembre 1784, le président d’Entrecasteaux fut condamné à avoir les deux poings coupés, à être ensuite rompu vif et à expirer sur la roue.
Tous ces faits résultent de la procédure et d’une foule de pièces authentiques émanées du consulat-général de France en Portugal et qui existent encore avec la procédure et l’arrêt au greffe de la cour royale d’Aix, où sont conservées les archives du parlement. Des romanciers sont venus, il y a quelques années, qui, connaissant le fond de l’affaire, mais ignorant les détails, en ont créé d’imaginaires propres à captiver la curiosité du public. 93 Une catastrophe récente, l’assassinat de madame la duchesse de Praslin, semblable à celui de madame d’Entrecasteaux, va faire naître de nouveaux romanciers qui, renchérissant sur les premiers, broderont à leur guise cette affaire qui devrait être oubliée depuis longtemps, comme s’oublient bientôt les affaires de même nature qui se déroulent chaque jour devant les cours d’assises. Nous finirons en rapportant les paroles de l’auteur des Essais Historiques sur le parlement de Provence, à l’occasion de ce déplorable événement : » Quelques pressantes que fussent les charges qui pesèrent sur lui (le président d’Entrecasteaux), quelque consistance que leur donnât sa fuite ; il ne faut cependant pas confondre une condamnation par contumace avec celle qui est le résultat d’un examen contradictoire. L’humanité les distingue, pour laisser à une famille honorable et malheureuse la consolation de pouvoir dire que, si l’accusé s’était fait entendre, il serait peut-être parvenu à détruire ou à affaiblir les reproches dont une procédure sans contradicteurs avait armé l’opinion publique. » C’est ce qu’avaient déjà établi en droit, dans une consultation lumineuse, trois célèbres avocats, MM. Siméon, Barlet et Portalis, portant que le président d’Entrecasteaux étant mort dans les cinq ans de sa condamnation par contumace, il était décédé integri status. » 94
Mgr. le cardinal d’Isoard avait acquis, sous la restauration l’hôtel d’Entrecasteaux, et c’est là qu’on l’a vu chaque fois qu’il était venu à Aix depuis lors, habitant patriarcalement avec ses frères et ses neveux. Nous parlions naguère de l’aîné de ceux-ci et nous formions des vœux pour son prompt avancement dans les hautes dignités de l’église ; nous n’avons plus, hélas ! que des regrets à donner à sa mémoire : M. l’abbé d’Isoard-Vauvenargues, auditeur de Rote pour la France à Rome, vient de mourir, le 14 novembre 1847, à la fleur de l’âge, au moment où ces lignes sont mises sous presse.
François et Marc-Antoine d’Albert père et fils, conseillers au parlement, acquéreurs de la partie restante du terrain qui avait appartenu au duc de Vendôme et à Pierre de Creissel, la vendirent, en 1706, à Louis-Antoine de Vacon, conseiller à la cour des comptes, aides et finances, qui y bâtit la belle maison attenant à celle dont nous venons de parler. Ce magistrat laissa trois enfants : Joseph de Vacon, chanoine de l’église cathédrale de Marseille, l’un des fondateurs de l’académie de la même ville, où il mourut, le 7 mai 1731, à peine âgé de quarante-quatre ans, puisqu’il était né à Aix le 15 janvier 1687 ; 95 Jean-Baptiste de Vacon, né à Aix le 24 décembre 1689, nommé et sacré évêque d’Apt en 1722, sur la démission de Joseph-Ignace de Foresta, son oncle maternel. Il mourut dans sa ville épiscopale le 7 décembre 1751, en grande vénération parmi ses diocésains, à cause de son désintéressement et de sa charité ; Angélique de Vacon, mariée dans la famille de Lordonet, à qui elle apporta les biens de la sienne dont elle fut héritière par la mort de ses frères sans enfants. Les Lordonet, depuis seigneurs d’Esparron de Pallières, s’étant éteints en mâles en 1790, leur fortune a passé à la fille unique du dernier d’entre eux, mariée dans la famille de Sinéty, qui nous est venue de Marseille où elle a produit plusieurs personnages de mérite, et qui est originaire d’Apt.
Louis-Antoine de Vacon, que nous venons de nommer, revendit le reste de son terrain, en 1710, à Antoine de Margalet, seigneur de Luynes, et à Louis d’Hesmivy, seigneur de Moissac, l’un et l’autre conseillers en la cour des comptes. Ceux-ci le divisèrent entre eux et y firent construire les deux beaux hôtels qui terminent cette ligne méridionale du Cours et qui se présentent les premiers à la droite lorsqu’on entre dans la ville par la grande Rotonde. Les Margalet cédèrent leur hôtel, vers le milieu du XVIIIe siècle, aux Lombard, seigneurs du Castellet, qui le possédaient au commencement de la révolution et qui ont quitté depuis lors la ville d’Aix, où ils avaient fourni une longue suite d’honorables magistrats à la cour des comptes, remontant à un Arnoul Lombard, seigneur de Saint-Benoît, du Castellet, etc., président des maîtres-rationaux, au milieu du XVe siècle, sous le bon roi René.
Il nous reste à parler de l’hôtel bâti par Louis d’Hesmivy de Moissac. Le fils de ce magistrat, Jean-Louis-Hyacinthe d’Hesmivy, seigneur de Moissac, né à Aix le 23 juin 1684, reçu conseiller au parlement en 1709, est celui des membres de cette cour souveraine qui a le plus travaillé à l’histoire de sa compagnie. Il publia, en 1727, un Recueil des titres et pièces touchant l’annexe, 96 et laissa en manuscrit plusieurs ouvrages sur l’exactitude desquels on peut compter, renfermant une foule de faits curieux sur l’histoire du pays si souvent liée à celle du parlement.
Ces ouvrages sont : 1° une Histoire du parlement de Provence, depuis son institution (1501) jusqu’à la mort de Louis XIV (1715), beaucoup plus ample que celles de Guidi, de Louvet et autres qui ont écrit sur le même sujet. M. P. Cabasse y a puisé plus particulièrement la matière de ses Essais historiques sur cette compagnie ; 2° un précis des contestations qu’avait eues le parlement avec la cour de Rome, les archevêques et évêques de la province, le chapitre de Saint-Sauveur, les gouverneurs de Provence, les lieutenants-généraux et les commandants ; la cour des comptes, aides et finances, les trésoriers-généraux de France, les sénéchaussées de son ressort, les consuls d’Aix, procureurs du pays, etc., etc. 97 3° un Cérémonial du parlement, etc. L’auteur mourut au château de Moissac, près d’Aups, le 29 novembre 1740.
Jean-Louis-Honoré d’Hesmivy, son fils, comme lui seigneur de Moissac et conseiller au parlement, né en 1719, fut fait intendant de la Guadeloupe vers 1750, 98 et vendit alors son hôtel à M. le duc de Villars, gouverneur de Provence, pour la durée de la vie de celui-ci seulement.
Honoré-Armand, duc de Villars, pair de France, grand d’Espagne de la première classe, chevalier de la Toison-d’Or, pince de Martigues, etc., membre de l’académie française, faisait son séjour habituel à Aix depuis qu’il avait succédé à l’illustre maréchal de Villars, son père, dans le gouvernement de Provence. Il y tenait un très grand état de maison et se faisait aimer, quoiqu’il fut généralement peu estimé. On lui reprochait de manquer de bravoure, 99 et il était taxé d’un vice qu’il avait mis à la mode à la cour et qui lui avait valu une renommée assez étendue. » 100 C’est lui qui avait inspiré à la haute société d’Aix, la passion la plus effrénée du jeu, passion qui se répandit plus tard dans toutes les classes et qui malheureusement ne s’est point affaiblie depuis lors.
Sur la fin de ses jours, le duc de Villars avait acheté également à vie, le château et le parc des Aygalades, dans le territoire de Marseille, où il allait passer l’été, ne demeurant plus que l’hiver à Aix. Il essuya dans cette ville, pendant le carnaval de 1770, des désagréments de la part de quelques personnes qu’il n’avait pas invitées à ses bals et à ses soupers, et il partit pour les Aygalades, résolu de ne revenir à Aix que dans les occasions solennelles. La mort l’y suivit de près, et il succomba à une courte maladie, le 27 avril à quatre heures du matin. Son corps fut apporté à Aix le surlendemain 29, et inhumé solennellement, le mercredi 5 mai, dans l’église métropolitaine de Saint-Sauveur, derrière le maître-autel. Tous les hôpitaux de la ville, tous les ordres religieux, le clergé de toutes les paroisses, le chapitre de Saint-Sauveur, le parlement, les trésoriers-généraux de France, la sénéchaussée et les consuls assistèrent à ses funérailles, et le médecin Goyrand 101 composa l’épitaphe qui fut placée sur sa tombe.
Le duc de Villars a été le dernier gouverneur de Provence qui ait fait son séjour dans le pays, comme il en avait été le premier depuis la mort du cardinal de Vendôme ; car, ni le grand Vendôme, fils du cardinal, ni le grand Villars, père de celui dont nous parlons, n’y étaient guère venus que pour se faire recevoir et n’y avaient jamais fait de séjour tant soit peu considérable.
Nous terminerons en peu de mots cette description historique du Cours. Parmi les familles riches et puissantes qui l’habitaient en 1788, c’est-à-dire la veille de la révolution, vingt-quatre 102 se sont éteintes dans le courant des soixante années qui se sont écoulées depuis lors, et quatre 103 ont abandonné le séjour d’Aix. Toutes jouissaient d’une fortune considérable, et la plupart occupaient de hautes fonctions dans l’épée et dans la robe. D’autres familles, aussi honorables sans doute, les ont remplacées, mais avec moins de fortune et surtout moins d’éclat, on ne peut le dissimuler, puisque aucune d’elles ne jouit plus des anciens droits seigneuriaux qui faisaient, avant 1789, la grande partie de la puissance des anciennes dans toute l’étendue de la province, et que si peu des nouvelles exercent aujourd’hui des emplois dans la magistrature ou ailleurs. Ces observations, qui peuvent s’appliquer à la plupart des autres quartiers de la ville, mais dans des proportions moins étendues qu’ici, fairont connaître bien mieux que de vains discours, les pertes immenses que la ville d’Aix a faites depuis la révolution.
1 Le lecteur voudra bien se rappeler que la partie de ce fossé qui était située au midi du rempart devant les Augustins, entre la rue du Trésor et celle de la Masse, était destinée au jeu de l’arbalète. – Vol. 1er, pag. 657. Retour
2 La ville d’Angers a fait élever dans son sein, en 1843, une statue du roi René, et c’est l’ouvrage du même M. David, natif de ladite ville, habitant à Paris. Les journaux en firent le plus grand éloge sous tous les rapports. Voici ce qu’en disait la Quotidienne du 14 septembre : L’œuvre nouvelle de l’habile artiste saisit tout d’abord par son aspect fier et imposant. Le roi René d’une main soulève son casque, tandis que l’autre est appuyée sur la garde de son épée. L’expression de la tête est celle d’une fierté pleine de douceur. L’attitude du corps, dont la partie inférieure seulement est recouverte de pièces d’armures, est aussi noble que bien prise. Les attributs de la peinture et de la musique sont aux pieds du héros, etc. » – On peut en voir une épreuve massive en plâtre à l’Hôtel-de-Ville d’Aix. – » Cette statue, déjà coulée en bronze et qui a dix pieds de hauteur, nous dit M. le comte de Quatrebarbes dans une de ses lettres, est accompagnée de douze statues demi nature, toutes faites par David, qui représentent l’histoire d’Anjou depuis sa lutte contre les Romains, Roland, Robert-le-Fort, les Plantagenet, la conquête de la Sicile, jusqu’à Isabelle de Lorraine, Jeanne de Laval et la grande Marguerite d’Anjou. » – On sait que les frais de cette noble et patriotique entreprise sont pris sur le produit de la magnifique édition des Oeuvres complètes du roi René, publiées par M. le comte de Quatrebarbes, en 4 vol. in-4°, avec fig. Retour
3 Dix-huitième lettre, tom. 1er, édit. de 1785. Retour
4 Tom. 1er, chap. XLVIII. Retour
5 Voyez au 1er vol., pag. 620. Retour
6 Voyez ci-dessus, rue du Collége, pag. 22. Retour
7 Voyez la feuille hebdomadaire d’Aix, du 29 juin 1788. Retour
8 Pendant une partie de la révolution, c’est-à-dire depuis l’abolition de la royauté jusqu’à l’empire, ce nom d’hôtel des Princes fut changé en celui d’hôtel des Quatre-Nations. Retour
9 Voyez Malte ancienne et moderne, par le chevalier Louis de Boisgelin, en anglais ; édition française, par M. de Fortia de Pilles, tom. III, p. 399, appendice n°30, Liste des chevaliers embarqués sur l’escadre française (juin 1798).-Voyez aussi les Monuments des Grands-maîtres de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, par M. le vicomte L.-F. de Villeneuve-Bargemont, tom. II, pag. 398, aux pièces justificatives, Chevaliers qui suivirent l’escadre française en Égypte. Retour
10 Voyez ci-dessus, pag. 101 et suiv. Retour
11 Registre de correspondance de la municipalité d’Aix, tom. XIV, f° 166, n°1633, aux archives de l’Hôtel-de-Ville. Retour
12 D’après les relations imprimées, le Pape ne fit que traverser Avignon, ne s’y arrêtant qu’une demi heure. Des marchands, revenant de la foire de Beaucaire, le rencontrèrent à Orgon et le devancèrent à Aix. Retour
13 Suivant les mêmes relations, les conducteurs du Pape lui ayant demandé plusieurs fois s’il voulait séjourner à Aix, il répondit constamment : Comme on voudra. Retour
14 Ici M. de Saint-Vincens commet une erreur. Ce fut le cardinal Pacca et non le cardinal Gabrielli qui fut séparé du pape à Grenoble et conduit à la citadelle de Fenestrelle, où il demeura captif pendant trois ans et demi. Retour
15 Ce ne fut pas le Pape lui-même qui dit la messe à l‘hôtel des Princes, comme pourrait le faire croire cette phrase ambiguë. Le souverain pontife et les assistants entendirent la messe d’un des prêtres qui accompagnaient S. S. Retour
16 P-J. de Haitze, Histoire d’Aix, manuscrite, liv. IV, § 26, d’après la relation du frère Pierre Amiel, religieux augustin, évêque de Sinigaglia, en Italie, auteur de l’itinéraire dont nous parlons, dans lequel est mentionnée aussi la bonne chère qu’on fit faire à Aix aux personnes qui accompagnaient le Pape. Retour
17 On a de M. le marquis d’Arbaud-Jouques, un volume d’aimables poésies, imprimé à Avignon en 1810, in-8°. Retour
18 Voyez l’intéressante Biographie de M. Leblanc de Castillon, brochure de vingt-une pages in-8°, imprimée chez M. Aubin, 1847 ; par M. Jules de Séranon, jeune avocat près la cour royale d’Aix, que distinguent sa capacité et sa modestie. Retour
19 François-Joseph-Etienne Beisson, né à Aix le 10 décembre 1759, mort à Paris en 1820. On a de lui un grand nombre de gravures au burin qui lui assurent un rang distingué parmi les artistes de son siècle. Retour
20 Voyez au 1er vol., pag. 267 et suiv. Retour
21 Voyez au 1er vol., rue Courteissade, pag. 551 et suiv. Retour
22 Nous étions alors, depuis quinze ou dix-huit mois, secrétaire en chef de l’hôtel-de-ville, emploi que nous avons toujours regretté, même lorsque nous en avons exercé, pendant près de quinze ans, un autre plus lucratif et peut-être plus honorable : celui de greffier en chef de la cour royale, auquel le roi Louis XVIII nous appela le 13 décembre 1815. C’est de celui-ci que nous nous démîmes spontanément le 7 août 1830, qui est le jour même où monseigneur le duc d’Orléans fut proclamé roi à Paris sous les noms de Louis-Philippe ; mais à Aix, il n’était encore reconnu qu’en qualité de lieutenant-général du royaume. Retour
23 Registre de correspondance de la municipalité d’Aix, tom. XIV, F° 90 et suiv., nos 900 et suiv., lettres des 5, 7, 9, 12 et 13 octobre 1808. Retour
24 Notre très honorable ami M. Laurent Lautard, de Marseille, a publié dans cette ville, chez Achard, 1826, en soixante-six pages in-8° et sous le nom d’un vieux Marseillais, une Notice, pleine d’intérêt, sur le séjour à Marseille du roi d’Espagne Charles IV, depuis la fin de 1808, jus qu’au printemps de 1812 ; notice dont le vénérable auteur a reproduit les principales circonstances dans ses Esquisses historiques, ou Marseille depuis 1789 jusqu’en 1815, par un vieux Marseillais, chez Olive, 1844, deux vol. in-8°, tom. II, pag. 218 à 244. Retour
25 Les Garidel sont connus à Aix depuis un Antoine Garidel reçu au parlement en qualité de procureur du roi pour les pauvres, en 1533. Retour
26 Dominique de Guidi l’un de ses membres, exerçait cumulativement avec dispenses du roi, un office de trésorier de France et celui de conseiller au parlement. Il a laissé en manuscrit une histoire du parlement de Provence, depuis son institution jusqu’en 1660, qui est estimée. Ce magistrat mourut à Paris en 1680. Retour
27 Mémoires d’une femme de qualité, etc., deuxième édit., Paris, 1830, tom. III, chap. 17, pag. 258. Retour
28 Voyez au 1er vol., pag. 513. Retour
29 Voyez au 1er vol., pag. 573 et 574. Retour
30 Dict. des hommes illust. de Prov., par Achard, tom. II, pag. 128. Ce dictionnaire se trompe en fesant mourir Puech en 1687, et le P. Bougerel encore plus, en plaçant sa mort après l’année 1690. Né à Aix le 25 janvier 1624, Louis-Scipion Puech, prêtre et d’abord prieur de la Tour-de-Beuvon, était prieur de Buoux, dans le diocèse d’Apt, lorsqu’il mourut à Aix le 15 juin 1686. Il fut enterré, le lendemain, dans l’église des Augustins reformés, dits de Saint-Pierre, maintenant détruite. Retour
31 Charles-Fortuné de Mazenod, chanoine de Saint-Sauveur, né à Aix le 27 avril 1749, sacré évêque de Marseille en 1823, démissionnaire en 1837, mort à Marseille le 22 février 1840, sur la fin de sa quatre-vingt-onzième année, emportant les regrets sincères et unanimes de ses diocésains ; et Mgr Chartes-Joseph-Eugène de Mazenod, né à Aix le 1er août 1782, dernier mâle de son honorable famille, fondateur de la première maison des Missionnaires de Provence, établie à Aix en 1816, nommé évêque d’Icosie in partibus et sacré à Rome en 1832, lequel marche aujourd’hui très dignement sur les traces de son oncle qu’il a remplacé en 1837. – Voyez l’Oraison funèbre de Mgr Charles-Fortuné de Mazenod, ancien évêque de Marseille, etc., par M. l’abbé Jeancard (Marseille, Olive, 1840, in-8°) Outre ce qui touche à ce saint évêque, on y trouve (pag. 61et suiv.) une intéressante notice sur M. Charles-Antoine de Mazenod, son frère aîné et père de Mgr l’évêque actuel, né en 1745, mort en 1820, ancien président à la cour des comptes d’Aix, etc.; magistrat très recommandable par ses lumières et son intégrité, qui a laissé en manuscrit une foule d’écrits importants sur l’histoire de Provence et celle des cours souveraines du pays. Retour
32 Voyez cette notice dans le Mémorial d’Aix du 29 août 1841. Retour
33 Ce sont 1° Jacques de Gantès, savant dans les langues orientales et dans la plupart de celles de l’Europe, né à Aix le 4 février 1567, mort dans la même ville, dont le commandement lui avait été confié lors des ravages qu’y fesait la peste, le 12 juin 1631 ; 2° François de Gantès, procureur-général qui donne lieu à cette note, fils du précédent, né le 2 février 1596, à Aix, où il mourut le 15 mars 1679 ; 3° et Jean-François de Gantès, militaire distingué par sa bravoure, lieutenant-général en 1762, commandeur grand’croix de l’ordre de Saint-Louis en 1771 , né à Aix le 29 janvier 1702, mort à Paris le 4 avril 1776. – Nous donnons ces dates ici pour servir à corriger celles qu’on trouve dans le dictionnaire d’Achard et qui sont inexactes ou incomplètes. Retour
34 Voyez au tome 1er, rue du Séminaire, pag. 457. Retour
35 Jean-Joseph-Pierre Pascalis, célèbre avocat au parlement d’Aix, natif du lieu d’Eyguières, près de Salon, avait été deux fois assesseur d’Aix, procureur du pays de Provence : la première, en 1773 et 74 ; la seconde, en 1787 et 88. Il avait été l’un des plus vigoureux adversaires de Mirabeau dans le procès de celui-ci contre sa femme, mademoiselle de Marignane. Retour
36 Gaspard-Louis-Cassien-Antoine de Maurellet, seigneur de Cabriès et marquis de la Roquette. Il laissa après lui un frère, officier au régiment de Beaujolais, dernier mâle de sa famille, qui périt misérablement, trois ans après, dans une prison de Paris. Retour
37 André-Raymond de Guiramand ; il était alors écuyer de l’académie royale d’équitation établie à Aix, et avait succédé dans cet emploi à Claude de Guiramand, son père. Retour
38 A Aix, chez les frères Mouret, in-8°. Elle se compose de cinq parties contenant entre elles 451 pages d’impression. Retour
39 C’étaient le directoire du département des Bouches-du-Rhône, dont l’assemblée nationale constituante avait fixe le siége à Aix ; le directoire du district d’Aix, et la municipalité de cette ville. Ces trois administrations tenaient leurs séances à l’Hôtel-de-Ville. Retour
40 Voyez ci-dessus pag. 102. Retour
41 A Aix, de l’imprimerie des vénérables Frères Anti-Politiques, vraies foudres des Pascalis et de tous les anti-nationaux, ce 13 décembre 1790. Retour
42 C’est à ce même arbre qu’avait été pendu, le 28 mars 1789, en vertu d’un arrêté du parlement, l’un des paysans qui avaient pillé les greniers publics, dans l’après-midi du 25 du même mois, jour de la fête de l’Annonciation. – Voyez au tom. 1er, pag. 79 et 80. Retour
43 La municipalité ne dressa procès-verbal de tous ces événements que le 17 mars 1791, trois mois après qu’ils avaient eu lieu (tom. III des Délibérations, fos 240 à 255, aux archives de l’Hôtel-de-Ville) ; encore ce procès-verbal n’est-il revêtu que de cinq signatures, tandis qu’il devrait porter celles des douze officiers municipaux et même celles du procureur de la commune et de son substitut. Il est aisé de voir, en le lisant, que ses rédacteurs ont employé tous leurs efforts pour justifier leur impuissance de faire le bien dans cette terrible circonstance. Au reste, tous les torts y sont rejetés sur ceux qu’on appelait les ennemis du nouvel ordre de choses. C’est ainsi que dans toute la France on accusait alors les gentilshommes d’incendier eux-mêmes leurs châteaux pour se ménager le plaisir de calomnier la révolution. Retour
44 Voir la procédure imprimée, troisième partie intitulée Réquisition de M. le commissaire du roi, etc., pag. 19. Retour
45 Voir au 1er vol., pag. 228 et 233. Retour
46 Il était natif de Saint-Paul-lès-Durance, et publia un Traité du style de la cour des soumissions, qui a été imprimé deux fois à Avignon, l’une en français en 1554, in-8° ; l’autre en latin en 1559, in-4°. Cet ouvrage, plus estimable qu’estimé, au dire d’Achard (Dict. des hommes illust. de Prov.), est absolument hors d’usage depuis les nouvelles lois sur la procédure. Retour
47 Joseph- Hilarion de Gautier du Vernègues, né à Aix le 8 août 1757, deux mois avant la mort de son aïeul. Son frère aîné, M. du Poët, était conseiller au parlement au moment de la révolution, et ses deux autres frères, MM. d’Avalon et de Badasset, étaient : l’un, capitaine d’infanterie ; l’autre, officier de marine, à la même époque. Tous les quatre avaient émigré. Retour
48 Voyez ci-après, rue du Louvre. Retour
49 Sur le passage de S. A. R. Monsieur comte d’Artois, à Aix, au mois de septembre 1814, voyez notre 1er vol., pag. 44 et surtout la correction, pag. 660. Retour
50 On nous a demandé souvent ce que nous entendions par ligne méridionale ou septentrionale, orientale ou occidentale. La ligne méridionale est celle qu’on a à sa gauche en allant du levant au couchant et à sa droite, en revenant du couchant au levant ; comme la ligne septentrionale est celle qu’on a à sa droite en allant du levant au couchant et à sa gauche en revenant du couchant au levant. De même, la ligne orientale est celle qu’on a à sa droite en allant du midi au nord et à sa gauche, en revenant, dit nord au midi ; comme la ligne occidentale est celle qu’on a à sa gauche en allant du midi au nord et à sa droite, en revenant du nord au midi. Mais, nous dit-on, le soleil frappe sur ce que vous appelez la ligne septentrionale et n’éclaire pas la ligne méridionale ; on ne veut pas voir que ce sont les maisons bâties sur celle-ci qui la mettent à l’ombre. Retour
51 Ci-dessus, pag. 122 et 123. Retour
52 C’est dans le dictionnaire d’Achard que nous puisons cette date de la mort du chevalier de Perrin, qu’il fixe au 19 janvier 1754. Mais nous avons peine à y croire, puisque c’est en cette même année que parut son édition des Lettres de madame de Sévigné, plus ample et plus correcte qu’aucune des précédentes. Au surplus, l’éditeur avait publié plus anciennement les Muses rassemblées par l’amour, idyle mise en musique par Campra ; Paris, Estienne, 1723, in-8°. Denis-Marius de Perrin, était l’avant-dernier des dix-neuf enfants qu’avait eus son père d’une seule femme, et parmi un si grand nombre d’enfants, une seule fille, mariée en 1703 dans la famille d’Audibert de Ramatuelle, laissa postérité. Retour
53 Voyez au 1er vol., rue de Suffren. Retour
54 Anne-Marie-Louise d’Orléans, duchesse de Montpensier, princesse de Dombes (la grande Mademoiselle, mariée secrètement au fameux Lauzun) morte en 1693. Retour
55 Voyez le Journal contenant une relation abrégée de ce qui a été fait en Provence à l’occasion du passage de S. A. R. don Philippe, infant d’Espagne, in-4°, de dix-huit pages ; Aix, David. – Très rare. Retour
56 La naïveté se tait mieux sentir comme elle fut prononcée en patois, où le mot escadroun parait un diminutif d’escadro ; comme si l’on disait escadron pour dire petite escadre. Retour
57 In-f ° de deux cent cinquante pag., imprimé à Aix, chez Jean-Baptiste et Etienne Roize. Retour
58 Lettre du 5 novembre 1688. Retour
59 Lisez Gailhard avec une h, ainsi que le prouvent le livre de Noël Gailhard, ci-dessus cité, et sa signature que nous possédons en original. Retour
60 C’est ainsi qu’on appelait le Dauphin, fils de Louis XIV, autrement dit le Grand-Dauphin, qui fesait le siège de Philisgourg, ayant sous lui le maréchal de Duras pour commander, et M de Vauban pour la direction du siège. Retour
61 Nous possédons deux lettres autographes d’un personnage des plus influents de la révolution de 1830, d’ailleurs orateur et écrivain très distingué, qui prouvent que si, pendant qu’il était ministre en 1834, Théobald de Saint-Julien eût voulu être pair de France, il l’eût été; mais Théobald idolâtrait justement sa vertueuse et tendre mère, que les pauvres ont perdue, hélas ! au mois de juillet 1846, et à laquelle, pour tout au monde, il n’eût voulu causer le moindre déplaisir, ce qui fut cause qu’il refusa. Retour
62 Voyez ci-dessus, pag. 11 et suiv. Retour
63 Fils de la fille aînée de Julien, M. de Laboulie, notre ami, procureur-général à la cour royale d’Aix sous la restauration, a montré, en 1830, qu’il avait hérité de son père, de son aïeul, de son bisaïeul, successivement conseillers au parlement, et de son aïeul maternel, de cette vieille maxime aujourd’hui tant soit peu passée de mode : noblesse oblige. – C’est le père de l’honorable M. Gustave de Laboulie, né à Aix en 1800, dont les nobles paroles ont si souvent retenti à la tribune nationale, comme député de Marseille. – Nous avons sur J.-J. Julien, une excellente notice, par M. Ch. Giraud, ancien professeur de droit administratif à la faculté de droit d’Aix, actuellement membre du conseil royal de l’instruction publique et de l’Institut, imprimée chez Nicot et Aubin en 1838, in-8°. Retour
64 Pierre-Amédée-Emilien-Probe Jaubert, mort à Paris au mois de janvier de la présente année 1847, était sans contredit l’une des premières illustrations de la ville d’Aix à notre époque. Parti en 1798, à l’âge de dix-huit ans, pour l’expédition d’Egypte, en qualité de secrétaire interprète des langues orientales auprès du général Bonaparte, il traduisit ses célèbres proclamations, toute sa correspondance avec les chefs du pays, ses discours, etc., et rédigea les traités conclus par la république française avec les peuples du Liban, les capitulations des places conquises, etc. Il fut du petit nombre de ceux qui revinrent en France avec Bonaparte, et repartit, en 1802, avec le colonel Sébastiani, pour l’Orient, où il retourna une troisième fois, en 1804, pou faire reconnaître Napoléon empereur par la Porte Ottomane. » Chargé, l’année suivante, d’aller négocier un traité avec le schah de Perse, dans le trajet de Constantinople à Téhéran, il fut arrêté près de Bayazid, par le pacha de cette ville, dépouillé des riches présents qu’il portait au schah et jeté au fond d’une caverne desséchée, où il resta prisonnier près de quatre mois avec un fidèle serviteur, et il n’échappa à la mort que par celle du pacha et de son fils, qui avaient donné l’ordre formel de le faire périr. Il fut alors délivré, les présents lui furent rendus et il put parvenir, après mille dangers, d’abord auprès de d’Abbas-Myrza, héritier du trône de Perse ; ensuite, auprès de Feth-Ali-Shah, par qui il fut reçu avec la plus grande distinction, et qui l’honora de plusieurs entretiens sans interprète. Il fut ensuite chargé d’autres missions honorables ; mais la restauration l’ayant laissé sans emploi, il s’associa, en 1818, avec M. Ternaux, et ayant conclu ensemble un traité avec le gouvernement de Louis XVIII, il fit un nouveau voyage en Orient, dans le but, de rechercher la race des chèvres thibétaines à duvet de cachemire, et ramena en France quatre cents de ces chèvres, sur près de treize cents qu’il avait achetées. Depuis lors, il se livra à l’enseignement du turc, du persan et de l’arabe, et après avoir publié son Voyage en Arménie et en Perse des années 1804 et 1805, il donna successivement sa Grammaire turque, son Voyage d’Orenbourg à Boukhara, une suite de notices sur d’importants ouvrages orientaux ; enfin, il enrichit la science de sa traduction si estimée de la Géographie d’Edrizy, l’un des livres arabes les plus instructifs. » – Voyez le Journal des Débats du samedi 30 janvier 1847, où nous avons puisé la plus grande partie de ces détails, et où il est dit, par erreur, que M. Jaubert était né en septembre 1779. Nous avons constaté ci-dessus qu’il était né le 3 juin précédent. -M. son frère, François- Louis-Charles-Maximilien Jaubert, ancien avocat-général à la cour royale de Paris, aujourd’hui conseiller à la cour de cassation, est né dans la même maison, le 29 janvier 1781 . – Antoine-Pierre Jaubert, leur père, avocat au parlement d’Aix, fut le premier procureur-général syndic du département des Bouches-du-Rhône en 1790, et est mort à Paris, sous l’empire, étant membre du corps législatif. Retour
65 Contés en vers prouvençaoux, imprimas per la premiéro fes en aous 1806 ; Aix, Pontier, seize pag. in-8°. Retour
66 On a assuré, mais nous ne pouvons l’affirmer, que Félix Mongin était l’aïeul maternel de M. Poujoulat, littérateur distingué, natif de La Fare, à quelques lieues d’Aix, que feu M. Michaud avait choisi pour son collaborateur et mieux encore, pour son ami. Retour
67 La charge de grand-sénéchal, si considérable sous les comtes de Provence et même sous les rois de France jusqu’à Louis XIV, fut divisée, en 1662, en autant de sénéchaux qu’il y avait de siéges dans le ressort du parlement ; mais celui d’Aix conserva le titre de grand-sénéchal de Provence, tandis que les autres n’étaient qualifiés que de grands-sénéchaux aux siéges d’Arles, de Marseille, de Toulon, etc. Retour
68 Louis-Nicolas-Philippe-Auguste de Forbin, né au château de la Roque le 9 août 1777, mort à Paris le 23 février 1841. Ses restes mortels reposent, suivant ses intentions au cimetière de cette ville d’Aix sous un tombeau en marbre que sa famille lui a fait élever. – Ses principaux ouvrages littéraires sont : un Voyage dans le Levant en 1817 et 1818, Paris, imprimerie royale, 1819, in-f°, format atlantique, orné de quatre-vingt planches ; et les Souvenirs de la Sicile, Paris, imprimerie royale, 1823, in-8°, etc. – Quant à ses tableaux, ils sont répandus dans divers cabinets, et le musée d’Aix lui en doit un fort beau représentant un intérieur de l’Alhambra. Retour
69 Gaspard-Anne-François-Palamède de Forbin, chevalier, seigneur de la Barben, Sue, la Roque, Soliès, marquis de Pont-à-mousson, mestre de camp de cavalerie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc., né à Aix en 1739, mort sur l’échafaud révolutionnaire de Lyon le 26 décembre 1793, avec le mari de la sœur de sa femme, le président d’Arbaud Jonques. – C’est à lui que l’avocat Charles-François Bouche avait dédié, en 1785, son Essai sur l’histoire de Provence, en deux volumes in-4°. Retour
70 Voyez notre 1er vol., rue du Puits-Juif, où nous avons rapporté que notre grand peintre, François-Marius Granet, membre de l’institut et conservateur des tableaux des musées royaux, est né dans cette rue le 17 décembre 1775. Retour
71 Pierre de Gallaup, seigneur de Chastueil, dans son Discours sur les arcs triomphaux dressés en la ville d’Aix à l’heureuse arrivée des ducs de Bourgogne et de Berri, Aix, J. Adibert, 1701, in-f° avec planches, pag. 72. Retour
72 Voyez notre 1er vol., Cérémonies de la Fête-dieu. Retour
73 Le président de Saint-Vincens nous a dit plus de vingt fois, lorsqu’il était maire d’Aix : – Les honneurs qu’on rend à l’église et aux dames ne tirent jamais à conséquence. Retour
74 On appelle à Aix, incorrigibles, encroûtés, obtus ou rococos, les gens constants dans leurs opinions monarchiques antérieures à 89, qui n’en ont pas changé à chaque phase de la révolution, comme tant de gens. Le nombre de ces incorrigibles diminue naturellement tous les jours, et dans quelques années il ne s’en trouvera plus un seul. Retour
75 Tuit cil qui avoient esté le jor devant contre lui, estoient cel jor tost à sa volenté (Tous ceux qui, le jour précédent, avoient esté contre lui, estoient ce jour-là sous son obéissance). – Villehardouin, de la conquête de Constantinople, ann. 1203, à l’occasion du rétablissement de l’empereur Isaac l’Ange sur le trône. Retour
76 Une fatale destinée semble vouloir que lorsque trois frères issus de la noble maison de Hugues Capet, ont porté successivement la couronne, celle-ci passe dans une autre branche de la même maison. C’est ainsi qu’après les frères Louis X, dit Le Hutin, Philippe V, dit Le Long, et Chartes IV, dit. Le Bel, la couronne passa dans la branche de Valois , en 1328 ; qu’après les frères François II, Charles IX et Henri III, elle passa dans la branche de Bourbon, en 1589 ; et qu’après les frères Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, elle a passé dans la branche d’Orléans, en 1830. Cette singulière remarque n’a encore été faite nulle part, à ce que nous croyons. Il faut ajouter néanmoins que les circonstances ne sont pas les mêmes dans les trois cas. Retour
77 C’est le même qui vendit sa maison paternelle à J.-B. Reinaud de Fonvert, en 1769. Voyez ci-dessus, pag. 175. Retour
78 Voyez les Essais Historiques sur le Parlement de Provence, par M. Cabasse, tom. IV, pag. 281. Retour
79 Voyez notre 1er vol., pag. 605 et suiv. Retour
80 Ce monument, abattu pendant la révolution, fut relevé, en 1802, par M. de Saint-Vincens le fils, dans le chœur de l’église métropolitaine de Saint-Sauveur où il est encore au lieu où existait, avant 1793, le mausolée d’Hubert Garde, baron de Vins, chef des ligueurs en Provence. Retour
81 Voyez la Notice sur J.-F.-P. Fauris Saint-Vincens, par son fils, dont il y a plusieurs éditions in-4° et in-8°, etc. Retour
82 Voyez le P. Papon, Hist. gén. De Prov., tom. IV, préface, pag. 5 ; et le Voyage en Savoie et dans le midi de la France, en 1804 et 1805, par le malheureux La Prédoyère ; Paris, 1807, in-8°, pag. 210 à 225. Retour
83 Notice sur M. de Saint-Vincens, président de la cour royale d’Aix, associé regnicole de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, par M. Marcellin de Fonscolombe ; Aix, Pontier, 1820, 27 pag. in-8°. – Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. de Saint-Vincens, lu à la séance publique du 25 juillet 1825, par M. Dacier, secrétaire perpétuel de cette académie ; dans le Moniteur du 2 août 1823 : tiré séparément, en 12 pag. in-8°. Retour
84 Voyage dans les départements du midi de la France, tom. II, pag. 192 à 237. Retour
85 Il est juste de constater ici que M Rouard, bibliothécaire de la ville, fut le provocateur de ce vote honorable. Retour
86 Voyez notre 1er vol., pag. 201. Retour
87 Voyez notre 1er vol., pag. 10 et suiv., et pag. 23. Retour
88 Contrat du 21 mars 1693, passé devant. Rocheron et son confrère, notaires au Châtelet de Paris. Retour
89 Tome XIII, pag. 174. Le contre-amiral d’Entrecasteaux mourut dans l’Inde, le 20 juillet 1793. – Le Voyage de d’Entrecasteaux, envoyé à la recherche de la Pérouse, publié par ordre de S. M. l’empereur et roi, etc. rédigé par M. de Rossel, ancien capitaine de vaisseau, Paris, imprimerie impér., 1808, 2 vol. in-4° avec atlas in-f°, est un beau monument élevé à la mémoire de cet illustre navigateur dont notre ville peut s’enorgueillir, ainsi que du bailli de Suffren, quoique ni l’un ni l’autre ne soient nés dans ses murs, mais comme appartenants à des familles d’Aix. Retour
90 Voyez notre 1er vol., pag. 629. Retour
91 Dans la nuit du 17 au 18 août de cette année 1847. Retour
92 Il était né à Aix le 29 juillet 1758, environ dix-neuf ans après la naissance du marin son oncle, et avait été reçu président au parlement le 11 juillet 1782, en survivance de son père. Retour
93 Voyez le journal de Paris le Temps, des jeudi 20, vendredi 21, mardi 24 et jeudi 27 février 1840, nos 3774, 3775, 3779 et 3781, aux feuilletons réimprimés plusieurs fois depuis lors, etc. Retour
94 Essais historiques, etc., par M. P. Cabasse, tom. III, pag. 437 et suiv. Retour
95 Voyez le Diction. des Hom. Illust. de Prov., par Achard, tom. II, pag. 284, où le nom est écrit Vaccon, par deux c, ce qui est une erreur. Voyez aussi l’Hist. de l’acad. de Marseille, par M. le chev. Lautard, t. 1er pag. 42 et autres. Retour
96 A Aix, chez Joseph Senez, 74 pag. in-8°, réimprimé avec des augmentations, à Avignon, 1756, in-12. – Sur le droit d’annexe, voyez notre 1er v., p. 63, note 1. Retour
97 Nous possédons des copies de ces deux manuscrits. Retour
98 Il y mourut en 1769. Son fils, conseiller au parlement de 1770 à 1790, mort en 1827, sans avoir été marié a été le dernier mâle de cette famille, dont M. Ailhaud, docteur en médecine, possède et occupe aujourd’hui le bel hôtel. Retour
99 On raconte qu’un gentilhomme, s’étant un jour présenté chez lui, un peu trop chargé d’essence : » Quelle odeur insupportable ! » avait dit le duc ; à quoi l’autre, se croyant offensé avait répondu : » Je pensais, monseigneur, que vous ne craigniez que l’odeur de la poudre, » ce que M. de Villars avait feint de ne pas entendre. – Il était fort minutieux et s’occupait beaucoup de sa parure, ses valets le gouvernaient le plus souvent et il redoutait la présence d’un homme ferme ou irrité. Le marquis de Villeneuve-Vence disait un jour à sa femme (Sophie de Simiane, arrière petite-fille de madame de Sévigné ) : – » Conveniez, madame, que M. le duc est un bien bon homme. » – » Oui, monsieur, mais convenez vous-même que c’est une méchante femme. » Retour
100 Mémoires secrets de la république des lettres, etc., par Bachaumont, tome V, pag. 108, où l’auteur renvoie au fameux poème de Voltaire, dont Jeanne d’Arc est l’héroïne.- Voyez aussi, sur M. le duc de Villars, les Notes et recherches historiques sur la ville d’Aix, par M. le président de Saint-Vincens le fils, manuscrit de la bibliothèque Méjanes, 3 vol, petit in-fol, très curieux. – Voyez encore les Mémoires posthumes de Marmontel, liv. VII. Retour
101 Joseph-Louis Goyrand, savant médecin, natif d’Aix, mort le 3 février 1790, à l’âge de 72 ans, grand-oncle de M. Goyrand, docteur en médecine, aujourd’hui adjoint à la mairie d’Aix. Le père de ce dernier, M. Antoine-Gabriel Goyrand, mort en 1826, était un habile peintre à qui l’on doit plusieurs tableaux d’église et quelques peintures de chevalet, ainsi que le dessin de l’estampe placée au frontispice de l’Essai sur l’hist. de Prov., par C.-F. Bouche : la Provence présentée à Louis XI par Palamède de Forbin. Retour
102 Les Raousset marquis de Seillon, les Michaëlis seigneurs du Sueil, les Maurellet marquis de la Roquette, les Boisson seigneurs de la Salle, les Gantier seigneurs du Poët et du Vernègues, les Adaoust, les Suffren marquis de Saint-Tropez et de Saint-Cannat, les Maurel ou Morel-Villeneuve seigneurs de Mons, les Laugier seigneurs de Saint-André, les Bonaud seigneurs de la Galinière, les Nicolaï seigneurs de Bois-Vert, les Barlatier seigneurs de Saint-Julien, les Ricard marquis de Bregançon et de Joyeuse-Garde, les Gantier seigneurs d’Artigues et de la Molle, les Julien, les Roux, seigneurs de Gaubert, les Saurin, seigneurs de Murat, les Le Blanc seigneurs de Ventabren, les Lyon seigneurs de Saint-Ferréol, les Fauris seigneurs de Saint-Vincens et de Noyers, les d’Antoine-Venel, les Bruny marquis d’Entrecasteaux, les Lordonet seigneurs d’Esparron, et les Hesmivy seigneurs de Moissac. Retour
103 Les Arnaud seigneurs de Nibles et de Vitrolles, les Mazenod seigneurs de Saint-Laurent, les Meyronnet marquis de Châteauneuf, et les Lombard seigneurs du Castellet. Retour
![]()
