
Les Rues d’Aix
ou recherches historiques sur l’ancienne capitale de Provence
par Roux-Alpheran en 2 tomes 1848 et 1851
>>> Retour Accueil du Blog <<<
RUE DE LA CÉPÈDE
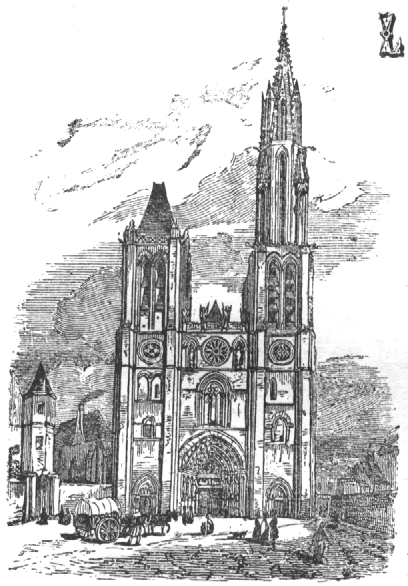 a famille de La Cépède, de laquelle nous avons parlé plusieurs fois depuis les premières pages de ce volume, 1 avait donné son nom à cette rue, dont l’emplacement bordait autrefois, du côté du couchant, le Jardin du Roi, appartenant à cette famille lors le la bâtisse du quartier de Ville-Neuve. Elle est elle-même bordée depuis lors de jolies maisons dont aucune ne nous offre des souvenirs intéressants, si ce n’est celle qu’occupait le malheureux avocat Verdet située vers le centre de la ligne orientale de l’île qui sépare la rue de la Mule-Noire de celle du Grand-Boulevard.
a famille de La Cépède, de laquelle nous avons parlé plusieurs fois depuis les premières pages de ce volume, 1 avait donné son nom à cette rue, dont l’emplacement bordait autrefois, du côté du couchant, le Jardin du Roi, appartenant à cette famille lors le la bâtisse du quartier de Ville-Neuve. Elle est elle-même bordée depuis lors de jolies maisons dont aucune ne nous offre des souvenirs intéressants, si ce n’est celle qu’occupait le malheureux avocat Verdet située vers le centre de la ligne orientale de l’île qui sépare la rue de la Mule-Noire de celle du Grand-Boulevard.
François-Auguste Verdet, natif de Forcalquier, s’était marié dans cette ville d’Aix en 1786, et y exerçait la profession d’avocat lors des premiers événements de la révolution. Il en adopta les principes avec chaleur, mais en honnête homme, persuadé de bonne foi qu’on pouvait réformer d’anciens abus sans renverser l’autel et le trône. Nommé membre de l’administration du département des Bouches-du-Rhône, qui tint sa première séance à Aix le 20 juillet 1790, il l’était encore au mois de février 1792, à l’époque du désarmement du régiment Suisse d’Ernest, dont nous parlerons ailleurs. 2 Sa conduite et celle de ses collègues, en cette occasion, fut dénoncée à l’Assemblée nationale, comme ayant été favorable, disait-on, aux projets contre-révolutionnaires des Suisses et opposée aux patriotes. L’Assemblée nationale manda l’administration entière à sa barre par un décret du 13 mars, mais après avoir entendu chacun des accusés, elle les renvoya tous absous par un autre décret des 24 et 31 juillet suivant. M. Verdet eut l’imprudence de revenir à Aix, se croyant à l’abri d’après cette justification. Ses ennemis veillaient cependant, et le 21 décembre vingt-sept d’entre eux le dénoncent à la municipalité sur le même motif de connivence avec les Suisses dans leurs projets de contre-révolution. On va l’arrêter chez lui, dans le sein de sa famille et, pendant qu’on le conduit à l’Hôtel-de-Ville, il court plusieurs fois le risque de perdre la vie, qu’il eût perdue en effet sans la généreuse fermeté du jardinier Michel, qui exposa la sienne propre pour le sauver. Interrogé par la municipalité, il invoqua pour sa défense les décrets de l’Assemblée nationale prononçant son absolution. Ce fut en vain ; la municipalité l’envoya aux prisons dans l’intention peut-être, nous aimons à le supposer, de le soustraire à la fureur du peuple.
Le samedi, 26 janvier 1793, dans la soirée, arrive à Aix l’affreuse nouvelle de la mort de Louis XVI. Les autorités constituées et les sans-culottes se livrent aux transports les plus effrénés de la joie. Les ennemis de M. Verdet sont du nombre et complotent aussitôt de lui arracher la vie. Ils se portent, dans le courant de la nuit, aux prisons alors situées dans l’enceinte des casernes, au cours Sainte-Anne (attendu la démolition de l’ancien palais et des anciennes prisons) ; 3 ils demandent que M. Verdet leur soit livré, et le concierge Bayle, leur complice et l’un des signataires de la dénonciation du 21 décembre, adhère a leur vœu. Les assassins emmènent leur victime et la font entrer avec eux dans la ville par la porte Orbitelle. Ils la traînent sur le Cours et la pendent, au milieu de la grande allée, à un réverbère situé entre la fontaine Chaude et celle des Neuf-Canons, où chacun put la voir le lendemain, dimanche, en se levant.
Cet horrible assassinat fut suivi bientôt après de plusieurs autres. Dans la nuit du 17 au 18 février, Théophile-Barthélémy Lieutaud, négociant d’Arles, Joseph Egaud, de Bordeaux, et Claude Patin, maçon de Lyon, également détenus dans les prisons d’Aix sous prétexte d’incivisme, furent pendus à des arbres de la vallée de Fenouillère, et la nuit suivante, le nommé Nicolas Gide, du lieu de Bouc, fut aussi pendu à l’un des arbres de la seconde Rotonde, au bout des allées qui bordent le chemin de Marseille.
Dans la nuit du 22 au 25 février, Honoré Peisse, ouvrier orfèvre, fut encore pendu à un autre arbre de la seconde Rotonde, et la nuit d’après, Jérôme Ravel, de Salon, et Thomas Curnier, dit le Rouge, le furent également au même lieu. La plupart de ces malheureux étaient des jeunes gens qui s’étaient montrés contraires à la révolution, et il n’en fallait pas davantage pour être proscrit.
Enfin, dans la matinée du 6 mars, un cabarétier nommé Jean-Claude Gavaudan, qu’un détachement de la garde nationale conduisait au tribunal de police correctionnelle à cause de quelques propos qu’il avait tenus contre la révolution, est enlevé par les sans-culottes et pendu à un reverbère dans la rue de l’Official, en face de celle de la Glacière. 4
Pendant que ces faits avaient lieu et à l’aide de la terreur qu’ils inspiraient, des contributions d’argent étaient exigées des citoyens connus par leurs opinions opposées à celles des révolutionnaires : une somme de trente mille francs fut notamment imposée à un négociant du Faubourg 5 et versée par lui, le soir même,18 février, sur le bureau du club des Anti-Politiques, qui délibéra de les employer à l’achat de mille fusils pour les défenseurs de la patrie ; mais on doute fort que cette destination ait jamais été remplie.
Tant de forfaits qui menaçaient la vie et la fortune de tous les citoyens et qui étaient impunis par suite de la faiblesse ou de la connivence des autorités constituées, soulevèrent enfin les habitants. A l’exemple de ceux de Marseille où de pareils crimes se commettaient encore plus fréquemment qu’à Aix, ils se réunissent dans leurs sections respectives, mandent dans leur sein les juges de paix, et font instruire par ceux-ci des procédures contre les auteurs des pendaisons et les exacteurs des contributions forcées. Les représentants du peuple, Moyse Bayle et Boisset, envoyés par la Convention nationale dans les départements des Bouches-du-Rhône et de la Drôme, cassent ces procédures et font mettre en liberté ceux des coupables qui avaient été arrêtés, disant que la ville d’Aix est le Coblentz du midi et en plein état de contre-révolution. Il fut constaté que le médecin Pâris, d’Arles, révolutionnaire forcené, président du département, se trouvant à Aix, dit alors publiquement qu’il ne fallait pas des patriotes honnêtes, mais des pendeurs, et que faire le procès à ceux-ci c’était le faire à la révolution elle même. Tout ceci se passait au mois d’avril 1793. A la fin du même mois, les sections de Marseille envoient des commissaires à Aix qui y rétablissent les sections. Celles-ci reprennent les poursuites contre les pendeurs et les pillards et font traduire devant le tribunal populaire que les sections de Marseille avaient établi chez elles, une douzaine de ces criminels que nous ne nommerons pas par égard pour leurs familles qui peut-être existent encore. Ce tribunal populaire que la Convention nationale avait cassé comme illégal par un décret du 12 mai, n’en continuait pas moins ses fonctions, et avait fait mettre à mort, à Marseille, plusieurs de ces pendeurs. Il en condamna quelques-uns d’Aix à la même peine, savoir : un maçon, qui fut traduit en cette ville et décapité sur la place des Prêcheurs le 31 juillet ; puis, un perruquier amené également à Aix et décapité le 13 août, comme convaincus, l’un et l’autre, de soustraction d’effets nationaux provenant des émigrés, de complots tendant à l’anarchie et au meurtre, de contributions forcées et d’enlèvement de détenus aux prisons pour leur faire subir une mort violente ; enfin, il en condamna, par un seul jugement, huit autres appartenant au bas peuple, à la peine capitale, et on les traduisait à Aix pour y subir leur jugement, lorsqu’étant arrivés à mi-chemin, le commissaire des sections qui les accompagnait, instruit que l’armée de la Convention nationale sous les ordres du général Carteaux, venait de faire son entrée à Aix , fit rebrousser le convoi, et les huit condamnés furent exécutés à Marseille le même jour 21 août 1793.
Les fatales suites de l’entrée du général Carteaux à Aix et à Marseille sont connues : des flots de sang ruisselèrent dans le Midi et successivement dans toute la France. Nous avons fait imprimer les noms des victimes qui périrent sous le règne de la Terreur jusqu’à la cessation de la tyrannie de Robespierre, au nombre de soixante pour notre ville seule. 6 Une terrible réaction, dont nous parlerons plus tard, 7 eut lieu en 1795 et en amena d’autres qui ne cessèrent enfin que lorsque Bonaparte se fut affermi sur le trône et eut comprimé tous les partis avec son bras de fer.
Sur la même ligne orientale de la rue de La Cépède est située l’ancienne et jolie église du collége Royal-Bourbon, dont nous avons déjà dit quelques mots. 8 Elle fut bâtie par les Jésuites en 1681 et la première pierre en fut bénie et posée, le 10 avril qui se trouvait le jeudi après Pâques, par le cardinal Grimaldi, archevêque d’Aix. Les fonds nécessaires pour cette bâtisse avaient été laissés aux Jésuites par l’abbé Jean de Geoffroy de la Tour, de la ville de Digne, mort à Aix au mois de septembre 1679, dont les dispositions testamentaires furent toutefois querellées par sa famille ; mais un arrêt du parlement confirma ces dispositions.
Les Etats-Généraux de Provence , suspendus depuis leur session tenue à Aix au mois de février 1639, et que remplaçait depuis lors l’assemblée annuelle des communautés du pays, ayant été convoqués en cette ville par Louis XVI, au 31 décembre 1787, les membres qui les composaient se rendirent processionnellement, ledit jour, dans l’église du collége Royal-Bourbon, où furent présents l’archevêque d’Aix (M. de Boisgelin), président, les évêques de Marseille, de Grasse, de Sisteron, de Fréjus, d’Apt, de Vence, de Sénez, de Digne et de Toulon, tous en rochets et camails violets, les procureurs-fondés de l’archevêque d’Arles et de l’évêque de Glandèves, le prévôt de Pignans, le procureur-fondé de l’abbé de Saint-Victor-lez-Marseille et cinq commandeurs de l’ordre de Malte, pour l’ordre du clergé ; cent vingt-huit gentilshommes possédant-fiefs, pour l’ordre de la noblesse; quarante-deux consuls députés des communautés et vingt députés des vigueries qui, réunis aux précédents, formaient soixante-deux membres de l’ordre du tiers-état. Le comte de Caraman, commandant en chef en Provence, et M. des Gallois de la Tour, premier président du parlement d’Aix et intendant de justice, police et finances en Provence, l’un et l’autre commissaires du roi, avertis par les greffiers des Etats que l’assemblée était formée, s’y rendirent aussitôt en grande cérémonie, et, après les discours d’usage, il fut résolu d’aller en corps entendre une messe solennelle du saint-esprit dans l’église métropolitaine de Saint-Sauveur, chantée par Mgr l’archevêque d’Aix. Les délibérations des Etats commencèrent ensuite, le 2 janvier 1788, dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville et ils s’occupèrent des affaires du pays pendant dix-huit séances, dont la dernière fut tenue le 1er février.
L’année suivante une pareille convocation des Etats-Généraux de Provence eut encore lieu à Aix, et la première réunion se fit dans l’église du collége Royal-Bourbon le 26 janvier 1789 ; mais les députés des communautés et des vigueries, composant l’ordre du tiers-état, refusèrent d’en reconnaître la légalité, se fondant sur ce que les deux premiers ordres, c’est-à-dire le clergé et la noblesse y assistaient en nombre bien supérieur à celui du tiers-état. Le comte de Mirabeau était venu prendre place au rang des possédant-fiefs et fesait néanmoins cause commune avec les députés des communautés et des vigueries, soufflant de tout son pouvoir le feu de la discorde, et de cette assemblée sortit la première étincelle qui devait bientôt embraser la France entière. Tant d’écrits, tant de mémoires imprimés ont paru depuis lors, qu’il serait superflu de pousser plus loin l’analyse de cette mémorable lutte qui, en amenant la ruine des deux premiers ordres, entraîna à leur suite l’ancienne monarchie française. Mirabeau, député d’Aix aux Etats-généraux de France en 1789, les poussa plus qu’aucun autre à se constituer en assemblée nationale, à se présenter comme supérieurs à l’autorité du roi, et de là ce bouleversement général qui a fini par changer la face du monde.
1 Voyez en ce tom. II, pag. 4. Retour
2 Voyez ci-dessous, Cours Sainte-Anne. Casernes. Retour
3 Voyez au 1er vol. Pag. 16. Retour
4 Nous avons suivi, quant au nombre et aux noms de malheureuses victimes, les mémoires manuscrits, actuellement en notre pouvoir, de M. Laurans, avocat, qui avait publié avant la révolution, conjointement avec son ami Jean-Baptiste Janety, procureur à la sénéchaussée d’Aix, un Journal du palais de Provence dont il avait paru sept ou huit volumes in-4°. – Auguste Laurans, né à Aix en 1732, fut nommé au mois d’octobre 1795, juge au tribunal civil du département des Bouches-du-Rhône séant à Aix, par l’assemblée électorale composée, en majeure partie, d’électeurs anti-révolutionnaires, ce qui rendit bientôt ce tribunal suspect au Directoire exécutif de la république. Le 5 janvier 1798, ce magistrat fut arrêté dans sa maison et emprisonné en vertu d’un mandat d’amener décerné contre lui par le Directoire, ainsi que quatre de ses collègues, MM Mouret, d’Aix, Faucon, de Marseille, qui remplissait en ce montent les fonctions de directeur du jury, Simon, d’Arles, et Fauverge, d’Eygalières, tandis que deux autres juges du même tribunal, MM. Tassy et Simon, l’un et l’autre d’Aix, étaient arrêtés à Arles et à Marseille, où ils exerçaient les mêmes fonctions de directeurs du jury. Ces deux derniers ayant été transférés à Aix les jours suivants, les sept magistrats furent envoyés, le 12 janvier, sous une bonne et sûre escorte, à Paris, pour être ouïs par le Directoire, sur la part que celui-ci les accusait d’avoir prise à la réaction royaliste de 1795, 1796 et 1797. Après vingt-huit jours de marche, dans la saison la plus rigoureuse, ils arrivèrent à Paris le 9 février, et furent conduits directement au Temple où on les mit au secret pendant deux jours. Interrogés enfin par le ministre de la police générale, on leur donna le Temple pour prison, et ils y demeurèrent pendant quatre mois et demi, au bout desquels le Directoire, s’étant dessaisi de leur affaire, les renvoya devant le directeur du jury d’accusation de Saint-Marcellin en Dauphiné, pour être traduits, s’il y avait lieu, au tribunal criminel de Grenoble, sous la prévention de correspondance avec les émigrés et les agents du Prétendant (Louis XVIII), et d’avoir poursuivi les patriotes et les républicains en 1795, 96 et 97. Ils sortirent donc du Temple le 26 juin, et, après quelques jours de séjour à Paris sous la garde d’un agent du gouvernement, ils partirent pour Saint-Marcellin, où M. Enfantin, directeur du jury, ne trouvant aucun motif d’accusation contre eux, les mit en liberté, les renvoyant honorablement à leurs fonctions le 11 août suivant. M. Laurans, alors âgé de soixante-six ans, a laissé un journal intéressant de sa translation à Paris et de sa captivité au Temple, dont nous possédons le manuscrit autographe, où il a relaté tout ce qu il a vu sur la route et à Paris, n’oubliant pas, on le pense bien, le souvenir de Louis XVI, de la reine Marie-Antoinette et des autres membres de la famille royale qui avaient, habité la même prison avant lui. Malheureusement ce manuscrit offre quelques lacunes provenant de la perte de plusieurs cahiers. M. Laurans, devenu plus tard juge au tribunal de première instance d’Aix, mourut en cette ville en 1820, âgé de quatre-vingt-huit ans. – Voyez, sur la captivité de ces messieurs, le Mémoire de P.F. de Remusat, de Marseille, à la suite de ses Poésies diverses, imprimées à Paris en 1817, in-8°, pag. 280 et 281. Retour
5 M. Abrard. Retour
6 Voyez au 1er vol., pag. 625 et suiv., not. 1, et pag. 663. Retour
7 Voyez ci-dessous, Cours Sainte-Anne. Casernes. Retour
![]()
