
Les Rues d’Aix
ou recherches historiques sur l’ancienne capitale de Provence
par Roux-Alpheran en 2 tomes 1848 et 1851
>>> Retour Accueil du Blog <<<
RUE DU GRAND-BOULEVARD
OU DE LA
PLATE-FORME
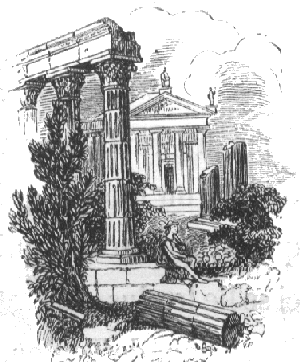 CETTE rue, la plus belle du quartier de Ville-Neuve, est, en même temps, une de celles qui offrent le plus de souvenirs biographiques et quelques traits historiques que nous allons rappeler. C’est là que sont nés : M. le comte Siméon (Joseph-Jérôme), avocat, assesseur d’Aix en 1783 et 1784 ; 1 successivement député au conseil des Cinq-Cents qu’il présidait à la fatale époque du 18 fructidor , lors de laquelle il fut condamné à la déportation ; membre du Tribunat et du conseil d’Etat, ministre de la justice et de l’intérieur du royaume de Westphalie ; préfet du département du Nord et ministre de l’intérieur sous le roi Louis XVIII, pair de France, membre de l’institut, etc., etc.2 Savant homme d’Etat, jurisconsulte profond, orateur distingué, sa statue en pied sera placée incessamment, par décision du gouvernement, au palais de justice d’Aix, avec celle de M. Portalis, son beau-frère, dont nous parlerons ailleurs.
CETTE rue, la plus belle du quartier de Ville-Neuve, est, en même temps, une de celles qui offrent le plus de souvenirs biographiques et quelques traits historiques que nous allons rappeler. C’est là que sont nés : M. le comte Siméon (Joseph-Jérôme), avocat, assesseur d’Aix en 1783 et 1784 ; 1 successivement député au conseil des Cinq-Cents qu’il présidait à la fatale époque du 18 fructidor , lors de laquelle il fut condamné à la déportation ; membre du Tribunat et du conseil d’Etat, ministre de la justice et de l’intérieur du royaume de Westphalie ; préfet du département du Nord et ministre de l’intérieur sous le roi Louis XVIII, pair de France, membre de l’institut, etc., etc.2 Savant homme d’Etat, jurisconsulte profond, orateur distingué, sa statue en pied sera placée incessamment, par décision du gouvernement, au palais de justice d’Aix, avec celle de M. Portalis, son beau-frère, dont nous parlerons ailleurs.
Le vicomte puis comte Siméon (Joseph-Balthazar), fils du précédent, 3 que dès la plus tendre enfance nous comptions au nombre de nos plus chers amis. Longtemps attaché à la légation de France ou secrétaire d’ambassade au congrès de Lunéville, à Florence, à Rome et à Stuttgard ; de là, représentant du roi de Westphalie à Berlin, à Darmstad, à Francfort et à Dresde ; ensuite, préfet du Var où il a fait tant de bien ; puis, à Arras, conseiller d’Etat, pair de France, membre de l’institut, etc.
Le père Bougerel (Joseph), Oratorien, né dans la maison qu’occupèrent plus tard les Siméon 4 ; biographe infatigable, à qui l’on est redevable d’une immense quantité de matériaux pour les vies des hommes illustres de Provence, et d’une foule de pièces imprimées dans divers recueils, tous écrits d’une main un peu pesante, il est vrai, mais qui ne sont pas moins très utiles et font le plus grand honneur aux recherches de l’auteur.
Gaspard Grégoire, auteur de la spirituelle Explication des cérémonies de la Fête-dieu d’Aix, (dont nous avons donné une longue analyse dans notre premier volume ; ouvrage si populaire dans notre ville et qui devient chaque jour plus rare. 5 Doué de beaucoup d’esprit et d’un caractère aimable et gai, il a laissé en manuscrit quelques pièces de vers provençaux dont nous allons soumettre à nos lecteurs celle qui nous parait préférable, espérant qu’elle leur faira quelque plaisir. 6 Elle fut envoyée par l’auteur, sous le voile de l’anonyme, à M. de Brancas, alors archevêque d’Aix, qui était, à cette époque, en guerre ouverte avec le parlement à cause des affaires du molinisme et du jansénisme. Le prélat, ouvrant le paquet, s’imagina que les cadets se liguaient avec le parlement : – Bon Dieu ! s’écria-t-il, eux aussi sont contre moi ! – et le papier lui échappa des mains. Son secrétaire le ramassa timidement et l’ayant lu à part lui : – Pas si mauvais, Monseigneur, – lui dit-il ; ce qui donna envie à M. de Brancas de reprendre l’écrit et il lut ce qui suit :
VERS D’UN CADET D’AIX
CONTRO MOUSSU L’ARCHEVESQUEEs dich qu pourtara lou faïx.
Aro qué voulés qué l’y fassi ?
Lou bouen Diou m’a fa cadet d’Aïx,
Ah ! si m’aguesso fa la graci
Dé mé durbi la pouerto de l’engraïs,
S’en nié pastan mé faguesso archévesqué,
Vouéli qué Cerbéro mé pesqué
Si dins un pu riché palaïs
Comus aourié fa miyou chiéro.
Pertout indulgenço plénièro
Et cent counvivos toujours gaïs
Leis fins espépiounets de douctrino embuyado
Aourien lougea luen dé chés yeou ;
Aouriou per la graci dé Diou
Distingua touto la joumado
Lou mous d’émé l’aïgo signado ;
Et piei (per pareissé la flous
Et la crémo deis benhuroux)
Leis hueis bas, certains jours de festo,
La crosso en man, la mitro on testo,
D’oou grand Melchisédech remplissant leis founctient
Su leis maou pinchinats qué ma glori détesto,
Aouriou tacha cent fès mille bénédictiens.
D’un grand prélat la plus terriblo affaïré
Es d’estré huroux et dé ren faïré.
Qu’es vouestre moussu dé Brancas ?
Dé vous à yeou, n’ai jamaï fa grand cas.
Es l’ennémi de la fricasso,
Viou qué dé parpellos d’agasso,
Soun cousinié counei ni rabasso, ni lard,
Saou ben ben cé qu’es uno intrado,
Et soun plat favouri din leis réglos dé l’art
Es uno excellento grillado
Dé bouens boudins dé Parricard.
Qu’un prélat de la métropolo
Mespréso ansin la caceirolo ?
Si poou pas pu maou agir.
Quand voudra li faraï légir
Dins un libré qu’aï dins ma pocho,
Qu’un évesqué qué sé réprocho
Quod ore dé vins à grands frés ;
Qué mesprésant leis miyous mets
Laïsso enrouir soun tournobrocho,
Es qu’un évesqué deis fourés.
Pouédi plus ténir lou clistéri.
Nouestré archévesqué es un arléri.
Saou pas cé qué voou, car enfin
Espragno, espragno, et piei un beou matin
Duerbé seis bras à la miséri ;
Escampo tout soun sanfresquin.
Amo la tiblo et leis manobros
Per arroundir bis bouenos obros.
Quand disi bouenos n’aï menti.
Pécaïré! A lou tic de basti
MilIo cagnards per la pooutrayo :
Sameno partout d’espitaoux ;
Songeo eis counvalescens que soun panqua malaoux.
L’incurablé qu’un maou esfrayo,
Fillo qu’aurié fa uno sounayo,
Certains enfans abandounas,
Fouesso aoutrés maou endouctrinas,
Vieï célébrant qué n’a ni moudélo ni crousto,
Quand ploou, tout aquo es à la sousto.
N’oouriou ren dit s’aviou nounchalament
Gita un coou d’huei sur lou gros bastiment
Deis tounsuras dé fresquo dato
Qu’an touteis la frisuro plato.
Maï, perque mettré tant d’enfans
Dins un picbot mouélé dé capellans ?
Li passariou d’avé moustra soun zèlo
En aguent dit bouen soir à sa veisselo. 7
Maï piei d’oou billet qué n’a fach ?
Diou merci, n’ooura pas récoumpenso éternello,
Parcé qu’en lou donnant sé bagnet dins lou lach.
Tant dé soucis, tant dé féblessos,
Escarfoun trop soun antiquo noublesso :
Brancas farié pas maou dé s’en paou respecta.
Fa ren qué noun fassé piéta.
Et quand s’agis dé la Prouvinço,
Clabaoudo coumo un désoula. 8
Démandoun, fa l’ooureillo sourdo,
Dis qué lou pays es nébla.
Voudrié qué chaqué gran dé bla
Foussé gros coumo uno cougourdo.
En qu Diou nando tant dé ben ?
A Brancas qu’es jamaï counten,
Et qué jamaï sé tranquilliso ;
Qué déourié, sachen ren dé ren,
Estré un gros capoun dé l’égliso.
Piei, dourmé pas : boueno salu !
Qué lou maou encouès lou révessé !
Car tout counta, tout rabattu,
S’aquo va toujours d’oou mémé essé
Siou ségur qu’avant qué juech cessé,
Inventara quoouquo vertu.
A quelque temps de là, on se trouva au jour de l’an. A cette époque, tous les principaux habitants de la ville allaient offrir leurs hommages et leurs vœux à Mgr l’archevêque. Parmi eux, M. de Brancas en voyait plusieurs qui étaient ses antagonistes, tout en rendant justice à son mérite personnel et à ses vertus. Il leur donna, ce jour-là indirectement, une petite leçon sur l’oubli des injures ; car, apercevant M. Grégoire dans la foule, il fut à lui et lui dit :
Sias destapa, moussu Grégori !
Tout lou maou qu’avés dich dé you
S’es escarfa dé ma mémori ;
L’ooublidi per l’amour dé Diou.
On se rappellera longtemps dans Aix l’épiscopat de M. de Brancas, mort le 30 août 1770, plein d’années et de bonnes oeuvres. Il faisait tous les ans des aumônes abondantes et avait fondé à Aix plusieurs établissements considérables, tels que l’Oeuvre des Orphelines ; celle de Sainte-Marcelle en faveur des pauvres servantes qui se trouvaient sans condition ; l’aile de l’hôpital Saint-Jacques destinée aux convalescents ; les enfants abandonnés où les enfants délaissés par leurs parents trouvaient à se coucher la nuit, après avoir eu du pain et des légumes pour leur souper, et où on les instruisait des devoirs de la religion ; les frères des Écoles Chrétiennes pour apprendre aux enfants du peuple la lecture, l’écriture et l’arithmétique ; le petit Séminaire, hors la porte Bellegarde, là où sont aujourd’hui les Frères-Gris ; des fonds sur la province dont les revenus étaient distribués par forme de pensions de 50 et de 25 écus, suivant l’âge, aux prêtres vieux et valétudinaires, qui avaient peu de moyens d’existence etc. 9
L’aimable poète provençal dont nous venons de parler, avait eu de nombreux enfants, dont trois méritent d’être mentionnés ici après lui :
Louis-Denis Grégoire, né le 9 octobre 1750, secrétaire de la musique de l’empereur Napoléon, puis de la chapelle du roi Louis XVIII ; mort à Marseille le 6 juin 1840, dans sa quatre-vingt-dixième année. C’était un homme d’un esprit vif et très gai, comme son père. Il a laissé des mémoires manuscrits qui sont assurément fort curieux, à en juger par quelques fragments qui ont été publiés dans des journaux, à l’époque de sa mort. Il est à désirer que ces mémoires soient imprimés. 10
Gaspard Grégoire, né le 21 octobre 1751, inventeur de l’ingénieux procédé au moyen duquel il exécutait en velours des portraits d’une vérité frappante, des fleurs, des tableaux même de la plus ravissante fraîcheur ; mort à Paris le 1er mai 1846, dans sa quatre-vingt-quinzième année.
Paul-Pierre Grégoire, né le 18 octobre 1755, muet de naissance et peintre assez distingué ; mort à Paris le 7 juin 1842, à quatre-vingt-sept ans.
Ces trois frères avaient concouru à la publication de l’ouvrage de leur père sur la Fête-Dieu d’Aix, en 1777, en dessinant les figures, notant les airs et gravant les planches qui accompagnent cet ouvrage. 11
Dans la même rue où est située la maison Grégoire, se trouve l’ancien hôtel de Maliverny, auparavant des Antelmy-de-La-Cépède, qui est entouré de trois rues : celle du Grand-Boulevard dont nous parlons, la rue des Jardins et celle du Collége. Mabile de Maliverny, fille et petite-fille de présidents au parlement, unique héritière de son nom et d’une grande fortune, ayant épousé, en 1751, le marquis de Marignane et des Iles-d’Or, alla habiter avec lui l’hôtel qu’il possédait à la rue Mazarine, et y maria, en 1772, avec le fameux comte de Mirabeau, la fille unique issue de son mariage comme nous le dirons plus longuement en parlant de la rue Mazarine. Si nous en disons quelques mots ici, c’est pour relever une erreur commune à bien des gens, qui confondent l’hôtel de Maliverny avec celui de Marignane, et croient que le premier que nous nommons, c’est-à-dire celui de la rue du Grand-Boulevard, est le même où s’est marié Mirabeau, tandis que c’est dans celui de la rue Mazarine qu’eut lieu le mariage en question. La célébrité qu’a acquise depuis le fougueux tribun, donne seule de l’importance à un fait aussi minime et aussi insignifiant que celui-là ; mais il paraît qu’on y tient, et dès lors nous voulons le constater avec exactitude.
Vers le centre de la ligne méridionale de la rue est situé l’hôtel de Panisse, dont la façade, entièrement en pierres de taille, est remarquable par son architecture et par les sculptures de la porte d’entrée. Elle fut reconstruite, en 1739, par Henri de Thomas, marquis de la Garde, baron de Cipières, seigneur de Villeneuve-Loubet, ancien conseiller au parlement, qui fut, pendant tout le cours de sa vie, le père et le soutien des pauvres, et qui, en mourant sans enfants, laissa sa riche succession à la famille de Mark-Tripoli-Panisse de Pazzis. C’est dans cet hôtel que naquit, en 1770, M. le comte Pierre-Léon de Panisse, que le roi Charles X décora de la pairie et qui est mort, il y a quelques années, à Marseille, où il s’était marié et où il a laissé les souvenirs les plus honorables et les mieux mérités par la noblesse de son caractère et par sa généreuse conduite dans les temps orageux qu’il eut à traverser.
Le bel hôtel qui se présente au commencement de l’île suivante en descendant vers le palais et qui fait le coin de la rue de La Cépède, fut bâti, vers l’année 1590, par Jean Ganay, alors trésorier général des Etats de Provence ; c’est donc l’un des plus anciens édifices du quartier de Ville-Neuve.
Eléonore des Prèz de Montpezat, comtesse de Carces, l’acquit en 1612, et l’habita jusqu’à sa mort, arrivée en 1658, ainsi que Jean II de Pontevès, son fils, comte de Carces, grand sénéchal et lieutenant général du roi en Provence, mort sans enfants deux ans avant sa mère. 12 Cette dame était fille du premier lit de la duchesse de Mayenne, et avait épousé, en 1588, Gaspard de Pontevès, comte de Carces, 13 qui joua un grand rôle en Provence pendant la Ligue, et qui la laissa veuve en 1610. Outre le fils auquel elle survécut , elle avait eu une fille, Gabrielle de Pontevès, mariée à Guillaume de Simiane, marquis de Gordes, chevalier des ordres du roi et capitaine des gardes du corps de S. M. De ce mariage était né François de Simiane, aussi chevalier des ordres du roi, qui, par la mort de son oncle, recueillit la riche succession de la maison de Carces dont il joignit le nom au sien. 14 Ce François de Simiane succéda également aux charges de grand-sénéchal et de lieutenant du roi dont le frère, le père et l’aïeul de sa mère avaient été pourvus de leur vivant. Il habitait l’hôtel dont nous parlons, lorsque Louis XIV, la reine-mère Anne d’Autriche, le cardinal Mazarin et toute la cour vinrent à Aix, en 1660, comme nous l’avons déjà dit, 15 et il en céda une partie aux filles d’honneur de la reine.
Une ancienne tradition veut que quelques jeunes étourdis profitant de l’obscurité d’une nuit des plus sombres allèrent altérer la plaque de marbre placée sur la porte d’entrée, portant en lettres d’or l’inscription HÔTEL DE CARCES, en ajoutant une S au second mot, et substituant un G à la lettre initiale du troisième ; ce qui scandalisa fortement ces demoiselles et la reine-mère. Mais Louis XIV, alors jeune, rit beaucoup de cette espièglerie dont les auteurs ne furent pas recherchés, sans doute parce que le monarque avait ri.
L’hôtel de Carces fut vendu deux ans après à Pierre de Coriolis, marquis d’Espinouse, président au parlement. C’est au fils de celui-ci, également président à mortier (et il y en a eu sept dans cette famille de père en fils, de 1568 à 1786), 16 c’est à son fils, disons-nous, qu’arriva la singulière aventure que nous allons raconter.
Vers 1695, un prince étranger passa par Aix, se rendant en Italie. Il venait de Paris où il avait vu l’ancien premier président Marin, dont nous aurons occasion de parler. 17 Le prince lui avait demandé quelle était la meilleure auberge de cette ville, et. le malicieux président avait indiqué l’Hôtel de Coriolis.
Le président d’Espinouse était à l’audience lorsqu’on vint l’avertir qu’un courrier du prince de . . . . . était arrivé, annonçant que son altesse descendrait chez lui dans quelques heures. Devinant aussitôt d’où partait le coup, il quitte le palais et se rend à son hôtel pour donner ses ordres, recommandant surtout à sa famille et à ses gens la plus grande discrétion dans ce qui va se passer. Il se costume en maître d’auberge, et lorsque le prince arrive, il le reçoit à la descente de la voiture et le conduit dans l’appartement qui lui avait été préparé.
Le prince est surpris de la magnificence des meubles, du nombre des domestiques, en un mot de tout ce qu’il voit, bien supérieur à ce qu’on lui avait dit à Paris de cet hôtel : » Je suis d’autant plus flatté, monseigneur, lui dit le président, de l’honneur que me fait votre altesse, que chaque semaine une quarantaine de personnes des plus distinguées de la ville, font un pique-nique chez moi, et c’est précisément aujourd’hui qu’elles doivent se réunir. Si votre altesse daignait assister à ce pique-nique, leur bonheur et le mien seraient au comble. – Volontiers, – dit le prince, qui n’est pas fâché de connaître la bonne société d’Aix. En effet, au bout de quelques heures arrivent une vingtaine de cavaliers des plus aimables et autant de jolies femmes, que le président avait fait inviter et qu’il avait choisis parmi ce qu’il y avait de mieux dans Aix. Le prince descend au salon et est frappé de cette brillante réunion. On fait de la musique, et lorsque le repas est prêt, le prétendu maître-d’hôtel vient annoncer que son altesse est servie. Le prince offre son bras à une dame qui lui dit, en passant à la salle à manger : – Monseigneur, notre usage est de faire asseoir et manger avec nous le maître-d’hôtel qui est homme de bonne compagnie ; mais il ne l’osera pas aujourd’hui, à moins que votre altesse n’ait la bonté de le permettre. Je suis chargée de vous en faire la demande au nom de la société. – J’y consens, reprend aussitôt le prince, ne voulant en aucune manière contrarier vos usages. » – Le président d’Espinouse remercie et se place au milieu de la table pour en faire les honneurs, tandis que le prince était au haut bout, assis entre deux dames.
La table était servie magnifiquement, chargée de vaisselle et éclairée par une infinité de bougies. La chère fut des plus exquises, et au dessert, lorsque plusieurs dames eurent chanté, le président voulut chanter aussi un couplet de sa composition en l’honneur du prince. Celui-ci ne revenait pas de son étonnement, disant que nulle part, à Paris même, il n’a rencontré de meilleure société, ni de meilleur ton, et que jamais il n’oubliera son passage à Aix. Une partie de la nuit s’écoula dans les plaisirs, soit à table, soit dans le salon, où l’on recommença de faire de la musique, et l’on ne se sépara qu’à deux ou trois heures du matin.
Le lendemain, le prince voulant continuer sa route, fait demander le compte de sa dépense. Le maître d’auberge arrive tenant un papier à la main et le présente au prince, qui y lit avec la plus grande surprise, qu’il n’est point descendu dans une auberge, mais dans l’hôtel du marquis de Coriolis d’Espinouse, président à mortier au parlement d’Aix, qui s’est trouvé très flatté d’avoir donné l’hospitalité à son altesse. – » Monsieur de Marin, ajoutait le mémoire, a cru me mettre dans l’embarras ; mais j’ai fait de mon mieux pour que son attente fût trompée, et si j’ai réussi, je lui en dois des remercîments. » – Le prince, en homme poli, se borna dans le moment à faire les siens, et ne parla plus de payer la dépense qu’il avait occasionnée ; mais à quelque temps de là, une occasion s’étant présentée de rendre un service important au président d’Espinouse, il la saisit avec empressement, et lui prouva qu’il se souvenait de la réception qui lui avait été faite à l’Hôtel de Coriolis.18
Cet hôtel, que MM. d’Espinouse ont possédé jusqu’à l’époque où ils sont allés se fixer à Paris, il y a une cinquantaine d’années, appartient aujourd’hui à M. le conseiller d’Etat Mottet, premier maire d’Aix après la révolution de 1830, et membre actuel de la chambre des députés.
La première maison de l’île qui fait face à cet hôtel et qui fait coin elle-même dans la rue de La Cépède, appartenait, en 1630, à Isaac Chaix, auditeur à la cour des comptes, en haine duquel elle fut dévastée et pillée de fond en comble lors de la sédition contre l’intendant d’Aubray, dont nous avons parlé dans notre premier volume 19 et sur laquelle nous ne tarderons pas à revenir. C’est dans cette maison qu’était né, le 3 janvier 1763, M. l’abbé Guairard (Siméon-Théodore-Hippolyte), ancien doctrinaire, l’un des plus spirituels collaborateurs du Mercure de France et du Journal des Débats, au commencement de ce siècle ; puis recteur de l’académie de Clermont, inspecteur-général des études, etc., mort en cette ville d’Aix au mois de janvier 1846, entrant dans sa quatre-vingt-quatrième année.
Un peu plus bas, en descendant vers le Pont-Moreau, est située la maison où naquirent, de 1711 à 1734, les six frères Emérigon, Charles-Marie, Balthazar-Marie, Louis-Antoine-Marie, Pierre-Marie, Joseph-Marie et Antoine-Alexandre-Marie, qui tous se firent remarquer par leurs vertus et leurs talents, dont ils donnèrent d’éclatantes preuves aux barreaux d’Aix, de Marseille et de la Martinique. Nous parlerons plus spécialement de Balthazar-Marie, dont l’honorable M. Cresp, professeur de droit commercial à la faculté de droit d’Aix, prononça l’éloge dans la séance solennelle de cette faculté du 19 octobre 1839. 20 Né le 4 octobre 1716, Balthasar-Marie Emérigon fit une étude plus particulière du droit maritime, et se fixa à Marseille où il fut reçu, vers 1748, conseiller au siége de l’amirauté qu’il illustra par la pénétration de son esprit et par sa vaste science. Il en a laissé un monument impérissable dans son immortel Traité des Assurances, qu’il fit imprimer à Marseille chez Mossy, en 1783, en deux volumes in-4°, et qui fut traduit, presqu’aussitôt que publié, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Nous n’ajouterons rien de plus, renvoyant nos lecteurs à l’ouvrage de M. Cresp. Emérigon mourut à Marseille le 2 avril 1784, dans sa soixante-huitième année. Louis-Antoine-Marie, l’un de ses frères, né en février 1719, procureur au parlement avant la révolution, fut le premier juge de paix nommé à Aix en 1790 par l’honorable suffrage de ses concitoyens, et poussa sa carrière jusqu’à la fin de janvier 1805, lorsqu’il achevait sa quatre-vingt-sixième année.
M. Eméric-David (Toussaint-Bernard), si avantageusement connu dans le monde savant par ses nombreux ouvrages sur la peinture et la sculpture, qui lui avaient ouvert les portes de l’Institut, était né aussi dans la dernière maison de la ligne septentrionale de cette rue en descendant de la Plate-Forme vers le palais. 21
C’est par lui que nous terminerons cette longue suite de personnages distingués nés dans la rue du Grand-Boulevard.
1 Joseph-Sextius Siméon, son père, jurisconsulte célèbre, professeur en droit, assesseur d’Aix en 1764 et 1765, et dont nous nous rappelons chaque jour les bontés qu’il avait eues pour nous dans notre enfance, était né en cette ville le 8 mars 1717, et y mourut le 6 avril 1788, un mois avant l’interdiction du parlement, par où a commencé la révolution sous le ministère du cardinal de Brienne. Retour
2 Né le 30 septembre 1749, M. le comte Siméon est mort à Paris le 19 janvier 1842, âgé de 93 ans. – Nous conservons avec une bien vive reconnaissance le souvenir de l’amitié toute particulière dont il nous a honoré depuis notre plus bas âge jusqu’à son dernier jour.-Voyez le Moniteur universel du 25 janvier 1842, art. Nécrologie; – Notice biographique sur M. le comte Siméon, par M. Ch. Giraud, membre de l’institut ; Aix, Aubin, et Paris, 1842, in-8° – Discours prononcé par M. le comte Portalis (neveu de M. Siméon),dans la séance de la chambre des Pairs du 10 mars 1845, à l’occasion du décès de M. le comte Siméon ; – Notice historique sur la vie et les travaux de M. le comte Siméon, par M. Mignet, secrétaire perpétuel de l’académie des sciences morales et politiques, lu dans la séance du 25 mai 1841; Paris, Firmin Didot frères, 1844, grand in-8°. Retour
3 Né le 6 janvier 1781, il est mort à Dieppe, où il était allé prendre les bains de mer, le 14 septembre 1846, dans sa soixante-sixième année. Bon, doux, affable, obligeant, réunissant toutes les qualités de l’esprit et du cœur, il a laissé, partout où il s’était montré, les plus précieux souvenirs. Notre correspondance a duré plus de cinquante ans, et nous la conservons précieusement. Il n’avait plus reparu en Provence et nous ne l’avions plus revu depuis qu’il avait quitté Draguignan au milieu de l’année 1818, lorsqu’il vint prendre les bains de mer à Marseille, au mois de septembre 1845. Nous fûmes l’y voir, et avec quel plaisir nous nous précipitâmes dans les bras l’un de l’autre ! Hélas ! ce devait être pour la dernière fois. Il partit peu après pour Nice, d’où il alla à Rome, à Venise, à Milan, à Brescia où résidait une sœur chérie qui devait ne lui survivre que peu de mois. Rentré en France, il ne fît plus que languir, et ses amis l’ont perdu pour toujours !
Ses restes mortels furent transportés à Paris et réunis à ceux de son père dans un tombeau de famille au cimetière du père Lachaise. Il a laissé un fils aujourd’hui directeur de l’administration des tabacs, après avoir été préfet de plusieurs départements. Retour
4 Cette maison est la seconde de la quatrième et dernière île de cette rue, à droite en allant vers la porte de la Plate-Forme. – Le père Bougerel y naquit le 23 février 1680, et fut mourir à Paris, dans la maison de l’Oratoire, le 19 mars 1753. Ses manuscrits passèrent à son neveu, fils d’une sœur (F.M.A. Lafarge), mort en 1786, et dont l’auteur du Dict. des Hommes illustres de Prov. paraît avoir eu fort peu à se louer (tom. 1er pag. 120). Ces manuscrits revinrent, après lui, à la famille Bougerel, et M. Porte les possède actuellement comme mari d’une demoiselle de cette famille. – Voyez la liste des ouvrages du père Bougerel dans le dictionnaire précité et dans la Biogr. universelle de Michaud, tom. V, pag. 300 et 301. Retour
5 Il était né le 6 août 1714 et mourut le 4 juillet 1795, âgé de quatre-vingt-un ans, dans sa maison d’habitation qui est la dernière de la ligne septentrionale de cette rue, la plus voisine de la porte de la Plate-Forme et faisant le coin dans la rue de la Fonderie. C’est dans la même maison que naquirent tous ses enfants, de trois desquels nous allons parler ci-après. Retour
6 Dans le numéro du Mémorial d’Aix du 15 juin 1843, nous avions inséré une autre pièce de vers du même auteur, que nous regrettons de ne pas reproduire ici. Nous invitons les amateurs de la poésie provençale à la rechercher dans le journal sus-indiqué. Retour
7 Dans un moment où les hôpitaux d’Aix se trouvaient en une sorte de détresse, M. de Brancas fit porter sa vaisselle d’argent à l’hôtel des monnaies et envoya la reconnaissance qu’on lui en fit aux hôpitaux. Retour
8 L’archevêque d’Aix était, avant la révolution, président-né des Etats de Provence et premier procureur du pays. Les autres administrateurs de la province étaient les trois consuls et l’assesseur d’Aix. Ils étaient constamment en opposition courageuse, mais respectueuse, avec les prétentions des ministres qui, dans tous les temps, ne cherchent qu’à procurer le plus d’argent possible au trésor royal. Protecteurs-nés du peuple, ils ne recherchaient que les avantages et la gratitude de celui-ci et ne demandaient ni places ni rubans. En sortant de charge, ils rentraient modestement chez eux, n’emportant que l’estime de leurs compatriotes et la satisfaction d’avoir fait tout le bien qu’il avaient pu faire. – Voyez dans notre 1er volume, le chap. Hôtel-de-Ville, pag. 93 à 105. Retour
9 Tout annonce que la ville d’Aix va retrouver un Brancas dans l’illustre prélat que la providence vient de placer à la tête du diocèse, comme successeur du vénérable cardinal Bernet, Mgr Pierre-Marie-Joseph Darcimoles, précédemment évêque du Puy, ancien vicaire-général de Sens, etc.; né à Rueyre, dans le Quercy, le 8 décembre 1802. Mgr l’archevêque Darcimoles a fait son entrée solennelle à Aix et a été installé à Saint-Sauveur le jeudi après la Pentecôte, 27 mai de la présente année 1847. Il est petit neveu, par Mme sa mère, de feu Mgr l’archevêque de Sens, de la maison de Cosnac, qui avait donné un archevêque à notre ville en la personne de Daniel de Cosnac, nommé au mois de janvier 1687, mort à Aix le 21 janvier 1708. La même maison a fourni deux prévôts à l’église de Saint-Sauveur : Gabriel de Cosnac, nommé en 1690, démissionnaire en 1702 ; et Daniel-Joseph de Cosnac, élu en 1724, démissionnaire en 1730, et qui ont été depuis, l’un et l’autre, évêques de Die. Retour
10 Voyez la Gazette du midi du……….. et la Gazette de France du 10 novembre 1843, où se trouvent des extraits fort amusants et très piquants de ces mémoires. Retour
11 Un autre de leurs frères, Joseph-Joachim, né le 20 septembre 1758, procureur au parlement avant la révolution, est mort à Marseille le 9 avril 1844, à quatre-vingt-six ans. Retour
12 C’est du nom de ces deux personnages que cette rue a été appelée, pendant un demi-siècle, la rue de Carces. Retour
13 Voyez au 1er vol., pag. 546 et 547. Retour
14 Du mariage de François de Simiane, marquis de Gordes et comte de Carces, avec Anne d’Escoubleau de Sourdis, était née Anne-Thérèse de Simiane, marquise de Gordes et comtesse de Carces, mariée à François-Louis-Claude-Edme de Simiane, son cousin, marquis de Moncha, d’où naquit Anne-Marie-Christine de Simiane, marquise de Gordes et de Moncha, comtesse de Carces, mariée à Emmanuel-Théodose de la Tour-d’Auvergne, duc de Bouillon, d’où naquit Anne-Marie-Louise de la Tour-d’Auvergne, marquise de Gordes et comtesse de Carces, mariée à Charles de Rohan, prince de Soubise, d’où naquit Charlotte-Godefride-Elisabeth de Rohan Soubise, marquise de Gordes et comtesse de Carces, mariée à Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé, d’où naquit Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, dernier marquis de Gordes et dernier comte de Carces mort misérablement au château de Saint-Leu, au mois d’août 1830, vingt-six ans après le meurtre du malheureux duc d’Enghien, son fils unique. Retour
15 Voyez au 1er vol., pag. 275 et suiv. Retour
16 Voyez au tom. 1er, pag. 242 et suiv. Retour
17 Voyez ci-après, rue Villeverte. Retour
18 Cette anecdote est racontée, à peu près comme elle l’est ici, dans les Souvenirs de deux anciens militaires, (l’un desquels, M. de Fortia de Pilles, était fils d’une demoiselle d’Espinouse) ; Paris, Porthman, deuxième partie, 1814, pag. 208 à 219. On la trouve aussi dans l’Age d’or, un vol. in-8°, destiné aux jeunes personnes, et dont nous avons oublié la date et le lieu de l’impression. Retour
19 Pag. 46, 244, 459 et 460. Retour
20 Notice sur la vie et les travaux d’Emérigon, etc. ; Aix, Nicot et Aubin, 1839, 61 pag. in-8°, avec portrait. Retour
21 Né le 20 août 1755, M. Eméric-David est mort à Paris le 2 avril 1839, âgé de 84 ans. Retour

