
Les Rues d’Aix
ou recherches historiques sur l’ancienne capitale de Provence
par Roux-Alpheran en 2 tomes 1848 et 1851
>>> Retour Accueil du Blog <<<
RUE CARDINALE
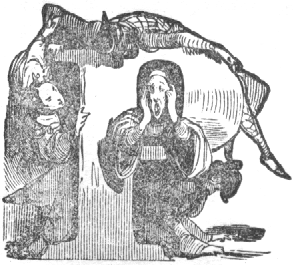 EU de rues de cette ville sont comparables à celle-ci, ainsi nommée en souvenir du cardinal Michel Mazarin, archevêque d’Aix, auteur de l’agrandissement dans lequel elle est comprise. La régularité des maisons de cette rue et des édifices publics qui y sont situés, en fait une des plus belles de la ville, et parmi ces édifices nous citerons en première ligne celui qu’occupent actuellement le Musée et l’école gratuite de dessin. C’était anciennement l’habitation des prieurs de Saint-Jean et de leur clergé, bâtie en 1671 par le prieur Jean-Claude Viany, sur la face méridionale de la place qui est devant l’église de Saint-Jean. Nous ferons de cette église un article séparé à la suite de celui-ci.
EU de rues de cette ville sont comparables à celle-ci, ainsi nommée en souvenir du cardinal Michel Mazarin, archevêque d’Aix, auteur de l’agrandissement dans lequel elle est comprise. La régularité des maisons de cette rue et des édifices publics qui y sont situés, en fait une des plus belles de la ville, et parmi ces édifices nous citerons en première ligne celui qu’occupent actuellement le Musée et l’école gratuite de dessin. C’était anciennement l’habitation des prieurs de Saint-Jean et de leur clergé, bâtie en 1671 par le prieur Jean-Claude Viany, sur la face méridionale de la place qui est devant l’église de Saint-Jean. Nous ferons de cette église un article séparé à la suite de celui-ci.
Les deux belles maisons attenantes à l’ancien prieuré du côté du couchant, appartenaient avant la révolution, l’une, à MM. de Coriolis, seigneurs de Rousset et de Moissac, cadets des barons de Limaye ; l’autre, aux marquis de La Fare, seigneurs de Bonneval, du nom de Roux ou Ruffo. Dans la première était né en 1735, l’abbé Gaspard-Honoré de Coriolis, d’abord jésuite, puis conseiller en la Cour des comptes, mort chanoine de l’église métropolitaine de Paris en 1824. Il est auteur d’un Traité sur l’administration du comté de Provence, 1 ouvrage estimé et encore très recherché de nos jours, malgré les changements survenus dans cette matière depuis 1789. Un frère de cet auteur, président à la même cour des comptes, aides et finances de Provence, était le père et l’aïeul de MM. de Coriolis, les seuls de leur nom qui habitaient encore notre ville, depuis l’extinction des barons de Limaye et l’établissement des marquis d’Espinouse à Paris, et dont la mort récente a si profondément affligé leurs nombreux amis. Un autre frère de l’abbé de Coriolis s’étant marié à Nancy, a été le père de N… de Coriolis mort au mois de septembre 1843, étant membre de l’académie des sciences, section de mécanique, et directeur de l’école polytechnique. » C’était, ont dit les feuilles publiques, un de ces hommes rares qui joignait à une science profonde, les principes religieux les mieux affermis. «
Dans la seconde de ces maisons était né, le 22 janvier 1747, l’abbé de Bonneval, Jean-Baptiste-Marie-Scipion de Roux ou Ruffo, dernier évêque de Senez que le roi Louis XVIII voulut placer sur le siége archiépiscopal d’Avignon, et qui préféra la solitude de Viterbe où il s’était retiré et où il mourut le 15 mars 1857. 2 Il avait été, en 1790, l’un des évêques qui tonnèrent avec le plus de force et d’éloquence contre la constitution civile du clergé, source du schisme dont la France catholique eut à gémir pendant dix ans. Cette superbe maison appartient aujourd’hui à M. le comte de Grignan, et fut bâtie vers l’an 1670 par Philippe-Emmanuel de Carondelet, baron de Talan, écuyer ordinaire du roi à l’académie royale d’équitation de cette ville.
Dans l’île qui suit, terminée par les rues Saint-Claude et du Cheval-Blanc ou de la Monnaie, se trouve une maison qu’avait fait bâtir et où mourut, le 2 octobre 1668, le peintre Jean Daret, qui a laissé tant de beaux ouvrages dans Aix, et qui en avait orné la plupart de nos églises. Cet habile artiste était natif de Bruxelles, et s’était marié à Aix en 1639. 3 Il eut de Magdeleine Cabassole, sa femme, d’une famille consulaire de cette ville, éteinte depuis le commencement de ce siècle, deux fils, Jean-Baptiste et Michel Daret, qui furent peintres comme lui, mais qui eurent moins de talents et de réputation que leur père. Celui-ci se qualifiait sur la fin de ses jours, de peintre du roi et de son académie royale de peinture et de sculpture à Paris, quoique son nom ne figure pas sur les listes imprimées des membres de cette académie.
Deux belles maisons contiguës, ayant une façade uniforme en pierres de taille et dont l’architecture est du meilleur goût, se distinguent encore sur la même ligne : l’une faisant le coin, dans la place Mazarine ou des Quatre-Dauphins, l’autre attenant à l’église de l’ancien couvent des Andrettes. Elle furent bâties dans les commencements du XVIIIe siècle, par Jean de Gastaud, conseiller en la cour des comptes, lequel désempara celle située au couchant, en 1712, à Jean-Joseph de Ravel, seigneur d’Esclapon. Les descendants de l’un ou de l’autre les ont habitées longtemps, mais ne les possèdent plus. Celle que s’était réservée Jean de Gastaud, la plus voisine des Quatre-Dauphins, appartient aujourd’hui à M. le marquis Marie-Joseph de Foresta. Les rois Louis XVIII et Charles X lui avaient confié successivement, sous la restauration, les sous-préfectures d’Aix en 1815 après les Cent-Jours, et de Châteaudun en 1820 ; les préfectures des Pyrénées-Orientales en 1822, du Finistère en 1823, de la Vendée et de la Meurthe en 1824, enfin celle de la Vendée, pour la seconde fois, en 1828. Il en exerçait les fonctions lors de la révolution de juillet 1830, époque à laquelle il s’associa à la mauvaise fortune de la famille royale et la suivit dans son exil à Holy-Rood.
Il a eu de sa première femme, morte en 1823 étant sous-gouvernante des Enfants de France (les petits-fils de Charles X), M. le comte Marie-Maxence de Foresta, né à Aix au mois de février 1817, non moins connu que M. son père par son attachement à la famille de ses anciens souverains. On sait qu’il eut la douleur d’être témoin, le 28 juillet 1841, du funeste accident arrivé à la promenade près de Kirchberg, à monseigneur le comte de Chambord et qui est décrit d’une manière si véridique par M. le comte de Locmaria. 4
Vers l’extrémité et toujours sur la ligne méridionale de cette rue, se voient encore les deux plus beaux couvents de religieuses que nous eussions à Aix, avant la révolution : 1° Celui des dames du second monastère de Sainte-Ursule, appelées vulgairement les Andrettes, du nom de Jacques d’André, conseiller au parlement, qui les avait fondées en 1666. Le collège de la ville y est actuellement établi ; 2° le monastère des dames religieuses Bénédictines, très anciennement fondées à la Celle, près de Brignoles, et transférées à Aix, en 1658, par le cardinal Grimaldi, archevêque de cette ville. Ces dames s’établirent d’abord dans la rue Villeverte, puis sur le Cours, enfin dans le local dont nous parlons, en 1681. Leurs archives remontaient au XIe siècle et contenaient une grande quantité de titres fort curieux de ce siècle et des suivants, émanés des anciens comtes de Provence des maisons de Barcelone et d’Anjou, des souverains pontifes, des rois de France, etc., avec leurs sceaux en plomb ou en cire. 5 C’est dans cette maison qu’avait fait profession la sœur Elisabeth-Magdeleine Pin, née à Aix le 30 septembre 1767, morte saintement à Paris le 12 février 1829, étant prieure du monastère royal du Temple. Elle avait succédé, dans ces fonctions de prieure, à madame la princesse Louise de Condé, auguste fondatrice de cette maison du Temple, qui, en mourant, avait désigné la sœur Pin pour la remplacer. Une filature de coton est établie, depuis une quarantaine d’années, dans le beau local dont nous parlons. Sous Robespierre il avait servi, de même que le couvent des Andrettes, de maison de détention pour cinq ou six cents personnes suspectes, et sous le directoire les agents de Pitt et de Cobourg y furent aussi renfermés, c’est-à-dire les citoyens les plus notables de la ville et des environs. Les hommes étaient détenus aux Andrettes et les femmes aux Bénédictines. 6
En remontant la rue, on trouve sur la ligne septentrionale l’ancienne église des Pères de la Merci, bâtie en 1684 et abandonnée en 1769, époque de la suppression de ces religieux. La maison qui suit immédiatement cette église du côté du levant, est celle où naquit, le 21 juin 1703, Joseph Lieutaud, neveu par sa mère du célèbre botaniste Pierre Garidel, et lui-même savant professeur de médecine à l’université d’Aix. Son mérite le fit appeler à Paris, où il devint successivement médecin des Enfants de France (depuis Louis XVI, Louis XVIII et Charles X), membre de l’académie des sciences, président de la société royale de médecine, etc. Louis XVI, étant monté sur le trône, ce prince le nomma son premier médecin. Il en exerça les fonctions jusqu’à sa mort, arrivée au mois de décembre 1780, et le roi ordonna qu’il fut inhumé dans l’église de Notre-Dame à Versailles. Ses héritiers firent, peu de temps après, reconstruire sa maison d’Aix, telle que nous la voyons encore.
La troisième maison au-dessus de la sienne, en avançant vers Saint-Jean, appartenait à Charles-Mathias Sabatier, avocat distingué du parlement d’Aix, assesseur de cette ville et procureur du pays pendant cinq années consécutives (du 1er janvier 1754 au 31 décembre 1758), ennobli par Louis XV en 1757, à cause de ses services. Fils d’un simple notaire du petit lieu de Bras, près de Saint-Maximin, nous l’offrons à nos lecteurs comme une preuve que sous l’ancienne monarchie le mérite et les talents étaient récompensés tout aussi noblement qu’ils peuvent l’être aujourd’hui. Il laissa deux fils, Honoré-Auguste et Jean-Antoine, desquels nous allons parler.
Honoré-Auguste Sabatier, plus connu sous le nom de Cabre qu’il avait adopté et qui était celui de sa mère, était né à Aix en 1737, et fut attaché fort jeune aux conseils du roi en qualité de maître des requêtes. Il fut ensuite chargé de quelques missions diplomatiques dont il s’acquitta avec succès. Au 10 août 1792, il fut blessé d’un coup de baïonnette tandis qu’il accourait aux Tuileries, à la défense du malheureux Louis XVI. Ardent royaliste, il ne se démentit jamais jusqu’à sa mort, arrivée à Paris en 1802. Quelques-uns lui attribuent une jolie chanson qui parut sous l’assemblée constituante et dans laquelle se trouve ce couplet si original et si vrai alors, comme il l’a été depuis à bien d’autres époques :
Quand ils partirent,
Ils nous promirent
La poule au pot.
Ils l’ont plumée
Et la fumée
Est notre lot.
L’anecdote suivante est toutefois plus authentique que la paternité de cette chanson.Sous le directoire, le marquis de Créqui (celui qui avait épousé mademoiselle du Muy, nièce du maréchal de ce nom, notre vertueux compatriote), 7 fréquentait en cachette comme un juste-milieu de ce temps-là, le directeur Barras, dont il recherchait la protection. M. de Cabre en eut connaissance, et comme le marquis ne cessait pas non plus de hanter les nobles habitants du faubourg Saint-Germain, il l’apostropha un jour assez rudement sur cette conduite équivoque et termina sa phrase par ces mots : – » Je vous le passerais, monsieur, si vous étiez un criquet ; mais un Créqui !!! »
L’abbé Jean-Antoine Sabatier, son frère, conseiller-clerc au parlement de Paris, né à Aix en 1741, suivit une carrière politique bien différente. Collègue de d’Eprémenil, il fut l’un des énergiques opposants aux fameux édits du mois de mai 1788, et se distingua dès lors par ses principes démagogiques. Mais la révolution se chargea bientôt elle-même de l’en punir et il fut forcé d’émigrer pour mettre ses jours à l’abri. Rentré en France sous le consulat, il mourut à Paris peu d’années après, très repentant de ses erreurs et détestant la part qu’il avait prise aux premiers événements de la révolution, ainsi que le témoigne son épitaphe qu’il avait composée et qu’on lit au cimetière du P. Lachaise. Nous regrettons de ne pouvoir la rapporter ici textuellement. Homme aimable et d’excellente société, on le comparait à l’abbé de Voisenon. On raconte que se trouvant, en 1778, dans un cercle où étaient de fort jolies dames, quelqu’un lui demanda malicieusement ce que c’était qu’une femme, à quoi il répondit sur-le-champ par ce quatrain :
Me demander ce que c’est qu’une femme,
A moi dont le destin est d’ignorer l’amour :
D’un aveugle affligé vous déchireriez l’âme,
Si vous lui demandiez ce que c’est qu’un beau jour.
Quelques maisons plus haut habitait, au moment de la révolution, le plus célèbre avocat que la ville d’Aix connut à cette époque ; supérieur, disait-on, par son savoir et son éloquence aux nombreux collègues qui rivalisaient avec lui au barreau, Jacques Gassier né à Brignoles, d’une famille honorable, le 16 juillet 1730 vint s’établir à Aix en 1756 et ne tarda pas à se distinguer. Le fameux Pascal 8 sut apprécier ses jeunes talents et vit en lui un digne successeur. Doué comme lui du don d’une parole puissante et persuasive, M. Gassier plaidait d’abondance et sur de simples notes ; l’on se rappelle encore à Aix qu’ayant défendu un jour la cause d’un client, moins dans l’intérêt de celui-ci, que dans celui de son adversaire et s’étant aperçu de son erreur lorsqu’il allait finir. – » Voilà,
messieurs, s ‘écria-t-il, tout ce qu’on peut objecter de plus fort contre ma partie ; voici maintenant ce que j’ai à répondre en sa faveur. » Détruisant alors, une à une, les raisons qu’il venait de donner, il en invoqua de nouvelles et de si puissantes, qu’il gagna sa cause quelques efforts que put faire l’avocat adverse. 9 La noblesse de Provence l’avait élu son syndic de robe annuel, et jalouse de se conserver un tel défenseur dans les circonstances critiques où elle allait bientôt se trouver, elle le nomma syndic perpétuel, ce qu’il était encore à l’époque de la révolution. Elle fit plus. Elle sollicita pour lui, par deux délibérations solennelles, des lettres d’ennoblissement qui lui furent accordées par le roi Louis XVI, au mois d’août 1777 et enregistrées au parlement l’année suivante. Arriva la terrible révolution de 1789. M. Gassier combattit corps à corps l’avocat C.-F. Bouche et autres ennemis déclarés de la noblesse. Il défendit, au péril de sa vie, les priviléges de celle-ci dans un écrit, 10 aujourd’hui très rare, que la noblesse fit imprimer à la fin de 1788, en réponse à d’autres écrits et même à des pamphlets dans l’un desquels Bouche osa dire, en faisant allusion à Gassier : Vipère, cessez de siffler. Enfin il défendit jusqu’au bout les priviléges de la noblesse basés sur les sacrifices qu’elle avait faits autrefois pour le soutien de la monarchie…; mais les temps étaient bien changés. Il fut proscrit, obligé d’émigrer et il passa en Italie où il fut accueilli par les distinctions les plus flatteuses. Rentré en France sous le consulat de Bonaparte, il alla d’abord se fixer à Marseille et bientôt après à Aups où il mourut le 23 août 1811, à l’âge de 81 ans. Peu avant son émigration, Mgr le prince de Condé l’avait honoré du titre de secrétaire de ses commandements, et l’ordre de Malte, dont il était le conseil en Provence, lui avait promis la croix de grâce que les circonstances ne permirent pas depuis de lui envoyer. Il a laissé en manuscrit quelques traductions d’ouvrages Italiens.
La maison qui fait face à la petite porte de l’église de Saint-Jean, est celle qu’habitait, depuis longues années avant la révolution, et où mourut M. Jean-Baptiste Roux, notre respectable père, dont nous avons parlé dans notre premier volume. 11
Le 27 septembre 1793, jour d’odieuse mémoire, la loi rendue, le 17 du même mois, contre les suspects, fut mise à exécution dans Aix. D’après cette loi, étaient déclarés suspects tous ceux qui, par leur conduite, leurs relations ou leurs propos, s’étaient montrés partisans de la tyrannie (la royauté), du fédéralisme, ou ennemis de la liberté ; ceux auxquels avaient été refusés des certificats de civisme, et ceux des ci-devant nobles qui n’avaient pas manifesté constamment leur attachement à la révolution.
Notre malheureux père, le plus inoffensif et le plus modeste de tous les hommes, parvenu d’ailleurs à un âge avancé, n’avait pris aucune part au mouvement insurrectionnel des sections contre la Convention nationale, et n’avait même jamais paru depuis la révolution dans les lieux publics, où il aurait pu exprimer ses opinions politiques, conformes en tout point à celles des autres membres de sa famille et d’une foule d’émigres qu’il comptait parmi ses parents. Il se croyait donc à l’abri de toute poursuite et était allé seul, dans l’après-midi, faire sa promenade habituelle hors la ville, gémissant intérieurement sur les malheurs du temps, lorsque revenant par la porte Saint-Jean, et prêt à atteindre le coin de la rue Cardinale pour rentrer chez lui, il fut abordé brutalement par quatre canonniers qui passaient par là, dont nous n’avons jamais su les noms, 12 et qui lui commandèrent impérieusement de les suivre en le qualifiant d’aristocrate. Il les suivit, en effet, timidement et sans murmurer, comme l’agneau qu’on mène à la boucherie, jusqu’aux prisons qui occupaient alors, avons-nous dit plusieurs fois, une partie du bâtiment des casernes, et où il fut écroué malgré l’absence de tout mandat d’arrêt, sur l’ordre seul donné par ces canonniers au geôlier. Une infinité de suspects s’y trouvaient déjà et à chaque instant on en amenait d’autres, si bien qu’à la nuit le nombre en était déjà d’environ soixante, et s’accrut, les jours suivants, par de nouvelles arrestations faites, les unes par ordre des autorités constituées, les autres arbitrairement, suivant le caprice des Sans-Culottes. 13
Il serait inutile de dire que ceux qu’on traitait ainsi de suspects étaient, en général, les plus notables habitants de la ville et les plus distingués par le rang qu’ils avaient occupé précédemment, par leurs vertus, leurs connaissances, leur éducation ou leur richesse. On en jugera assez par les sept compagnons d’infortune qui, dès la première nuit, formèrent la chambrée dont notre père fit partie et dont une juste reconnaissance pour les attentions et les soins qu’ils lui prodiguèrent à l’envi l’un de l’autre, nous fait un devoir de consigner les noms dans cet ouvrage. 14 Tous ceux de la même chambrée, mangeaient et couchaient dans la même pièce où ils étaient renfermés sous les verroux, dès l’entrée de la nuit, comme des criminels, n’ayant eu dans la journée que peu d’heures pour aller respirer l’air dans l’étroite cour des prisons, ou pour entrevoir un instant leurs parents qui n’avaient jamais la permission de franchir les grilles. Chaque jour ils apprenaient que le tribunal criminel révolutionnaire, séant à Marseille, avait fait périr sur l’échafaud tel ou tel nombre de victimes, et ils avaient la douleur de voir partir bien souvent quelques-uns des leurs, appelés à comparaître devant ce tribunal de sang. C’est ainsi que, le 5 octobre au matin, ils virent revenir de Marseille les infortunés Bertet et Mériaud, pour être décapités dans l’après-midi, par le bourreau, sur la place publique d’Aix, et, peu de jours après, un pauvre cultivateur qui devait subir le même sort. 15 Le dernier supplice dont notre père eut connaissance, fut celui de la reine Marie-Antoinette, exécutée à Paris, le 16 octobre. Tant d’horreurs ne tardèrent pas à altérer sa santé. Cette mort cruelle de la reine le plongea dans une atonie complète. L’appétit et les forces l’abandonnèrent subitement, et, pendant quatre ou cinq jours, quelques gouttes de bouillon furent seules sa nourriture. Il perdit enfin toute connaissance et quelques instances que nous pussions faire, notre malheureuse mère et nous, auprès des barbares tyrans de la cité, il ne nous fut jamais permis d’entrer dans l’intérieur des prisons pour le soigner. Ses généreux compagnons d’infortune nous suppléèrent autant qu’il dépendit d’eux, le veillant pendant plusieurs nuits et lui administrant eux-mêmes les secours que sa position exigeait.
Le samedi 26 octobre, le représentant du peuple Paul Barras, traversant la ville d’Aix, s’y arrêta quelques instants dans le courant de l’après-midi ; nous courûmes nous jeter à ses pieds.
Il eut pitié de nos larmes, et écrivit sur un chiffon de papier l’autorisation qu’il nous donnait de faire transférer notre père dans sa maison, en indiquant toutefois les précautions à prendre par les autorités pour prévenir son évasion…. (l’évasion d’un vieillard moribond !). Une chaise à porteurs fut aussitôt envoyée par nous sur les lieux, et MM. de Coriolis, de la Galinière et de Lubières fils, entrelaçant leurs bras, transportèrent le mourant de la chambre où il était alité à la porte des prisons, où les Sans-Culottes le placèrent dans la chaise. Six ou huit d’entre eux furent chargés de l’escorter jusque chez nous, et l’accompagnèrent en poussant les cris affreux : vive la nation! çà ira ! à la lanterne ! Mais notre père ne pouvait les entendre ; l’agonie avait commencé. Elle se prolongea pendant toute la nuit et il expira le lendemain vers midi, à l’âge de soixante-treize ans et cinq mois moins deux jours, dans nos bras et sous les yeux de deux gardiens chargés, disaient-ils, de veiller à ce qu’il ne prit la fuite. Tableau déchirant d’un côté, amère et insultante dérision de l’autre, dont cinquante-quatre ans qui se sont écoulés depuis lors n’ont pu nous faire perdre le souvenir. Telle fut la fin déplorable d’un homme de bien, d’un citoyen paisible et vertueux, qui idolâtrait sa patrie, pour laquelle il avait travaillé si utilement pendant un grand nombre d’années, et qu’entourait l’estime des plus honorables habitants d’Aix.
Enfin, la dernière maison de cette rue, faisant coin dans celle d’Italie, à l’opposite de l’église de Saint-Jean, était celle du célèbre jurisconsulte Hyacinthe Boniface, seigneur de Vachères, qui l’avait faite bâtir vers la fin du XVIIe siècle et dont les descendants l’ont possédée jusqu’à leur extinction en 1794.
Boniface avait publié de son vivant une vaste compilation d’arrêts rendus par les cours du parlement, des comptes et des aides et finances de Provence, en cinq volumes in-folio, qui porte son nom et qui fut accueillie favorablement. par tous les gens de palais. Il était né à Forcalquier en 1611, et mourut à Aix le 28 juillet 1699, avant été assesseur de cette ville et procureur du pays en 1680.
1 Aix, veuve Adibert, 1786 et 1787, 2 vol. in-4°. Calmen, 1788, 3e vol. Il en restait un 4e à imprimer qui n’a jamais paru. Retour
2 Voyez son éloge dans le Diario de Rome, du 28 mars 1837, et dans la Gazette du Midi du jeudi, 6 avril suivant, n° 1314. Retour
3 Voyez son acte religieux de mariage au registre de 1639, au 3 décembre, paroisse Saint-Sauveur, où il est dit que Jean était fils de feu Charles Daret et d’Anne Junon. Le nom de sa femme s’écrivait Cabassol ou Cabassole. – Voyez aussi notre 1er vol., pag. 280, not. 1. Retour
4 Souvenirs des voyages de monseigneur le duc de Bordeaux en Italie, en Allemagne et dans les états de l’Autriche, par M. le comte de Locmaria ; Paris, Ed. Proux et Comp., 1846, 2 vol. in-8°, tom. II, pag. 471 et suiv. Retour
5 Nous possédons dans notre cabinet un assez bon nombre de pièces qui proviennent de ces archives, et dont nous allons donner une notice succincte qui ne sera pas sans intérêt pour bien des gens.
Elles sont au nombre de 288, dont 153 sur parchemin et 155 sur papier, la plus ancienne desquelles est de l’an 1056* et la plus récente de 1789. Nous les avons réunies en deux volumes in-f°, sous le titre de ARTACELLAE MONASTERII CHARTULARIUM ; pars I, 1056-1496 ; pars II, 1503-1789. – Soixante-douze de ces pièces n’ayant pu être reliées dans l’un ou l’autre de ces volumes, soit à cause de leur trop grande dimension, soit par la crainte de briser les sceaux en cire ou en plomb dont elles sont revêtues , nous les avons placées dans six sacs de toile séparés et une brève analyse de leur contenu leur a été par nous substituée dans les volumes à leur date.
Toutes, véritablement, n’offrent pas un très grand intérêt, mais il y en a quelques-unes de fort curieuses pour des amateurs, telles que les suivantes :
Huit bulles des papes Alexandre III (1160), Grégoire IX (1238), Clément IV (1268), Clément V (1312), Benoît XIII (1406 et 1407), et Nicolas V (1448), toutes scellées en plomb.
Un bref du pape Urbain V (1364).
Deux chartes d’Ildefons 1er, roi d’Aragon, comte de Provence (1176 et 1182).
Une charte de Raymond-Bérenger III, son frère, comte de Provence (1179).
Deux chartes d’Ildefons ou Alphonse II, comte de Provence (1202 et 1207).
Deux chartes de Geoffroi Réforciat, vicomte de Marseille (1218 et 1227).
L’acte de profession de la comtesse Garsende de Sabran héritière du comté de Forcalquier et veuve d’Alphonse II dans le monastère de la Celle (1225). (Voyez notre 1er volume, pag. 11, note 1).
Une charte de Raymond-Bérenger IV, dernier comte de Provence de la maison de Barcelone, beau-père du roi saint Louis, etc. (1235).
Une charte de la comtesse Béatrix de Savoie, femme dudit Raymond-Bérenger IV (1244).
Une charte de Charles 1er d’Anjou, roi de Naples et comte de Provence (1270).
Quatorze lettres-patentes de Charles II, roi de Naples et comte de Provence (de 1282 à 1307).
Une charte de la reine Marie de Hongrie, femme de Charles II (1293).
Trois lettres-patentes du roi Robert, comte de Provence (1310, 1349 et 1335).
Trois lettres-patentes de la reine Marie de Blois, veuve de Louis 1er d’Anjou, roi de Naples, comte de Provence (1390 et 1394).
Deux lettres-patentes de Louis II, roi de Naples, comte de Provence (1408 et 1411).
Cinq lettres-patentes du roi René, comte de Provence (de 1437 à 1478).
Plusieurs bulles de légats du pape à Avignon, de divers archevêques D’Aix et autres évêques ou abbés de St-Victor de Marseille, avec les sceaux en cire rouge, verte, jaune, etc., de tous ces princes, légats, évêques et abbés.
Toutes les pièces de la procédure faite par le cardinal Grimaldi, archevêque d’Aix et le cardinal jules Mazarin, comme abbé de St-Victor, pour la translation des religieuses bénédictines de la Celle à Aix (1658 et 1659) ; deux lettres apostoliques du pape Alexandre VII (1661 et 1664) ; cinq lettres-patentes de Louis XIV (de 1660 à 1681), et autres pièces relatives à cette translation.
Un grand nombre de chartes intéressantes pour la connaissance des mœurs et des usages des anciens temps, telles que celles-ci : Permission donnée en 1257, par Barral des Baux aux religieuses de la Celle, de faire passer à perpétuité par le lieu d’Aubagne et son terroir, tout ce qui sera nécessaire pour l’usage de ces religieuses, comme pain, vin, viande, fruits, laines et autres choses, sans payer aucuns droits de péage, lods ou autre imposé ou à imposer en faveur dudit Barral et des siens ; voulant que les religieuses se réjouissent à perpétuité de ce privilège, etc. – Sentence du juge de Camps en 1299, qui condamne le nommé Pierre Rostagni, convaincu du crime d’adultère, à cent sols d’amende en faveur du monastère de la Celle. – Autre sentence du juge du même lieu de Camps, en 1332, qui condamne, en faveur du même monastère, le nommé Jean Guitard à une amende de vingt-cinq livres de coronats, payables dans dix jours en monnaie courante des tournois d’argent du roi de France, avec l’O rond, de poids, valant treize deniers), pour avoir violé la nommée Guillaumie dans l’enclos de la vierge. – Indulgence de cent jours accordée à perpétuité par divers cardinaux, en 1496, aux fidèles qui visiteront l’église de la Celle certains jours de l’année, etc. Cette pièce est entourée de vignettes enluminées assez bien conservées ; au coin supérieur à gauche, est l’image de la Ste-Vierge tenant l’Enfant Jésus sur ses genoux; au milieu de la bordure supérieure, on voit sainte Véronique tenant en ses mains le mouchoir sur lequel est empreinte la figure du Sauveur, et sur le coin à droite de la même bordure est la figure d’une religieuse de St-Benoît, debout. Sur les deux bandes des côtés, sont des armoiries, des arabesques, etc. A cette grande pancarte, pendent les sceaux de tous les cardinaux qui l’ont donnée à Rome, l’an IV du pontificat d’Alexandre VI.
Enfin plusieurs lettres originales de Louis XIV, de la reine Anne d’Autriche, sa mère, de cardinaux, d’archevêques, d’évêques, etc., etc.
* Celle-ci est la dédicace de l’église Notre-Dame, de Brignoles, faite par Pons de Châteaurenard archevêque d’Aix, avec ses chanoines, à la prière des moines de St-Victor, de Marseille, le 8 des calendes de février de l’an 1056. Voyez à ce sujet, le Gallia christiana, tom. I. col. 307, et la notice sur Brignoles, par le savant M. Raynouard ; Brignoles, 1829, pag. 19. Retour
6 Les premiers suspects arrêtés en septembre 1793, furent renfermés dans les prisons aux casernes (voy. plus bas); mais leur nombre ayant quadruplé et peut-être plus dans les mois suivants, on fut obligé de convertir pour eux en prisons les deux couvents dont nous parlons. Retour
7 Voyez ci-après, rue Saint-Michel. Retour
8 Voyez notre 1er vol., pag. 574 et suiv. Retour
9 Cet exemple prouve, au milieu de tant d’autres, ce qu’on a dit si souvent que les avocats sont ordinairement de mauvais juges, habitués qu’ils sont à voir les affaires sous toutes les diverses faces. Retour
10 Observations sur la véritable constitution de la Provence, au sujet de la contribution des trois ordres aux charges publiques et communes, Aix, Gibelin-David et Emeric-David, 1788, in-4° de 406 pages. Retour
11 Tome 1er, pag. 173 et suiv. Retour
12 Quelques voisins qui accoururent aussitôt pour nous apprendre ce fatal événement, ne purent ou pour mieux dire, n’osèrent pas nous faire connaître ces misérables. Retour
13 Nous conservons les originaux de deux certificats qui nous lurent délivrés l’année suivante, l’un par l’administration du district, l’autre par le comité révolutionnaire lui-même, constatant qu’il n’existait aucun mandat d’arrêt, ni aucune dénonciation contre notre père. Retour
14 MM. Nicolas-François-Xavier de Clapiers, marquis de Vauvenargues (frère du moraliste), ancien premier consul d’Aix, procureur du pays, né en 1719, mort le 26 juillet 1801. – .Jules-François-Paul de Fauris, seigneur de Saint-Vincens, ancien président au parlement, né en 1718, mort en 1798. – Alexandre-Jules-Antoine de Fauris Saint-Vincens, fils du précédent, dit de Noyers, du vivant de son père, comme lui ancien président au parlement (depuis maire d’Aix, président à la Cour royale), né en 1750, mort en 1819. – Édouard-Laurent de Coriolis, seigneur de Moissac et de Rousset, ancien président à la cour des comptes, aides et finances, né en 1745, mort en 1806.-Joseph-Antoine-Louis de Bonaud, seigneur de la Galinière, ancien conseiller à la cour des comptes, etc., né en 1737, mort en 1816. – Louis-François de Benault-Lubières, marquis de Roquemartine, ancien conseiller au parlement, né en 1727, mort en 1800. – Et Charles-Félix de Benault-Lubières, fils du précédent, né en 1764 , mort en 1810. Retour
15 Voyez au tom. 1er, pag. 625 et suiv., l’état des condamnés révolutionnairement. Retour
![]()
Au moment où cette feuille est mise sous presse, une étonnante révolution vient de s’accomplir à Paris. Le 24 février 1848, en quelques heures de temps, le trône de la dynastie d’Orléans, élevé le 7 août 1830 à la suite des journées de juillet, a été renversé et le gouvernement républicain proclamé dans toute la France. N’ayant jamais eu le moindre mot d’éloges pour Louis-Philippe, le fils du régicide Égalité, ayant même été le premier dans Aix, dès ledit jour 7 août 1830, à préférer l’abandon immédiat d’un état honorable et lucratif et la perte de trente ou trente-six mille francs qui en étaient le prix, à la honte de servir un usurpateur, ingrat et traître envers son parent, son bienfaiteur et son roi, comme il l’a été depuis envers le peuple qui l’avait élu, nous n’imiterons pas tel ou tel de ses anciens courtisans qui lui prodigue l’outrage depuis qu’il est tombé ; nous nous bornerons à constater ici que sa chute soudaine n’a excité aucun regret dans cette ville. En 1830, treize membres de la cour royale d’Aix que nous nommerons plus bas, donnèrent du moins des preuves de sympathie à Charles X, en abdiquant aussitôt leurs fonctions ; pas un n’en a fait autant pour Louis-Philippe. Les citoyens de toutes les opinions ont reconnu, dans sa punition, la preuve éclatante de la justice de Dieu, et se sont réunis comme des frères, pour assurer tous ensemble le maintien de l’ordre public, la sûreté des personnes et des propriétés.
L’homme sage et prudent ne lâche point sa proie
Et, pour quitter sa place, attend qu’on le renvoie.
![]()
